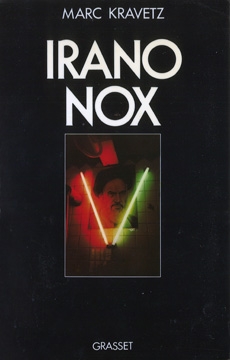|
INTRODUCTION
Le téléphone a sonné à quatre heures et demie. « Good morning sir. » Pour une fois, peut-être parce que c'était la dernière, le veilleur de nuit de l’intercontinental ne m'avait pas oublié. Non, j'étais injuste. L'hôtel faisait ce qu’il pouvait. Essayez de gérer un palace de huit cents chambres avec trente clients les bons jours, les règlements islamiques, les Komiteh, les flics dedans, les flics dehors, les salaires qu’on ne peut plus payer et les hôtes, dear guests, qui se croient à Tokyo, Amsterdam ou Los Angeles. Comme si à Téhéran, en ce mois d’août de 1981...
Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à penser à l’hôtel avec cette espèce de tendresse un peu molle, la fausse nostalgie que l'on se fabrique au moment de partir, sans doute.
Le téléphone ne m’a pas réveillé. En fait je n’avais guère dormi. Tard dans la nuit, au milieu de mes sacs en désordre, j'avais une ultime fois tenté d’appeler Parviz. Je voulais lui dire que je l’avais cherché depuis trois semaines, que j'étais triste de partir sans l’avoir revu, que ce serait pour la prochaine fois, que je comprenais, porte-toi bien et fais gaffe à toi. « No ans-wer, sir », avait dit le standardiste. « Peut-être avez-vous un mauvais numéro. » Il m’avait fait la même remarque chaque jour. Il fallait bien dire quelque chose. C’était le bon numéro. Le seul. Je savais qu’il ne répondrait pas. Ni lui, ni les autres.
« Soyez à l’aéroport trois heures avant le décollage », avait dit l’agence. Le vol de la Lufthansa pour Francfort quittait Merhabad à neuf heures. Difficile de partir d'Iran sur un coup de tête. Tous les avions étaient pleins trois semaines à l'avance. L'employée d'Air France avait négocié toute une journée pour nous obtenir deux sièges sur Lufthansa. Des journalistes, l'urgence...
« On vous a dit trois heures ? Comptez quatre. » L’ami de l’ambassade qui était venu nous saluer la veille au soir nous avait décrit par le menu les tourments qui nous attendaient. « Neuf contrôles, les fouilles, gare aux papiers et aux devises. En général, tout se passe bien. Evidemment, les impondérables... Le mardi deux avions décollent à la même heure. Un pour Francfort, un pour Dubaï. Ça double les files d’attente. Oui, il est arrivé que des compagnies abandonnent leurs passagers quand les formalités traînaient trop. »
Les reporters, voyageurs professionnels, mettent un point d’honneur à considérer ces détails avec fatalisme. Les procédures d’embarquement ou de débarquement font partie des réflexes acquis, comme les changements de passeports, le fonctionnement du télex, les locations de voitures ou l’écoute du B.B.C. World Service. Nous ignorons l’angoisse des grands départs. Nos soucis sont ailleurs. Avant et après. L’aéroport est un temps mort. Au mieux, le journaliste en retient une ambiance. Surtout quand il arrive et qu'il attend ses bagages. Avec les borborygmes du chauffeur de taxi qui va le conduire à l’hôtel — chaque capitale de l’actualité a son hôtel, même si la ville en compte quatre-vingt-dix — et les quelques observations glanées dans une salle d'arrivée, l’envoyé spécial qui se respecte a déjà la « couleur » de son premier papier.
Trois heures, quatre heures, neuf contrôles ou douze, quelle différence ? A Tel-Aviv-Ben Gourion on compte cinq heures et parfois six. A Bangkok, c’est le petit bonheur, ou le grand malheur. A Kennedy Airport, la grève des aiguilleurs. A Char-les-de-Gaulle, celle des bagagistes. A Téhéran...
J'ai eu ma communication pour la France à deux heures du matin. La voix familière et douce. « Oui, si tout va bien, je serai à Paris ce soir. Si quoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit si. Si rien. Donc tout ira bien, je serai à Paris ce soir. » C'était une phrase toute faite. Un tic sans importance, comme j'aurais dit, on ne sait jamais. Le taxi nous attend, l’avion nous attend. Ankara, Francfort, Paris. Nous sommes des journalistes en règle, accrédités, tamponnés. Passeport, visa, carte de presse des autorités locales. Rien à déclarer. Affaires personnelles, instrument de travail. Pas même un souvenir. Si tout va bien.
Alain Bizos était prêt dès cinq heures. Il n'avait pas plus dormi que moi. Il était en pleine forme. Il a tout de suite vu que quelque chose n’allait pas. L'histoire du fric ? Pas de quoi finir à la prison d’Evin. Mille francs avaient disparu de ma chambre trois jours après notre arrivée. Je n'avais jamais laissé d'argent dans le coffre d’un hôtel. Je n’avais jamais été volé non plus. Le pointilleux contrôle des devises à l’entrée et à la sortie compliquait un peu l’affaire. Les autorités étaient particulièrement soucieuses de freiner les trafics. Et comme le taux de change (obligatoire) auprès des banques était à peu près le tiers de celui du marché noir, les vérifications étaient soignées. Mais on ne prend pas de risque pour mille francs. Non, ce n'était pas le fric. Alors quoi ? Alors rien.
« Plus facile d’expliquer qu’on a perdu quelques billets que de justifier qu’un photographe professionnel rentre à la maison sans ses pellicules », disait Alain Bizos. La réglementation iranienne était formelle. Tous les films devaient être développés et examinés en Iran et, le cas échéant, saisis en tout ou partie. Alain n’avait évidemment pas respecté la Loi. Il n’avait pas confiance dans les laboratoires locaux et l'idée qu'on puisse lui gâcher une pellicule lui était à peu près aussi insupportable que le principe même de la censure. Forme et fond. Technique et déontologie. Un vrai professionnel ne fait pas la différence. Alain Bizos en est un. Il s’expliquerait tout à l’heure sur la question si elle lui était posée. Il y avait un temps pour tout. Maintenant il était seul et heureux de partir. Et si vraiment ils en avaient marre de nous, que pouvions-nous leur offrir de mieux ? Nous partions.
Alain avait raison. Tout se passa comme prévu. Trois heures et demie de formalités. Neuf contrôles. Interminable et sans importance. L’avion roulait sur la piste. Attachez vos ceintures. Il virait au-dessus d’Azadi Square et l'arc de triomphe du chah défunt. Téhéran s’éloignait. Déjà nous survolions les sommets ocre et gris de l’Elbourz. Autour de nous les visages s’animaient. Les gens parlaient, bougeaient, riaient, se bousculaient vers les toilettes. Un vol comme les autres.
« Tu vois, dit Alain, on en est sorti. Ça va mieux ? »
Je regardais les hôtesses qui démontraient sans conviction le fonctionnement des masques à oxygène. Nous étions entrés dans le temps mort du voyage. Le temps de l’attention flottante. Juste des images qui circulent. Une phrase me trottait dans la tête. Quelque chose comme : « Elles ont des cheveux, des jambes de femmes, elles te regardent dans les yeux quand elles te parlent, elles sont ou elles ne sont pas désirables et elles peuvent penser la même chose que toi quand elles te voient ; tu ne sais pas ce qu'elles pensent, probablement même qu’elles ne pensent à rien que tu puisses imaginer, tu ne connais pas leur langue mais tu sais ce qu’elles peuvent penser ; elles sourient, ce n'est rien d’autre qu’un sourire professionnel mais quand même un sourire complice ; elles ne te regardent pas mais leurs yeux regardent, elles ne te sourient pas mais leur bouche sourit : c’est le commencement de l'humanité. »
« Oui, tu as raison. On en est sorti. Et maintenant il va falloir écrire.
— Ne te plains pas. Pour toi tout est encore possible. Pour moi tout est fini. Je n’inventerai pas d'images. »
De ces banalités que se disent les journalistes. Un reportage chasse l'autre. A quand le suivant ? Oui, en effet, ça allait mieux. Pourquoi fuyez-vous donc, mon fils ? De quoi aviez-vous peur ? Vous vous sentiez donc bien coupable ?
« Je suis bien content qu’on en soit sorti, dit Alain.
— Moi aussi. »
Nous parlions de la même chose. Mais de quoi parlions-nous ? Nous en aidons fini avec un reportage d'un peu plus de trois semaines. Nous n’avions risqué ni notre liberté, ni notre vie. Nous avions beaucoup travaillé, moins bien que nous ne le souhaitions, mieux que nous ne l’avions espéré. Un reportage comme un autre. Dans l’honnête moyenne. L'Iran de la troisième révolution. Une douzaine d’interviews, quelques scènes de rues, quelques personnages, des impressions, un bon lot d'informations incontrôlables. Pas d’aventure. Peu d'émotion. A reléguer au magasin du manque à raconter.
« Ça se verra à l’image, soupirait Alain.
— Tu te souviens de la photo que tu n’as pas faite ?
— Le Parc ?
— Oui, ou celle du couple avec la poussière dans l'œil. Ça pourrait faire le commencement d’une histoire. L'effet « Iran-troisième-révolution-islamique ? sur reporters tout terrain élevés aux mamelles du nouveau journalisme. Qu'est-ce que tu en penses ?
— Je pense que l’Iran fatigue. »
Par deux fois Alain Bizos avait cru se prendre en défaut. La photo du Parc, c'était à cause de la lumière. Nous avions découvert l’endroit après cinq heures du soir et plus jamais trouvé le temps d’y retourner. La seconde, c’était un manque de chance. Nous nous rendions à je ne sais plus quelle cérémonie quand, sur le chemin, depuis le taxi, Alain avait aperçu à un carrefour un couple, plutôt jeune, se faisant face. La femme regardait dans l’œil de l’homme comme si elle voulait en ôter une écharde. Alain avait pris l’habitude de ne plus charger ses appareils avant un rendez-vous ou une visite. Cela lui évitait de gâcher des films quand les préposés aux questions de la sécurité — de la personnalité que nous rencontrions, de la mosquée, du meeting, du lieu de prière, etc. - ouvraient les boîtiers, démontaient les objectifs et exigeaient de voir fonctionner tous les mécanismes pour s'assurer que ses Nikon n’étaient pas des bombes piégées. Le temps d'enrouler une pellicule dans son appareil, le couple avait disparu du carrefour. La « photo du Parc », c’était un ovale de ciment où des jeunes gens faisaient du patin à roulettes avec, en premier plan, deux jeunes filles en pantalon crème et veste sombre.
« Sujet intéressant : tu montres une fille en jean ou en pantalon crème, un type qui a mal à l’œil et qui se fait examiner par une femme qui est peut-être la sienne et tu dis : j'ai vu ça en Iran. On te demande quel rapport ça peut bien avoir avec l’Iran et tu réponds : le rapport c'est que nulle part ailleurs je n’aurais eu envie de prendre un tel cliché. »
Ce n’était pas le commencement d’une histoire. Tout juste une anecdote à se raconter le temps d’un vol entre Téhéran et Francfort. Si nous déraillions, à qui la faute ? Comme cette nuit. Ce malaise sans objet. Cette humeur âcre de l’aube. Nous sommes bien contents d'en être sortis. Une banalité convenue de plus ou bien ? Ou bien ?
Cette envie brutale de respirer comme si nous émergions d’une brume fangeuse, cette frénésie enfantine de dire ce qui nous passe par la tête comme des collégiens libérés du pensionnat : voilà ce que nous éprouvions à cette minute. Nous en sommes sortis, nous sommes libres — absurde, nous avons toujours été libres, nous sommes venus librement et nous repartons librement — et pourtant, la liberté, y a-t-il un autre mot pour le dire que la liberté ? Et me voilà qui regarde des jambes de femmes avec l’œil allumé d’un dragueur des boulevards. Comprenne qui pourra.
Nous sortons de l’Iran comme on se réveille d'un cauchemar.
Le mardi 4 août 1981 à neuf heures j’ai quitté Téhéran pour la sixième fois en trente mois. Je n'ai pas tenu une comptabilité exacte mais j’ai dû passer en Iran, entre le 16 janvier 1979 et ce dernier mois d’août, pas loin du tiers de ma vie. Je pense que j'y retournerai bientôt. Non que j'aie besoin de ce pays, d'une ville que j’aurais aimée ou de gens que j’y ai connus, comme on souffre d'un manque — cela arrive aussi aux reporters et plus souvent qu'on ne croit — mais parce que j’ai envie de savoir la suite, parce que c’est mon métier, l’actualité comme on dit. Partir et revenir d’Iran n’est pas tout à fait une habitude (« ne sois pas snob », dit-elle), mais déjà plus un événement. Le prochain rendez-vous avec l’Iran est déjà pris. Manquent le jour et l’heure.
Qu’on ne s'y méprenne pas. On ne part pas en reportage comme on pointe à l’usine. Assurément, il y a de bons et de mauvais journalistes, des gens honnêtes et des corrompus, des militants et des cyniques, des casse-cou et des trouillards, des bidonneurs et des maniaques de l'âge du capitaine, sans compter toutes les nuances intermédiaires, les changements de catégories et le mélange des genres. Je n’en connais pas, ou peu, qui ne soient des malades monomaniaques. Même s’ils friment avec les distances et les fuseaux horaires, s'ils prennent l'air las et font semblant de rêver d'un emploi de bureau, ils n’imaginent pas leur vie sans cette sollicitation permanente de l'événement qui fait toujours figure de nécessité alors qu’elle n’est réellement nécessaire qu’à eux seuls. En ce sens ils sont des passionnés pervers.
Passion schizophrène : je ne connais pas non plus de journalistes — bis repetita, toutes réserves faites — qui écrivent ou du moins qui travaillent pour « leurs » lecteurs — concédons cette fois que les exceptions sont plus nombreuses. Le courage de dire n’est pas en cause, affaire de tempérament, mais la passion de savoir est une fin en soi. La rage entomologique avec laquelle nous accumulons les faits — just facts —, les dates, les détails biographiques et tous les chiffres possibles et imaginables, depuis l'évolution de la production cotonnière et l’âge des enfants du Premier ministre en passant par le produit national brut, le déficit de la balance des paiements et le taux d’inflation corrigé par la Banque mondiale, jusqu'au nombre de fenêtres des bâtiments de la présidence, cette obsession donc, sinon de l’exactitude du moins de ses critères les plus probants, n’a qu'un rapport très lointain avec la mission d’informer.
Cela pour dire que ma certitude de retourner un jour, bientôt, en Iran n’est ni de l’ordre du manque, ni le résultat d’une obligation contractée devant Dieu, un rédacteur en chef ou ce grand fétiche qu’on appelle le lecteur. Je dirai que c’est un fait de nature, « la nature fragile des journalistes, écrit Jean-François Fogel, qu'épuise et stimule à la fois l’air de leur temps dont ils ne peuvent se passer. Les hygiénistes parlent de drogue. Les enthousiastes de passion ». Et les intéressés ne font plus la différence. Je vous accorde que ce n’est pas une excuse.
Quand bien même nous aurions resservi sous une forme acceptable la totalité des menus objets de notre collection de facts, le lecteur ne serait pas plus avancé. A moins d’être lui-même un spécialiste ou un professionnel concerné par le sujet, il ne saura jamais ce que nous savons ou que nous croyons savoir parce que les raisons, les principes ou les circonstances qui gouvernent le choix des informations que nous lui offrons, et permettent à la rigueur de leur donner un sens, ne lui sont pas donnés. Il ne saura jamais non plus ce qu'il veut savoir, pour l’excellente raison que la question qui nous occupe entièrement n’est dans le meilleur des cas, pour lui, qu’un sujet de curiosité épisodique dont les manifestations sont rarement synchrones avec les sauts de puce de l’envoyé spécial qui s’essouffle à suivre les rebondissements de l’actualité.
Résultat, puisque les journaux sont faits pour être lus : un compromis bâtard entre le schématisme simplificateur et le pointillisme abscons. Le reporter poursuit ses chimères et le lecteur ronge ses frustrations. Deux années de « couverture » quasi quotidienne de l’Iran vous apprennent la modestie. Quand l’Iran, tel un ludion, remonte à la surface de l'actualité, vous découvrez — est-ce une surprise ? — que le million de signes typographiques distillés jour après jour par « notre-envoyé-spécial-à-Téhéran » devaient être signes d’eau, d'air ou de sable et qu’ils se sont évanouis. Tout est à refaire. Bref, l’Iran, on n’y comprend rien. Et ce on vous accuse. L’ignorance boudeuse du lecteur a le bon droit pour elle. Vous m’avez gavé de faits, d’anecdotes, de références, de noms de partis, de groupes, d’ayatollahs, je ne sais toujours pas ce qui se passe en Iran, ni le pourquoi, ni le comment.
Reste bien sûr le sempiternel, l’insupportable, le pédagogique « commençons par le commencement ». Il a ses mérites. Il était une fois le prophète Mohammad. Il n’avait pas d’héritier mâle pour assurer sa succession. Les ulémas confièrent la direction de la communauté des croyants à des califes élus parmi les compagnons du Prophète. Le quatrième était Ali. Ali n’était pas un compagnon comme les autres. Cousin de Mohammad, il fut, à dix ans, l’un des premiers à témoigner qu'il n’était de Dieu que Dieu. Il reçut en mariage la fille unique de Mohammad et de Khadidja. Or, de ce quatrième calife, nombre de croyants firent le premier imam. Ils considéraient Ali comme le véritable dépositaire de cette part de la révélation divine qui n’était pas accessible aux humains. Ses fils et ses descendants porteraient le message. Tous sont morts de mort violente. Du moins la tradition l’entend-elle ainsi. Jusqu’au onzième de la lignée. Le douzième, Mohammad, dit aussi Qâèm (le « Résurrecteur »), Mehdi (« Celui qui est guidé »), Sahebeh-Zamân (le « Maître du temps »), disparut à l’âge de sept ans. Il n’est pas mort, dit encore la tradition. Il est seulement l’« Imam caché », « occulté » et réapparaîtra à la fin des temps, pour annoncer à l’humanité le règne de la paix, de la justice et de la vérité. Avec lui, mais avec lui seulement, s’achèvera le message de la révélation et Dieu sera présent aux hommes. Sans lui il ne saurait exister d’autorité légitime. Tout gouvernement n’est que provisoire et la constitution de l'Iran islamique le dit en son « cinquième principe » : la « gestion des croyants » est confiée à « un docteur du dogme juste, vertueux, au courant de l’évolution de l'époque, courageux, efficace et habile, qui est accepté comme guide par la majorité du peuple », mais ce n'est qu’en l'absence de l’Imam du temps « que Dieu approche sa réapparition... ». Tel est le fondement, mystérieux et mystique, de l’Islam chiite duodécimain, le sens et l’essence d’une foi messianique, hantée par la douleur et le deuil et dont la vérité est toujours à venir.
Est-ce bien le commencement ? Ces bribes glanées hâtivement auprès des exégètes ne comblent pas le vide. Au mieux, elles l’embellissent, elles donnent à l'histoire un semblant de sens, par quoi le journaliste ne se présente pas démuni face à son public. Il est toujours meilleur de manipuler les mystères que de plaider l’ignorance.
En vérité, nous ne manquons pas d’explications. Nous en avons même plusieurs. La tyrannie du chah, la répression, l’exploitation étrangère de l’Iran, la déculturation, la coupure entre les élites et les masses, le ferment de révolte du chiisme iranien, l’ambiguïté des relations entre le clergé et le peuple — obscurantisme et messianisme, réaction et émancipation. On n’oubliera pas les enjeux stratégiques du Golfe, le pétrole, les Russes, les Américains, l'impasse du nationalisme (grandeur et décadence du Dr Mossadegh) et la faillite des idéologies de l’Ouest comme de l'Est. Le malheur est que toutes ces explications sont vraies, qu’on peut (qu’on doit ?) les multiplier, les raffiner, les croiser, les contredire, serrer un peu plus à chaque passage les mailles du filet. Pour attraper quoi en définitive ? La confirmation de bonnes grosses idées qui confinent aux préjugés, favorables ou défavorables selon les filtres utilisés, à propos du tiers monde, de l’Islam, de l’échange inégal, des droits de l’homme et du désarroi planétaire face à une société en mutation.
Filtre positif : les principes sont excellents, le mouvement est juste, les bavures sont inévitables; que pèsent les excès juvéniles d'une révolution face à l’immensité de ce qu’elle a déjà accompli : débarrasser l’Iran d’une tyrannie multiséculaire et de la mainmise impérialiste ?
Filtre négatif : les erreurs — les crimes — du chah, que personne ne conteste, ont nourri une revendication d'essence réactionnaire qui commet pis encore et a déjà anéanti les progrès, non moins incontestables, accomplis dans les domaines sociaux et économiques. On a chassé les Américains, certes, mais les Russes approchent. L'Iran accouche de son moyen âge islamique dans la violence et l’horreur. De quelle révolution parle-t-on ?
« Ce n’est pas votre faute mais vous ne pouvez pas comprendre. » Cette phrase-là, le journaliste étranger (disons « occidental ») en Iran l’a tant entendue qu’il ne l'entend même plus. Il s’est résigné aux évidences : il ne parle pas la langue ; il n’est pas musulman ; il n'a ni vingt-cinq siècles de Perse, ni quinze d'Islam dans la tête et dans les veines. Il sait qu'il ne sort pas des geôles de la Savak ni des bidonvilles de Téhéran. Il n'en est pas spécialement fier, il n’a plus le goût d’en avoir honte. Il a l'habitude. Changez les dates et les lieux, la situation reste la même. Il n'est pas Iranien, soit. Il n’était pas Vietnamien, Algérien, Libanais, Bengali, Kurde ni Tchadien. Étemel problème de l’occidentalo-centrisme ? Non.
En Iran le : « Vous n’êtes pas d’ici, vous ne pouvez pas comprendre » n'est pas de l’ordre de la différence, même incommensurable, mais de l’exclusion. Dans la colère de Dieu contre Taghout, le Diable n'admet pas de concession. Khomeiny ne vous accorde pas la part du feu. Ami ou ennemi, peu importe. L'enfer où vous expédie la révolution islamique est pavé de vos bonnes intentions. Il n’y a pas de place pour les envoyés spéciaux, sinon ceux du Prophète, dans l’âge d’or de l’Islam promis par l'imam à trente-sept millions d'iraniens. Vous n’êtes plus un individu : vous êtes une incarnation du Mal. Vous pourrissez ce que vous touchez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vos yeux, votre bouche, votre main sont empoisonnés.
Vous croyez qu'il est difficile de communiquer, vous maudissez vos ignorances, la langue, la culture, l'histoire. Vous perdez votre temps. La communication n’a pas d'objet. Ce n'est pas que les mots manquent pour le dire : on n'a rien à vous dire et rien à apprendre de vous. Vous protestez qu’on vous a donné un visa, une carte de presse, qu’on a donc, par des signes évidents et clairs, reconnu votre légitimité de journaliste. On vous répond que vous êtes libre de venir en Iran. D’écrire ce que bon vous semble. Mais personne ne vous a demandé de venir. Vous n'êtes pas le bienvenu.
Alain Bizos arrivait de Paris, moi de Beyrouth. Nous nous étions retrouvés à Athènes le 11 juillet 1981 pour le vol de nuit d'Iran Air à destination de Téhéran. C’était la première fois que j'allais en Iran sans la perspective des contraintes du « papier » quotidien. Les instructions d’Actuel, le magazine qui avait commandé ce reportage, étaient des plus vagues. Qu'est-ce que le pouvoir islamique ? Comment ça marche ? Qu’est-ce qu'il fait ? Comment peut-il imposer le retour à la stricte obédience coranique à un peuple qui a peu ou prou goûté à la civilisation moderne ? Qu’est-ce que ça cache ? Qu’est-ce que ça ne cache pas ? Racontez et montrez. « On veut comprendre. » Cela tenait de la gageure mais j’étais heureux de faire ce reportage avec Alain Bizos.
Journalistes de l’écrit et photographes font rarement bon ménage. Leurs exigences et leurs intérêts ne sont pas les mêmes. L’un travaille sur le plein, la densité, le signe immédiatement lisible : l’image épuise l’image. Vide, elle ne s’enrichit d’aucun récit. L’autre jongle ; avec l'espace et le temps. Quatre heures de conversation apparemment insipide lui vaudront peut-être un chapitre, lesté de ce qu’il a glané ailleurs ou de souvenirs qu'il peut mobiliser. Le plus coloré des spectacles ne fera pas forcément un paragraphe. Comme les deux ont tendance à outrer les traits fondamentaux de leur métier, la coexistence devient vite explosive et en tout cas stérile. Avec Alain Bizos, c'est différent. Il ne sait pas d’avance ce qu’il cherche. Il sait que la première impression est rarement la bonne et que les images trop séduisantes sont des pièges à éviter. Il veut d’abord sentir la tension, s’engloutir dans le paysage, se faire oublier. Son regard, avant d’être celui du professionnel — cadre, exposition, angle, vitesse —, est d'abord celui du curieux. Il parle peu ou, plutôt, il ne perd pas de temps avec les mots. Quand il travaille, son silence n'est pas celui d’un taciturne mais le simple effet de la concentration. Il pense avec ses yeux. Photo ou pas, le regard est juste. Avec lui, j'apprends à penser en images. A voir ce qu’il voit. A ne pas accrocher des mots aux signes mais, comme lui, à regarder d'abord avant de conclure. La technique ne commande pas. Elle suit. Elle met en forme. Mise en phrases ou mise en boîte, c'est du pareil au même.
Ce que je savais de l’Iran — ma petite collection de faits ramassés en deux ans de «couverture» — eût rempli un honorable volume. Les connaissances d’Alain Bizos sur le sujet étaient voisines de zéro. Du coup il ne posait que de bonnes questions. Nous partagions la même ignorance fondamentale mais la mienne, moins immédiatement visible, m’interdisait les vraies surprises. Les vingt-quatre jours passés à Téhéran, Qom ou Ispahan, du 11 juillet au 4 août 1981, ne m’apprenaient pas grand chose. J’aurais pu rédiger mon article à Paris avec un paquet de journaux et les dépêches de l'agence France-Presse.
Le mois n'était pourtant pas avare d’événements. Journaliste de quotidien, je n'aurais pas eu de peine à dicter un article chaque soir. La « troisième révolution » proclamée par Khomeiny avec la déchéance du président Bani-Sadr exaspérait les frustrations accumulées depuis trente mois. Terrorisme et contre-terrorisme ne semblaient plus obéir qu’à une logique démente dans laquelle fins et moyens étaient inextricablement confondus. Mourir ou tuer devenaient la « cause » elle-même. La dramaturgie de l'Islam chiite n’était plus seulement le jeu tragique par lequel le croyant s’identifie aux héros mythiques de sa foi mais le principe d’une violence immédiate et sanguinaire. En tenir la chronique eût été un exercice périlleux mais finalement rassurant. L'ordre de l’événement se suffit à lui-même. Qu’importe que nous ne comprenions pas. Les faits sont les faits.
20 juin, Bani-Sadr est déchu. 28 juin, l’état-major du Parti de la République islamique est anéanti sous les ruines de son immeuble. 24 juillet, Mohammad Ali Radjaï est élu président de la République islamique. Entre-temps les tribunaux révolutionnaires ont fait fusiller quelques centaines d’opposants. Les attentats se sont multipliés. La guerre continue entre l’Iran et l’Irak. Les affrontements ont repris au Kurdistan (ont-ils jamais cessé ?). La production pétrolière s’établit à 800000, 1 000 000, 1 200 000 barils par jour...
Ce n’est pas, bien sûr, ce qu'on nous demandait. Quand l'article paraîtrait d’autres événements auraient depuis longtemps recouvert ceux dont nous avions été les témoins. Et nous ne savions évidemment pas que le président Radjaï serait alors un nouveau « martyr », que Bani-Sadr et Massoud Radjavi finiraient par trouver refuge en France, que les fusillades atteindraient un rythme qui laisserait les horreurs commises par le régime Pahlavi loin derrière. On veut comprendre, avait dit le rédacteur en chef. Vous ne pouvez rien comprendre, répétaient à l'infini nos interlocuteurs iraniens. Nous nagions en pleine folie.
La photo qu’Alain Bizos n’a pas prise dans le Parc, ce couple entr aperçu à un carrefour sont pour le lecteur des anecdotes d’un piètre intérêt. Elles nous ont révélé, à nous, l’étendue des dégâts. Je ne sais pas si, livré à moi-même et à ma schizophrénie professionnelle, j’aurais entendu aussi nettement l'avertissement. Ici, le regard du photographe était décisif. Piégé par sa curiosité sans préjugé, Alain Bizos identifiait le mal qui nous rongeait. Seul j’aurais dédaigné les signes, si même je les avais vus. Je n’aurais pas compris que j'avais déjà accepté la logique de mon exclusion. J'aurais superposé les images, substitué l’analyse à l'impression, utilisé tous les recours de l’expérience et de l’histoire. Bref, j’aurais manqué l’essentiel, le seul fait véritable, évident, tangible : l’ordinaire de notre vie, de notre monde, de notre culture était devenu extraordinaire dans les rues de Téhéran. Nous trouvions exotique ce que les militants de l’islamisation totale dénonçaient comme scandaleux et corrupteur et c’était une manière de leur donner raison.
Ainsi est née l’idée non pas de ce livre mais de ce qui allait le devenir. Peut-être ne pouvions-nous pas comprendre, au moins devions-nous comprendre ça. Arrêter de demander : «Comment peut-on être Persan ? » pour nous interroger nous-mêmes. Comprendre d’où et par qui nous étions exclus. Questionner non plus l'Iran mais nos images de l’Iran, notre manière de voir et de nous déplacer en Iran. Ne plus avoir peur de notre naïveté, de nos aprioris, de nos angoisses. Ne pas les revendiquer comme des bannières ni les brandir comme des armures mais ne pas non plus chercher à les cacher.
Comme l’avait écrit un jour Jean-Claude Guillebaud pour ponctuer son Voyage vers l’Asie, «peut-être bien après tout qu’à trop redouter de ne pas comprendre nous finissons par oublier de voir ; qu'à force de cacher nos émois naïfs sous un langage de rats morts, par prudence ou par fatigue de l'âme, nous ratons de plus en plus l’essentiel ». Quitte à découvrir que l’essentiel était notre absence dans le paysage où nous étions pourtant tellement voyants. Alors, tant pis. Je ne brandirai pas mon flambeau dans la nuit de l’Iran. Je ne proposerai ni des clés ni la lumière. Je ne dirai plus : « Voilà la Vérité, faites-en ce que vous pouvez. » Je raconterai un voyage.
Ce ne sera pas non plus un récit de voyage. Pas l’histoire d'une aventure ni l’aventure d’une histoire. Non, un voyage dans l’espace et le temps de mes propres reportages. On me taxera d’impudeur et d'outrecuidance, les bonnes âmes diront que j’ai enfin jeté le masque, cédé à la mode, à l’occidentalo-centrisme, à l’impérialo-centrisme, au nombrilo-centrisme et à tous les péchés capitaux du journaliste-voyeur. Tant pis pour les bonnes âmes.
Je dirai ce que j’ai vu, ce que j’ai su ou pu vérifier, ce que j’ai appris mais aussi tout le reste : ce que je n’ai pas su voir, ce que j’ai cru comprendre, ce qui m’est passé par la tête, même si on doit en conclure que la tête était décidément malade. Ce sera une sorte de roman-vérité. Le héros en sera un pays en proie à l'un des ouragans les plus dévastateurs de l’histoire. Ni positif, ni négatif.
Vérité ne signifie ici que le contraire de fiction. Ce sera la vérité du narrateur qui, s’il ne sait pas grand-chose et s’il n’a rien compris, sait au moins qu'il n'est pas le messager du Vrai mais que l'histoire qu'il ne sait pas déchiffrer est encore la sienne. Qui sait aussi qu’il ne peut pas s’en absenter. Et qui l’avoue.
L’avion de la Lufthansa venait de se poser à Francfort. Nous avions deux heures à tuer avant de prendre la correspondance pour Paris. Autour de nous tout était clean, prospère, moderne, électronique. Nos compagnons de voyage iraniens erraient au milieu des duty-free shops. Deux femmes en tchador circulaient parmi les voyageurs en transit et personne ne se retournait sur elles. A six heures de Téhéran, nous avions atterri chez nous. Quelque part vers la fin du XXe siècle. Et je me demandais ce que j’aurais pu écrire si j’étais arrivé dans la même ville cinquante ans plus tôt. Probablement que les fonctionnaires de la Propaganda staffel y expliquaient alors aux reporters : « C’est dommage pour vous mais vous ne pouvez rien comprendre. » Et c’était vrai. Comment pouvait-on être Allemand ?
I
L’Iran de ma mémoire était celui des turbulences estudiantines de la fin des années 60, des manifs à l’ambassade, près du Trocadéro, traditionnellement dispersées à coups de matraques et de lacrymos. Je me souvenais que le 68 ouest-berlinois annonciateur du Mai français avait commencé par la mort d'un étudiant dans une manifestation organisée contre une visite du chah en Allemagne fédérale. L'Iran c’étaient les détenus émasculés ou énucléés vivants, grillés vifs sur des plaques chauffées à blanc, c’étaient les fusillades sommaires et les assassinats, c’était la Savak, l’horreur.
A l’aube du 17 janvier 1979, les haut-parleurs du Boeing d'Air France diffusaient la sixième symphonie de Mahler quand l’avion s'est posé à Téhéran. C’était mon premier voyage en Iran. J'arrivais une douzaine d’heures après que le chah eut quitté son pays pour un exil définitif.
L’Iran c’était aussi une gigantesque mare à pétrole, le « gendarme du Golfe », un régime sauvage et barbare courtisé par le monde entier pour son naphte, ses pétrodollars en mal d’investissements et son marché d’avenir où se bousculaient tous les États sans considération d’idéologie, Anglais et Américains, Allemands et Japonais, Russes et Chinois, Français et Italiens, Grecs et Suédois, Israéliens et Sud-Africains.
Paradis des prébendes et de la corruption, luxe délirant sur fond de misère et d’analphabétisme, Persépolis et Chiraz où le gratin mondial de la jet-set politico-culturelle venait célébrer les mérites de Farah Diba, tandis que l’armée nettoyait à la mitrailleuse les villages en révolte.
Le 17 janvier je découvrais l’Iran de la grève générale et de la révolution. J’écrivis mon premier article le lendemain...
|