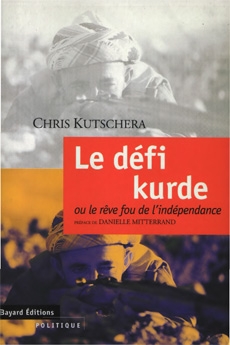| Introduction
Il n'y a pas d'histoire plus paradoxale que celle du peuple kurde: formant, depuis l'Antiquité, un peuple à part, vivant sur un territoire bien déterminé, avec sa langue, sa culture, sa religion, ses traditions, les Kurdes sont aujourd'hui plus de 25 millions*, mais ils demeurent pourtant un peuple sans patrie, une nation sans État. Alors que l'Organisation des Nations unies admet en son sein de nouveaux pays qui ne comptent que quelques centaines de milliers d 'habitants, les Kurdes n'ont pu faire jouer en leur faveur ce «droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» qui, pour ces mêmes Nations unies, fait partie des droits de l'homme(1).
Conspiration de l'histoire? Ou échec tragique dû à des faiblesses inhérentes au peuple kurde? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une nation? Et comment naît-elle? «On ne saurait guère penser une nation anonyme », écrit l'historien Marc Bloch(2): bien avant l'éveil des nationalités en Europe, des siècles avant que ne soient forgés les mots «Français », «Anglais», «Allemand », le mot «Kurde» apparaissait sous la plume des historiens grecs, puis arabes ou persans.
L'antagonisme contre l'« étranger », autre facteur qui concourt puissamment à développer le sentiment national, n'a pas manqué de jouer en faveur des Kurdes, comme le montre cette remarque du géographe Abou Ishak al-Farsy, qui écrivait au Xe siècle de notre ère: «Les Kurdes sont des gens qui habitent dans nos contrées, mais qui sortent de la catégorie de l'espèce humaine: on a rassemblé des fragments du monde entier, que l'on a pétris, et dont on a formé le Kurde. » Les Kurdes, il est vrai, sont différents des peuples qui les entourent: aryens, ils se distinguent à la fois des Arabes, sémites, et des Turcs, mongols. En très grande majorité sunnites, ils se démarquent aussi au plan religieux des Persans, aryens comme eux, mais chiites.
Sans aller jusqu'à affirmer, comme l'ont fait certains auteurs, que «la langue, c'est la nation», force est de noter que la langue kurde est certainement l'un des ciments de l'identité du peuple kurde sur lequel se sont développées deux cultures fortement imbriquées: une culture «classique », qui a produit des chefs d'œuvre comme le Mem-O-Zin, d'Ahmed Khani (1591-1652), et une culture populaire, l'une des plus florissantes du bassin méditerranéen, par la place qu'elle réserve en particulier aux récits épiques - ces «livres d'histoire des personnes qui ne savent pas lire(3)» et qui forment la « mémoire collective» des nations.
On ne peut pas non plus souscrire à l'affirmation d' Antoun Saada: «La terre est la nation(4)», mais on ne peut nier que l'environnement géographique dans lequel ils ont vécu a façonné l'âme des Kurdes et déterminé le cours de leur histoire: n'eussent été ces montagnes au climat rude qui leur servaient de refuge, les Kurdes auraient probablement été balayés depuis longtemps de la surface du globe par les hordes barbares qui ont dévasté l'Asie Mineure pendant des siècles.
Mais à toutes ces tentatives de définition de la nation, il manque un élément essentiel, celui que Mancini, écrivain italien du XIXe siècle et chantre de l'unité italienne, ajoute à ceux qui sont cités classiquement: une nation est «une société naturelle d'hommes amenés par l'unité du territoire, d'origine, de coutume et de langue à une communauté de vie et de conscience sociale(5) ». C'est de cette conscience sociale que découle selon Mancini la «conscience nationale».
Tout le problème des Kurdes réside dans cette difficile transition: l'histoire que nous allons retracer ici est jalonnée de leurs tentatives pour cristalliser leur fort sentiment d'identité en un mouvement national organisé, et pour se donner une véritable conscience nationale. Schématiquement, on peut distinguer trois phases dans la structuration du mouvement national kurde, trois phases qui d'ailleurs se superposent parfois: une phase féodale, une phase religieuse, une phase politique.
On dispose de très peu de documents sur les débuts du nationalisme kurde, au XIXe siècle. En effet, si la Turquie était alors sillonnée de voyageurs qui la parcouraient en tous sens – chose impossible un siècle plus tard quand le Kurdistan de Turquie deviendra une des régions les plus fermées du monde -, ces explorateurs étaient pour la plupart des religieux envoyés par des missions catholiques françaises, par l'archevêque de Canterbury ou par l'American Board of Missions. Et ils se préoccupaient exclusivement du sort des chrétiens d'Orient. L'un d'eux, toutefois, nous a livré un témoignage unique sur l'état d'esprit des Kurdes à la fin de la première moitié du XIXe siècle: «Comme je demandais aux Kurdes que je rencontrai pourquoi ils étaient si nombreux à se rebeller, ils répondaient tous: que pouvons-nous faire? Si nous descendons dans la plaine pour y construire des villages, planter de la vigne, semer du blé et de l'orge et labourer un sol aride, nous sommes tellement écrasés d'impôts et taxes divers (par les Ottomans) que notre travail, béni par Dieu, ne nous est d'aucun profit. Nous restons pauvres et misérables, et sommes soumis à la tyrannie la plus impitoyable. L'impossibilité de satisfaire nos maîtres rapaces est considérée comme un crime. Nos villages sont rasés, même nos lits et nos outils nous sont enlevés, certains des nôtres sont assassinés, et les autres sont emmenés en captivité [... ]. Alors que nous reste-t-il ? Nous abandonnons nos foyers et cherchons refuge parmi nos frères dans les montagnes qui sont plus à l'écart de l'oppression. Mais, même là, nous risquons chaque année d'être chassés comme des perdrix. Tel est notre sort(6).»
Cette longue plainte résume parfaitement le sentiment de révolte des Kurdes devant une oppression essentiellement économique. Mais, apparemment, pas de trace alors de «conscience nationale». C'est pourtant peu avant cette époque que se situe la brève épopée de l'émir Bedir Khan, qui, de 1844 à 1846, gouverne un royaume kurde s'étendant de la Perse jusqu'au Tigre. Comment l'émir Bedir Khan parvient-il à transformer ce sentiment de révolte, qui n'aurait dû déboucher que sur des soulèvements sans conséquence, ne dépassant pas le stade des «jacqueries paysannes », en un mouvement national?
Le charisme extraordinaire qu'il exerce sur les tribus kurdes joue certainement un rôle déterminant: partout les villageois le vénèrent «presque comme un second Mahomet»(1), et les paysans apprécient en lui son sens de la justice, son «intégrité inflexible». Tous les Kurdes rencontrés par les missionnaires se déclarent convaincus que personne n'a jamais pu l'acheter quand il a rendu justice(8).
Par ailleurs, l'émir Bedir Khan, issu d'une des plus anciennes familles du Kurdistan, mais dont les débuts furent difficiles, aréuni, dans des circonstances inconnues, une fortune «incalculable ». Elle lui permet de donner à tous les Kurdes qui n'en ont pas les moyens une somme suffisante pour acheter un fusil, une épée et un bouclier. Or, les historiens savent bien qu'une étape décisive dans la constitution d'un État est franchie lorsque le roi ou le prince dispose d'une fortune sans commune mesure avec celle de ses vassaux ou rivaux, et grâce à laquelle il peut entretenir soldats et fonctionnaires ...
Quel était exactement le projet politique de l'émir Bedir Khan? À moins de découvrir des documents inédits encore enfouis dans des archives, on ne le saura probablement jamais. Toujours est-il qu'il sut satisfaire l'aspiration fondamentale des Kurdes en leur donnant un embryon d'État où régnaient l'ordre et la justice, à une époque qui se caractérisait par la corruption effroyable de l'administration ottomane. C'est d'ailleurs ce que constatent les voyageurs étrangers, tel cet agent consulaire français qui traverse le «royaume» de Bedir Khan en 1845, et qui écrit à son propos: «C'est un prince sévère mais équitable. Aussi, règne-t-il sur son territoire une sécurité parfaite et une apparence de bien-être qu'on chercherait vainement dans les provinces voisines soumises à l' autorité turque(9).»
L'épopée de Bedir Khan coïncide avec la fin de l'âge d'or de la féodalité kurde: en ce milieu du XIXe siècle, le Kurdistan, alors presque intégralement situé en Turquie, ressemble encore au Kurdistan décrit au XVIe siècle par le prince kurde de Bitlis dans son célèbre Cheref Nameh(10) L'administration ottomane y est presque inexistante, sauf dans quelques rares grandes villes, et se réduit à des expéditions militaires à but fiscal. Le Kurdistan reste un pays impénétrable, dépourvu de routes; dans des vallées isolées les unes des autres par des chaînes de montagnes presque infranchissables, des seigneurs vivent dans des châteaux comparables aux châteaux du Moyen Âge européen et gouvernent des tribus qui partagent leur temps entre la culture, la chasse et la guerre.
Jamais l'identité kurde ne s'affirmera autant culturel sur le plan. Et le mérite de l'émir Bedir Khan est d'avoir su cristalliser par son charisme cette identité et regrouper la plus grande partie d'une ethnie, jusqu'alors fragmentée en tribus, dans le cadre d'un État, aussi embryonnaire fût-il. À ce titre, il reste le père fondateur du nationalisme kurde.
Après l'échec de Bedir Khan et son exil (1847) à Candie et à Damas où il est rejoint par de nombreux princes kurdes, la société kurde est pratiquement décapitée. La structure tribale demeure, mais privée de ses chefs. Une nouvelle classe de dirigeants prend alors la relève: ce sont les «cheikhs », chefs religieux issus des confréries mystiques kadiri et nakchbendi, dont le prestige repose, comme pour les chefs féodaux de l'époque précédente, sur une généalogie glorieuse, mais également sur un pouvoir, d'autant plus illimité que par définition il échappe au domaine du visible et du rationnel. «Un cheikh connaît tous les secrets et écoute tous les coeurs; il est tout puissant en esprit et en corps; il va intérieurement, comme ils disent, à la guerre, quand tout autour de lui est silence [... ]. La nuit, il monte son coursier, tandis qu'il ne quitte pas son lit, et fendant les airs avec la rapidité de l'éclair, il franchit des espaces incommensurables [... ]. Il ne s'arrête que devant les rangs ennemis, en pleine armée des infidèles, qu'il perce de ses dards et accable de ses coups. Après les avoir exterminés, il rentre triomphant et regagne en un clin d'oeil sa demeure, toujours invincible et toujours invulnérable(11).»
C'est à cheikh Obeidalla, l'un de ces faiseurs de miracles et de gullabend (talisman) qui dirigeront le mouvement national kurde pendant un demi-siècle, que revient le mérite d'avoir rédigé en 1880 le premier «manifeste» connu du nationalisme kurde, dans lequel il déclare notamment: «Le peuple kurde est un peuple à part [... ]. Nous voulons que nos affaires soient entre nos mains (12).»
Jamais sans doute, la misère du peuple kurde n'a été plus grande: à l'oppression et aux exactions de l'administration ottomane s'ajoutent les ravages des trois guerres russo-turques (1829, 1854, 1877-1878), puis ceux de la Première Guerre mondiale (1914-1918). Frappés par la conscription, les Kurdes voient leur pays détruit par les armées en campagne. La famine sévit au Kurdistan. Plus que jamais les Kurdes aspirent à vivre en paix. Ils veulent l'ordre et la loi. Et puisque les Ottomans ont fait la preuve de leur incapacité à gouverner le pays, ils ne voient de terme à leurs malheurs que par l'intervention de ces «envoyés de Dieu», que sont les cheikhs.
On peut se demander comment ces hommes extrêmement religieux ont pu prendre les armes contre le sultan-calife, alors que traditionnellement l'islam est plutôt un facteur dénationalisant: c'est que dans le milieu très fruste des confins turco-persans, la personne des cheikhs qui étaient à la tête des confréries mystiques était plus sacrée que celle du sultan! Et au Dersim chiite (alévi) la question ne se posait même pas car les Alevis considéraient le sultan sunnite comme un oppresseur (voir troisième partie, chap.5).
En contact épistolaire ou direct avec des missionnaires et des consuls européens ou américains, ces chefs religieux se révèlent étonnamment ouverts au monde occidental, et ils ont tôt fait de lui emprunter ses idéaux pour les opposer au désordre ottoman. Il en est ainsi de acheikh Obdeidalla, qui élabore dans sa correspondance avec le Dr Cochran, un missionnaire américain basé à Ourmié, ses projets pour la «nation kurde ». Ou encore de cheikh Abdessalam II de Barzan, homme remarquable qui, malheureusement pour ses compatriotes, sera pendu par les Turcs à la veille de la Première Guerre mondiale. Il est, lui aussi, en contact avec des missionnaires auxquels il fait part de son désir de construire des écoles dans les villages. Lorsque des officiels anglais viennent lui rendre visite, cheikh Abdessalam II tient tant à convaincre en personne le roi George V de la nécessité de résoudre la question kurde, que ses visiteurs sont obligés de le quitter à la sauvette pour éviter de l'emmener avec eux. « Vous êtes allés aux Indes, et vous y restez, alors qu'on ne veut pas de vous. Pourquoi ne voulez-vous pas venir chez nous qui voulons de vous? Vous seriez les bienvenus partout ici» 13, leur répétait cheikh Abdessalam.
Cette admiration irraisonnée pour l'Occident se perpétuera chez les chefs kurdes et sera fatale au général Barzani, le petit frère de cheikh Abdessalam II. Mais ce dernier ne s'est pas contenté de rester les yeux tournés vers l'Occident. Il est aussi celui qui rédigera le premier «programme» du mouvement national kurde, dans lequel il dresse une liste de revendications extraordinairement précises: l'adoption du kurde comme langue officielle dans les cinq districts kurdes; l'adoption du kurde comme langue d'enseignement; la nomination de fonctionnaires parlant kurde; la nomination de cadis (juges) et muftis chaféites (alors que les Ottomans les choisissaient dans le rite hanafi); la suppression de tous les impôts et taxes. non conformes à la charia; l'utilisation des taxes prélevées par l'administration pour l'entretien des routes des districts kurdes(14). On reste confondu devant la précision de ce programme formulé dans un télégramme envoyé en 1908 au gouvernement et au parlement ottomans.
Mais c'est à cheikh Mahmoud Barzinji qu'il revient de faire la synthèse entre les aspirations plus ou moins confuses des Kurdes et la conception occidentale du droit à l'autodétermination. Alors que pendant toute une décennie il se montre l'adversaire le plus résolu des Britanniques dans la partie du Kurdistan attribuée à l'Irak, il récitera sur son lit d'hôpital le douzième point du président Wilson et la déclaration franco-britannique du 8 novembre 1918, dont une traduction en kurde, «écrite sur des feuilles du Coran était attachée, comme un talisman, à son bras»(15).
Ce douzième point du «Programme de la paix du monde» stipule qu'aux régions turques de l'empire ottoman devront être garanties la souveraineté et la sécurité; «mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devra garantir une sécurité absolue d'existence, et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome, sans être aucunement molestées».
Quant à la déclaration franco-anglaise du 8 novembre 1918, elle annonce que 1'heure d'une « libération complète et définitive» a sonné pour les peuples soumis à la domination ottomane, qui vont pouvoir enfin établir un «gouvernement national puisant son autorité dans le libre choix de la population indigène». C'est en s'appuyant sur ces principes venus d'un Occident qu'il admire que cheikh Mahmoud se battra pour les droits des Kurdes de 1918 à 1930.
On ne sait malheureusement presque rien des motivations de cheik Saïd (1925), mais on connaît une lettre de Seyid Reza (1937) qui fournit des indications précieuses sur le but du soulèvement du Dersim: «Trois millions de Kurdes se trouvant dans leur pays et ne demandant qu'à vivre en paix et en liberté en conservant leur race, leur langue, leurs traditions, leur culture et leur civilisation, par ma voix s'adressent à votre Excellence et vous prient de faire bénéficier le peuple kurde de la haute influence morale de votre gouvernement pour mettre fin à cette injustice cruelle'6.» On est très loin de l'«obscurantisme religieux » qui, selon le gouvernement d'Ankara, serait à l'origine de ces soulèvements.
Grâce à leur charisme, ces chefs religieux ont unifié les tribus kurdes et les ont mobilisées en formulant pour la première fois de façon précise les aspirations plus ou moins confuses du peuple kurde telle le droit à déterminer librement son propre destin. Mais leurs soulèvements n'ont été que des feux de paille et leurs rébellions ont été rapidement écrasées dans le sang. Malgré la présence à leurs côtés de quelques intellectuels, les chefs religieux ne s'appuyaient pour leur lutte armée que sur des coalitions tribales qui se défaisaient aussi vite qu'elles se faisaient. Il manquait encore au mouvement national kurde un élément essentiel: ces partis, qui développent la conscience politique et organisent la lutte sur un programme.
Les premiers partis politiques kurdes naissent dans l'équivoque: fondés par le petit bataillon d'intellectuels, de grands bourgeois et d'aristocrates, qui forment au début du siècle l'intelligentsia du peuple kurde, ces partis ou plus exactement ces clubs reflètent la mentalité d'une élite dont la culture est avant tout ottomane. Certains membres de cette élite ne parlent même pas le kurde, ou mal. Leur langue de culture est le turc. Leur attachement à l'islam est également une source d'ambiguïté: pour les cheikhs qui vivent au milieu de leur peuple, l'islam crée des liens spéciaux entre eux et leurs fidèles par le réseau des confréries; mais pour les grands bourgeois qui résident à Constantinople, l'islam est un lien supplémentaire au sultan-calife, et il leur est difficile de s'arracher au culte des grands idéaux de piété et d'unité de l'empire. Comme le remarque très justement Bloch: «Ce ne fut point parmi les hommes les plus instruits que put naître le sentiment national»(17).
Malgré tout, quels que soient leurs défauts, ces hommes ont le mérite de comprendre que la lutte des Kurdes pour leurs droits - autonomie ou indépendance, ils ne sont pas tous d'accord sur ce point - n'a de chance d'aboutir que si l'on réveille la conscience des Kurdes, et qu'il faut pour cela développer leur éducation et créer un lien organique entre l'élite et ces milieux plus frustes en qui somnolent les «obscurs préludes de la nationalité» (18).
Les premiers clubs fondés en 1908 ont donc pour nom: «Association pour le développement et le progrès du Kurdistan» ou «Association pour la propagation de l'éducation parmi les Kurdes ». Après la Première Guerre mondiale, les Kurdes de Constantinople fondent une nouvelle «Association pour le relèvement du Kurdistan », dont l'expression politique est le «Parti démocratique kurde» (PDK), dont le nom sera repris vingt-cinq ans plus tard par les nationalistes kurdes de Souleimania et de Mahabad.
Les dirigeants de cette association sont des notables, comme le sénateur Abdel Kader, le fils de cheikh Obeidalla, président du Conseil d'État, et le colonel Khalil bey, chef de la police de Constantinople. Comme le fera remarquer un demi-siècle plus tard l'émir Kamuran Bedir Khan, «la plupart avaient un pied dans le camp kurde et l'autre dans le clan ottoman et islamique» (19).
Des clubs s'ouvrent également dans les principales villes du Kurdistan ottoman, à Malatia, Mardin, Kharpout et Diyarbekir, assurant une certaine diffusion aux revendications des Kurdes, à travers notamment leur premier journal, Jin. Mais très vite les dirigeants des clubs se divisent sur la définition des objectifs de leur lutte: l'autonomie dans le cadre de l'empire ottoman ou l'indépendance. Et le conflit qui déchire les clubs de Constantinople encette année 1920 se déroule selon un scénario qui se répétera, toutes proportions gardées, quarante-cinq ans plus tard, avec d'une part le général Barzani et d'autre part les groupes des intellectuels d'Ibrahim Ahmed et Jelal Talabani.
Le clivage oppose en effet les «féodaux », partisans de l' autonomie, en la personne du sénateur Abdel Kader, aux «intellectuels », partisans de l'indépendance, avec l'émir Emin Ali Bedir Khan, et Memdouh Selim, le secrétaire général du Parti démocrate kurde. Usant du prestige dont jouit son père, le sénateur Abdel Kader obtient des guildes kurdes de Constantinople (les couches les plus humbles de la population: porteurs d'eau, portefaix, etc.) une déclaration affirmant qu'il est seul habilité à parler au nom des Kurdes. Les intellectuels ripostent en excluant purement et simplement le sénateur Abdel Kader du club dont il était le président. A l'argument d'autorité de l'un, les autres opposent une décision arbitraire. Les questions de personne et de principe sont confondues, et, dans cette première tentative d'organisation politique, les notions de débat démocratique, de majorité et de minorité, de respect des droits et d'obligations sont ignorées. Se trouve ainsi instauré ce qui deviendra malheureusement une tradition dans le mouvement kurde.
À la même époque, les mêmes hommes manifestent un autre penchant, qui se révélera tout aussi néfaste au mouvement kurde, et que l'on retrouvera avec le général Barzani: la recherche d'un « protecteur». Mus comme cheikh Abdessalam ou comme cheikh Mahmoud par leur profonde admiration pour l'Occident, les dirigeants des clubs kurdes de Constantinople vont jusqu'à croire, à la différence de leurs prédécesseurs, que l'autonomie ou l'indépendance du Kurdistan doit leur être «octroyée ». Mais comme l'écrit un haut fonctionnaire du Foreign Office, « le rêve du jeune parti kurde d'être mis, aux frais, en hommes et en argent, d'une puissance étrangère, à la tête d'un État kurde formé pour eux est un rêve impossible» (20).
Naïveté à l'égard du jeu des grandes puissances? Peut-être. Mais l'on peut s'interroger en tout cas sur la pureté de leurs motivations: ces exilés qui vivent dans la capitale de l'empire ottoman n'oublient jamais, dans le «marché» qu'ils proposent aux grandes puissances, de rappeler leur candidature à la couronne du futur royaume kurde ... Mal leur en a pris, car ils ont été balayés par la révolution kémaliste et par le jeu des grandes puissances, lesquelles n'ont jamais cru bon de tenir leur promesse, pourtant incluse dans le traité de Sèvres (1920), d'accorder l'« autonomie locale pour les régions où domine l'élément kurde ».
La première tentative pour structurer le mouvement national kurde, et lui intégrer des éléments essentiellement occidentaux, se solde donc par un piteux échec. Les notions de nation, de droit à l'autodétermination, d'indépendance et d'autonomie, restent des mots utilisés dans les salons par des leaders totalement coupés des masses kurdes.
Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour voir apparaître au Kurdistan d'Irak et au Kurdistan d'Iran de véritables partis politiques avec la naissance de Hewa en Irak (1941) et du Komala en Iran (1942), précurseurs des partis démocratiques du Kurdistan, le PDK iranien (1945) et irakien (1946). Comme on le verra plus loin, le mouvement national kurde acquiert, en Irak surtout, une autre dimension, avec l'influence d'une idéologie entièrement nouvelle: le socialisme. Toutefois, elle ne suffira pas à fédérer l'ensemble des Kurdes qui vont multiplier les partis et se déchirer dans des luttes intestines.
Les Érythréens ont arraché leur indépendance après trente ans de lutte armée. Les Palestiniens viennent d'obtenir l'autonomie pour une partie de leur territoire après un demi-siècle de lutte multiforme, allant des guerres israélo-arabes, qui ont failli dégénérer en conflit mondial, jusqu'aux opérations terroristes des fedayins et à l'Intifada ... Pour les Kurdes, qui se battent depuis plusieurs décennies, l'indépendance reste un mirage qui s'évanouit chaque fois qu'il est sur le point de se concrétiser. Cela avait déjà été le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le traité de Sèvres qui prévoyait l'autonomie, et éventuellement l'indépendance pour une partie des Kurdes. Cela se reproduit aujourd'hui, quand l'indépendance de facto dont jouissent les Kurdes d'Irak depuis la deuxième guerre du Golfe risque de sombrer avec le suicidaire combat des chefs qui ravage le Kurdistan.
Cependant, dans ces trois mouvements nationaux, 1'héritage de la lutte armée est pesant, si pesant que l'on peut se demander si l'indépendance qui en résulte n'est pas un fruit empoisonné: en Palestine, à peine les premières institutions sont-elles mises en place, que l'absence de véritable démocratie consterne les supporters de la cause palestinienne; en Érythrée, le passage du parti unique à la démocratie se révèle laborieux et, cinq ans après la victoire en 1991 du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE), il n'y a toujours pas eu d'élections, la constitution n'est pas encore rédigée, et les lois sur les partis politiques et sur la presse ne sont toujours pas promulguées. Au Kurdistan irakien, les violations des droits de 1'homme commises par les partisans de Massoud Barzani et Jelal Talabani, longuement décrites dans un rapport accablant d'Amnesty International(21), sont tellement monstrueuses que l'on se demande si les Kurdes n'ont pas fini par ressembler à leurs adversaires. «La société kurde est malade », constatait Massoud Barzani, dès l'été 1991. On ne vit pas impunément vingt ans ou trente ans sous une dictature, que ce soit celle du Baas ou une autre. Toute la population rurale kurde, chassée de ses villages et regroupée dans d'immenses camps collectifs, a perdu ses valeurs traditionnelles; dans ces camps comme dans les villes, on ne pouvait survivre qu'en collaborant avec le régime, en devenant mercenaire (jash), dans l'âme ou sous l'uniforme.
La société kurde a été altérée par la dictature, il est vrai, mais ce n'est pas tout: les mouvements de lutte armée ne sont pas des pépinières de démocratie. La discipline, la rigueur, les méthodes employées - qui toutes visent à exterminer l'adversaire -, tous ces ingrédients essentiels de la lutte armée sont incompatibles avec le débat politique. Si idéaliste soit-il, un chef de guérilla doit résoudre tellement de problèmes purement militaires au jour le jour, qu 'il lui est intellectuellement impossible de penser en politique. On ne peut pas, sauf exception historique, être en même temps général et politicien.
Au Kurdistan irakien, les partis politiques kurdes n'ont plus de partis que le nom: ce sont au mieux des mouvements armés, au pire des bandes. Ils ont prouvé, hélas, qu'ils n'étaient pas capables de gérer le politique.
En Turquie, le «Parti des travailleurs du Kurdistan» (PKK) n'échappe pas à cette analyse: si demain, par suite d'un miracle, les Kurdes de Turquie obtenaient ne serait-ce que l'autonomie, il serait sans doute incapable de gérer cette victoire. Le plus militaire, le plus discipliné et le plus rigide de tous les mouvements kurdes, le PKK a admirablement appris à ses membres à se battre et à se sacrifier; mais il n'a jamais toléré l'ombre d'une opposition.Et pourtant, il est évident que sans le sacrifice de plusieurs dizaines de milliers de combattants, l'Érythrée ne serait pas indépendante aujourd'hui; sans les opérations des commandos palestiniens, aucun mini-État palestinien n'aurait risqué de voir le jour; et sans le courage légendaire des maquisards (pechmergas) d'Iran et d'Irak, et des guérilleros de Turquie, la question kurde serait oubliée et les Kurdes en voie d'assimilation.
Alors? Tout le dilemme des Kurdes est là: il leur faut se battre, les armes à la main, mais l'indépendance n'est pas une fin en soi. Cette indépendance dont rêvent tous les Kurdes, dont ont rêvé avant eux les Érythréens et les Palestiniens, que veulent-ils en faire? Mourir? Tuer? Oui, si c'est nécessaire, mais pour bâtir quelle société? Pour quel système économique? Pour quelle culture? Ce sont toutes ces questions que doivent se poser les dirigeants kurdes, -les armes à la main -, en sachant qu'il leur faut les déposer le plus vite possible au vestiaire de la société civile et laisser la place aux politiciens.
* En l'absence de statistiques, on peut formuler les estimations suivantes: en Turquie, 15 millions ; en Iran, 6 millions, en Irak, 4 millions; en Syrie, 1,5 million; en ex-URSS: 500000. |