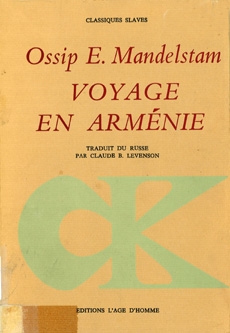
Voyage en Arménie
Ossip E. Mandelstam
L’Age d’Homme
Cette prose est une prose pure, bottée, magique. Elle court comme un torrent sec, inachevée, brusque, insolite. Elle n’a ni sujet, ni héros. La classera-t-on «notes de voyage» ? Mais elle tressaute et divague tant hors du paysage aride et sacré de l’Arménie...
Elle est surtout délectation des rapports visuels et amicaux que l’œil et les sens réservent au poète. Echappé à la «vacuité citrouillesque» de la Russie, Mandelstam mange l’Arménie comme un pain azyme rêche et succulent. Il se délecte de l’altitude, de la langue magique «aux bottes de pierre», de l’antique simplicité des mœurs de cette république soviétique contemporaine d’Homère. Aux pieds de l’Ararat il éprouve la jubilation des civilisations méditerranéennes, celles où l’homme, proche de la vigne, est bon, prodigue et aime le «clair didactisme de la conversation amicale».
L’œil perçant du poète «émiette et brise» ses dents sur la sauvage harmonie des églises arméniennes. Ecœuré de l’Europe «au minerai phonétique tari» son oreille s’enivre des magiques grappes sonores des langues caucasiennes.
Frémissant, le poète court sur «l’impudent incendie» des mots et des métaphores, contant son enthousiasme pour la feuille de capucine et les planches de Linné ou de Pallas. Il nous entraîne dans la splendide hiérarchie des naturalistes, cette encyclopédie végétale et animale belle comme un code de lois ...
SEVAN
Sur l’île de Sevan, qui se distingue par deux monuments architecturaux inestimables du VIIe siècle ainsi que par les huttes de pisé des ermites pouilleux morts depuis peu, envahies d’orties et de chardons, et guère plus effrayantes que les celliers abandonnés, j’ai vécu un mois, me délectant des quatre mille pieds d’altitude des eaux du lac et m’exerçant à contempler deux-trois dizaines de tombeaux disséminés en parterre au milieu des monastères rajeunis par les réparations.
Chaque jour à cinq heures précises, le lac riche en truites bouillait, comme si l’on y avait jeté une grosse pincée de soude. C’était, dans le plein sens du terme, une séance mesmérienne de changement du temps, comme si un médium lâchait dans l’eau de chaux jusqu’alors tranquille d’abord une houle stupide, puis un bouillonnement d’oiseaux et enfin une impétueuse lubie ladoguienne.
Impossible alors de se refuser le plaisir de compter trois cents pas sur l’étroit sentier de la plage, face au sombre rivage huninguien.
Ici, le Goktcha forme un détroit cinq fois plus large que la Néva. Un splendide vent fade s’engouffrait en sifflant dans les poumons. La vitesse du mouvement des nuages croissait de minute en minute et le ressac-imprimeur se hâtait d’éditer à la main en une demi-heure une bible grasse de Gutenberg sous le ciel lourdement renfrogné.
Pas moins du soixante-dix pour cent de la population de l’île était constitué d’enfants. Comme de petits animaux sauvages, ils grimpaient sur les tombes des moines, soit bombardaient une pacifique souche immergée prenant ses tressaillements glacés sur le fond pour les convulsions d’un serpent de mer, soit apportaient des bouges humides couleuvres et crapauds bourgeois aux têtes féminines délicatement ciselées, soit faisaient tourner en bourrique un bélier affolé qui ne pouvait absolument pas comprendre qui son pauvre corps gênait-il, et secouait sa queue engraissée à loisir.
Les hautes herbes des steppes sur la bosse venteuse de l’île de Sevan étaient si puissantes, si juteuses et si orgueilleuses qu’on avait envie de les peigner avec un peigne de fer.
Toute l’île est jonchée, comme chez Homère, d’ossements jaunis — reliefs des pieux pique-niques des gens des alentours.
En outre, elle est littéralement dallée de pierres tombales sans nom, rouge feu — dressées, branlantes et effritées.
Tout au début de mon séjour arriva la nouvelle que des terrassiers qui creusaient les fondations du phare sur la longue et ennuyeuse langue de terre de Samapakert étaient tombés sur un vase funéraire de l’antique peuple des Ourartes. J’avais déjà vu auparavant au musée d’Erévan un squelette recroquevillé en position assise dans une grande amphore de terre, avec un petit trou dans le crâne pratiqué pour l’esprit malin.
Tôt le matin, je fus réveillé par le jacassement d’un moteur. Le bruit faisait du sur-place. Deux mécaniciens réchauffaient le cœur minuscule du moteur défaillant, le remplissant de mazout. Mais à peine était-il remis que l’inlassable rengaine — «pas bu - pas mangé, pas bu - pas mangé» — dépérissait et se noyait dans l’eau.
Le professeur Khatchatourian, au visage tendu d’une peau d’aigle sous laquelle muscles et ligaments se présentaient numérotés et sous des noms latins — arpentait déjà la jetée, vêtu d’une longue redingote noire de coupe arménienne. Non seulement archéologue, mais encore pédagogue de vocation, il avait accompli la majeure partie de son activité en tant que directeur d’école moyenne — au gymnase arménien de Kars. Invité à une chaire de la soviétique Erévan, il avait emmené ici avec lui sa fidélité à la théorie indo-européenne, ainsi que sa stupéfiante méconnaissance de la langue russe et de la Russie, où jamais il n’avait mis les pieds.
Tout en conversant tant bien que mal en allemand, nous nous installâmes dans la chaloupe avec le cde Souren Boudajian — ancien président de l’une des commissions de planification.
Cet homme sanguin imbu de lui-même, condamné à fumer des cigarettes et à passer son temps de manière si peu drôle à lire la «sentinelle littéraire»*, se désaccoutumait avec de visibles difficultés de ses obligations officielles, et l’ennui imprimait de gras baisers sur ses joues rougeaudes.
Le moteur marmonnait «pas bu - pas mangé», comme s’il présentait un rapport au cde Boudajian, la petite île reculait rapidement, redressant son dos d’ours avec ses monastères aux clochers octogonaux. Une nuée de moucherons accompagnait la chaloupe et nous y naviguions, comme dans une mousseline sur le lac matinal et gélatineux.
Dans le trou, nous avons réellement découvert des tessons de terre et des ossements humains, mais aussi un manche de couteau portant le poinçon de la vieille fabrique russe N. N.
D’ailleurs, j’ai enveloppé avec déférence dans mon mouchoir le petit récipient calcaire et poreux d’une quelconque boîte crânienne.
La vie sur toute île — que ce soit Malte, Sainte-Hélène ou Madère — s’écoule en une attente bienheureuse. Cela a son charme et son inconvénient. En tout cas, tout le monde est occupé en permanence, baisse légèrement la voix et est un peu plus attentif aux autres que sur la grande terre avec ses vastes chemins et sa liberté négative.
Le pavillon de l’oreille s’affine et gagne une nouvelle volute.
A Sevan s’était réunie pour mon bonheur une pleine galerie de vieillards sages et racés — l’honorable ethnographe régional I. Iak. S., l’archéologue déjà mentionné Khatchatourian, enfin le chimiste Gambarov pétillant de joie de vivre.
Le chimiste Gambarov parle arménien avec l’accent moscovite. Il s’est allègrement et de bonne grâce russifié. Il a le cœur jeune et un corps sec, efflanqué. Physiquement, c’est un homme fort agréable et un merveilleux compagnon de jeux.
Avec les femmes, c’est un Mazzepa chevaleresque qui caresse Marie uniquement de ses lèvres ; en compagnie masculine, il est ennemi de la causticité et de l’orgueil ; pourtant, s’il se lance dans la discussion, il s’échauffe comme un ferrailleur de terre franque.
L’air des montagnes l’avait rajeuni, il retroussait ses manches et se ruait sur le filet de pêche de volleyball, manœuvrant sèchement de sa petite paume.
Que dire du climat de Sevan ?
— Une valeur-or de cognac dans la petite armoire secrète du soleil de montagne.
La tige de verre du thermomètre campagnard était précautionneusement transmise de main en main. Le docteur Hertzberg s’ennuyait ouvertement sur l’île des matières arméniennes. Il me paraissait être l’ombre blême d’un problème ibsenien ou encore un acteur du M.X.A.T.** dans une maison de campagne.
Les enfants lui montraient leurs langues étroites, les tirant une seconde en tranches de viande d’ours...
Et puis vers la fin, la fièvre aphteuse vint nous rendre visite, apportée dans des bidons de lait du lointain rivage de Zaïnal, où gardaient le silence dans de sombres isbas russes des ex-«khlystiens»*** ayant depuis longtemps cessé d’avoir des transes.
D’ailleurs, pour les péchés des adultes, la fièvre aphteuse frappa uniquement les enfants sans foi ni loi de Sevan.
L’un après l’autre, les gosses bagarreurs à la rude tignasse s’inclinaient de la fièvre mure sur les bras des femmes, sur les oreillers.
Une fois, en compétition avec le komsomol X., Gambarov entreprit de faire à la nage le tour de toute l’île de Sevan. Son cœur de soixante ans céda, et X., lui-même à bout de forces, fut obligé de laisser tomber son compagnon, retourna au point de départ et s’écroula à demi mort sur les galets. Les témoins du malheur furent les murs volcaniques de la forteresse de l’île, excluant toute idée d’amarrage.
L’alarme fut donnée. Pas de cannot à Sevan, bien que le bon d’ordre eût été déjà signé.
Les gens s’agitèrent sur l’île, fiers de savoir qu’un malheur irréparable était arrivé. Le journal qu’on n’avait pas lu commença à cliqueter comme du fer-blanc dans les mains. L’île attrapa la nausée comme une femme enceinte.
Nous n’avions ni téléphone ni pigeon voyageur pour communiquer avec le rivage. La chaloupe était partie environ deux heures auparavant pour Elenovka et on avait beau tendre l’oreille, on ne percevait pas le moindre frémissement sur l’eau.
Quand l’expédition ayant à sa tête le cde Boudajian, emportant une couverture, une bouteille de cognac et le reste, ramena Gambarov engourdi mais souriant, recueilli sur un roc, des applaudissements l’accueillirent. C’était les applaudissements les plus merveilleux qu’il m’ait été donné d’entendre de ma vie : on acclamait un homme pour n’être pas encore un cadavre.
Sur l’embarcadère du port de pêche de Noradouz, où l’on nous mena en une excursion qui se passa heureusement sans les inévitables chansons en chœur, je fus frappé par la charpente galbée d’une embarcation entièrement achevée, nez au vent sur le treuil du chantier. De taille, elle valait un bon cheval de Troie, mais par ses fraîches proportions musicales, elle rappelait le corps d’une bandoura ****.
Alentour frisaient les copeaux. La terre était mangée de sel, et les écailles des poissons scintillaient comme des éclats de quartz.
A la cantine de la coopérative, également en rondins et... tout à fait dans le goût de Pierre-le-Grand, comme tout à Noradouz, on nourrissait sur le tas avec d’épaisses soupes au mouton.
Les ouvriers remarquèrent que nous n’avions pas de vin, et comme il sied à des hôtes parfaits, remplirent nos verres.
J’ai bu de tout coeur à la santé de la jeune Arménie avec ses maisons de pierre orange, à ses jeunes commissaires du peuple aux dents blanches, à la sueur du cheval et au piétinement des queues, et à sa langue vigoureuse dans laquelle nous sommes indignes de parler et dont nous devrions uniquement, compte tenu de notre infirmité, nous contenter de prononcer les mots magiques :
«eau» en arménien — «djour»
«village» — «ghiour».
Jamais je n’oublierai Arnoldi.
Il boitillait sur une pince orthopédique, mais de manière si virile que tout le monde enviait sa démarche.
Les autorités scientifiques de l’île se trouvait sur la route d’Elenovka, professant le molokanisme *****, où dans la semi-obscurité du scientifique comité exécutif bleuissait les gueules de gendarmes de truites géantes conservées dans l’alcool.
Ah, ces invités !
Ils furent amenés à Sevan par un yacht américain, rapide comme un télégramme, fendant l’eau au scalpel — et Arnoldi descendit sur le rivage — un orage de savoir, débonnaire comme Tamerlan.
J’eus le sentiment qu’à Sevan vivait un forgeron qui le ferrait et qui le débarquait sur l’île pour s’aboucher avec lui.
Rien n’est plus instructif ni plus joyeux que de se plonger dans la société de personnes d’une race totalement autre que l’on respecte, pour laquelle on a de la sympathie, dont on est fier de l’extérieur. La plénitude de vie des Arméniens, leur grossière tendresse, leur bienfaisante ardeur au travail, leur inexplicable répulsion pour toute métaphysique et leur merveilleuse familiarité avec le monde des choses réelles — tout cela me disait : tu ne rêves pas, n’aies pas peur de ton temps, ne fais pas le malin.
N’était-ce pas parce que je me trouvais au milieu d’un peuple réputé pour son activité débordante et qui néanmoins vivait non pas en fonction des horloges des gares ou des institutions, mais d’après un cadran solaire comme j’en ai vu dans les ruines de Zvarnodz en forme de roue ou de rose astronomique, inscrit dans la pierre ?
* Revue des écrivains prolétariens.
** Théâtre de Moscou.
*** Ancienne secte religieuse.
**** Sorte de guitare.
*****Courant religieux qui refusait le rite de l’église orthodoxe.
Valentine Marcade
Le Renouveau De L’art Pictural RusseCe livre apporte une mine de documents qui font place nette ! Un milieu est évoqué et, pour la première fois, on plonge dans le problème qu'a été la conquête d'un art pour les Russes. La Russie est un pays qui a eu des œuvres d’art très intéressantes, très valables, mais qui n'a jamais, au fond, joué un rôle prépondérant jusqu’à la période tout à fait contemporaine et qui brusquement a eu, dans les dernières années du XIXe siècle et dans les premières années du XXe, le sentiment qu’il prenait place dans la tête, dans l’avant-garde.
Il s’agit là d’une aventure, d’une aventure intellectuelle et aussi d’une aventure humaine. Le mérite exceptionnel de ce livre est que l’auteur participe encore lui-même à cette aventure de l’art russe. Avec Le Renouveau de F Art pictural russe de Valentine Marcadé, nous avons sous les yeux un fragment, le dernier fragment de cette tentative passionnelle et passionnée des Russes pour prouver, se prouver à eux-mêmes et prouver au monde, qu’ils sont des artistes, qu’ils ont un art, et que leur art est un art qui fraie la voie à celui des autres peuples.
Cela est quelque chose qui est très émouvant et c'est quelque chose qui dépasse d’ailleurs la pure information, mais c’est quelque chose qui n’a été possible que par cette passion que l'auteur a mise à recueillir dans tous les témoignages du passé, d’où qu’ils viennent, le moindre élément qui permet de comprendre comment ce qui est aujourd’hui malgré tout une chose morte a été un jour quelque chose de vivant.
Voilà un livre qui me paraît nécessaire, un livre utile, nouveau, et en même temps un beau livre, un livre passionnant, un livre que l’on lit, et qui donne le goût du sujet.
Pierre Francastel
Cette prose est une prose pure, bottée, magique. Elle court comme un torrent sec, inachevée, brusque, insolite. Elle n’a ni sujet, ni héros. La classera-t-on «notes de voyage» ? Mais elle tressaute et divague tant hors du paysage aride et sacré de l’Arménie...
Elle est surtout délectation des rapports visuels et amicaux que l’œil et les sens réservent au poète. Echappé à la «vacuité citrouillesque» de la Russie, Mandelstam mange l’Arménie comme un pain azyme rêche et succulent. Il se délecte de l’altitude, de la langue magique «aux bottes de pierre», de l’antique simplicité des mœurs de cette république soviétique contemporaine d’Homère. Aux pieds de l’Ararat il éprouve la jubilation des civilisations méditerranéennes, celles où l’homme, proche de la vigne, est bon, prodigue et aime le «clair didactisme de la conversation amicale».
L’œil perçant du poète «émiette et brise» ses dents sur la sauvage harmonie des églises arméniennes. Ecœuré de l’Europe «au minerai phonétique tari» son oreille s’enivre des magiques grappes sonores des langues caucasiennes.
Frémissant, le poète court sur «l’impudent incendie» des mots et des métaphores, contant son enthousiasme pour la feuille de capucine et les planches de Linné ou de Pallas. Il nous entraîne dans la splendide hiérarchie des naturalistes, cette encyclopédie végétale et animale belle comme un code de lois où tout s’explique et se justifie. Il nous dit sa joie de la miniature persane «sans péché et sensuelle», qui nous convainc que la vie est un don précieux et imprescriptible.
Il légifère dans l’ordre du regard et de la perception. Il engouffre tout le ferment contemporain dans la naïve assurance de Paul et Virginie. Il est un Constituant définissant les choses et les rapports de la vue. Il nous dit comment voir les impressionnistes français, le coloris aboyeur de Van Gogh, la fermeté notariale de Cézanne...
Son empire est immense, ses possessions sont fragiles et sans bornes. Tendue sur le paysage sec et rugueux de l’Arménie, sa toile presque abstraite est à la fois un cri lumière et un argument spéculatif «car la peinture est bien davantage un phénomène de la sécrétion intérieure qu’une aperception».
Mandelstam atteint ici à un genre nouveau de prose pure, c’est-à-dire d’accomodement au réel, nous apprenant à enfoncer l’œil dans le matériau de la vue «comme les jeunes Tartares baignant leurs chevaux dans l’Aloucht».
G. Nivat