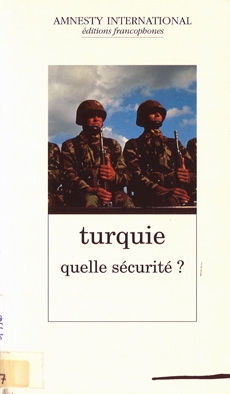
Turquie quelle sécurité ?
Amnesty International
EFAI
Depuis 1960, les gouvernements élus vivent dans l'ombre des forces de sécurité, qui constituent un véritable Etat dans l'État.
Les autorités turques justifient les pouvoirs exorbitants conférés aux forces de sécurité et les violations des droits de l'homme dont elles se rendent responsables par la lutte sans concession menée contre l'opposition armée. En effet, la Turquie est depuis vingt ans en butte à la violence politique des groupes armés d'opposition, essentiellement du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui n'hésitent pas à s'en prendre aux civils et à les tuer.
En dépit de ce sombre tableau, des réformes pourraient voir le jour. La société turque se libéralise ; elle est aussi tournée vers l'avenir. Le pays dispose de plusieurs atouts : une solide démocratie parlementaire, des médias qui jouent pleinement leur rôle, et un système judiciaire élaboré. Encore faut-il que le gouvernement turc prouve qu'il a la volonté politique de garantir le respect des droits fondamentaux de tous ses citoyens.
INTRODUCTION
« Nous aurons raison du terrorisme, mais la démocratie et les droits de l'homme nous empêchent d'aller de l’avant. » Ahmet Çörekçi, chef d'état-major adjoint, juillet 19957.
L'histoire récente de la Turquie est marquée par l'échec de la politique de répression menée par l'État pour garantir la sécurité nationale. Si les gouvernements qui se sont succédé ont progressivement évolué vers une démocratie parlementaire et un plus grand respect des libertés fondamentales, la sécurité nationale, tant intérieure qu'extérieure, a toujours été le domaine réservé des forces de sécurité. Or celles-ci font preuve d'un total mépris des normes internationales relatives aux droits de l'homme ainsi que de la législation turque.
Par conséquent, la situation des droits de l'homme est bien sombre en Turquie. Les personnes soupçonnées d'infractions de droit commun ou politiques sont régulièrement torturées et maltraitées. Des centaines de personnes ont été victimes de "disparitions" et d'exécutions extrajudiciaires, nouvelles formes de violations des droits fondamentaux apparues au début des années 90. Les citoyens turcs ne jouissent pas d'une véritable liberté d'expression. Au cours des six dernières années, de très nombreux prisonniers d'opinion ont été incarcérés pour avoir exprimé leur opinion sans recourir à la violence ni prôner son usage. Des centaines d'autres, parmi lesquels des artistes et des écrivains, risquent d'être condamnés à des peines d'emprisonnement par des cours de sûreté de l'État pour avoir osé exprimer leurs opinions politiques.
Les informations contenues dans ce rapport proviennent de sources très diverses : témoignages de victimes et de leurs proches, déclarations de témoins et d'avocats, certificats médicaux et documents juridiques, photographies et enregistrements vidéo présentés à titre de preuve, réponses fournies par les autorités turques, documents publiés par des organisations intergouvemementales, enfin, articles parus dans la presse et rapports diffusés par'des organisations non gouvernementales. Ce document expose les conclusions de 10 missions d'enquête effectuées depuis 1990 par des représentants d'Amnesty International en Turquie et relate de nombreux procès auxquels ont assisté des observateurs de l'Organisation. Il propose un petit nombre de réformes qui, si elles s’appuient sur une véritable volonté politique, sont susceptibles d’améliorer radicalement la situation des droits de l’homme en Turquie.
Le règne de l'insécurité
Depuis 1960, les gouvernements élus vivent dans l'ombre d'un État dans l'État, à savoir les ministères de l’Intérieur et de la Défense, les préfets et, surtout, l'armée, la police et les services de renseignements. En trente-six ans, les militaires ont renversé trois gouvernements, suspendu à trois reprises le Parlement et dissous des partis politiques légaux.
Les forces armées turques se sont emparées du pouvoir en 1960, en 1971 et en 1980. Le 27 mai 1960, l’armée a mis fin au régime du Parti démocratique dirigé par le Premier ministre Adnan Menderes ; celui-ci a été assassiné ainsi que deux de ses ministres. Le coup d'État militaire du 12 mars 1971, dirigé contre le Parlement turc, avait pour but de détruire un mouvement radical d'intellectuels, d'étudiants et de syndicalistes. Après que les violences politiques de la fin des années 70 eurent entraîné la mort de 5 000 personnes, l'armée s'est de nouveau emparée du pouvoir en 1980. La loi martiale a été proclamée dans tout le pays et les activités politiques ont été suspendues jusqu’en 1983.
Des élections générales remportées par YAnavatan Partisi (ANAP, Parti de la mère patrie) ont ensuite permis le rétablissement d'un gouvernement civil dirigé par le Premier ministre Turgut Ôzal. Le général Kenan Evren, responsable du coup d'État, est resté président de la République jusqu’en 1990.
Aux termes de la Constitution élaborée par la junte en 1982, les forces de sécurité continuent d'exercer une influence considérable sur le gouvernement par le biais de leur appartenance au Milli Giivenlik Kurulu (MGK, Conseil national de sécurité).
Des tribunaux de loi martiale ont condamné un Premier ministre et deux ministres à la pendaison, jugé des membres du Parlement et fait emprisonner des milliers de civils, dont certains sont incarcérés depuis les années 80. Des officiers de l'armée continuent de siéger en tant que procureurs et juges dans les cours de sûreté de l'État auxquelles sont déférés des civils.
La population turque vit dans l'insécurité. La Turquie, située dans une région politiquement instable, est en proie depuis deux décennies à la violence politique exercée par les groupes armés d'opposition, notamment le Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan), qui attaquent des civils et les tuent. L'Etat a réagi en prenant toute une série de mesures "sécuritaires" qui, en violant les droits fondamentaux les plus élémentaires, ont mis encore plus en danger la sécurité des citoyens. Malgré toutes les promesses de réforme, les citoyens turcs risquent toujours d'être enlevés dans la rue et emmenés dans un poste de police ou de gendarmerie - certains y seront retenus pendant un mois -, sans bénéficier des garanties les plus élémentaires contre la torture, qui reste une méthode courante d'interrogatoire. Depuis 1980, plus de 400 personnes sont mortes en garde à vue, apparemment des suites de torture.
Il est parfois difficile d'établir le statut exact des auteurs présumés de violations des droits de l'homme, notamment dans le sud-est du pays où les membres des forces de sécurité ne sont pas toujours en uniforme ou ne portent pas d'insigne permettant de les identifier. Dans la plupart des cas présumés de torture, les détenus ont été interrogés par des policiers en civil appartenant au service des enquêtes criminelles ou à la section antiterroriste, ou encore par des gendarmes. Ces derniers sont des militaires qui accomplissent des missions de police dans les régions rurales. De nombreuses exécutions extrajudiciaires seraient l'œuvre des unités spéciales formées de policiers qui dépendent du ministère de l'Intérieur et sont entraînés au combat rapproché contre les militants du PKK. Ces unités accompagnent souvent les protecteurs de village (membres des milices paramilitaires créées par l'État pour empêcher le PKK de trouver un soutien logistique dans la population rurale) et les gendarmes lors d'opérations de sécurité contre des villages. L'armée régulière et l'aviation participent également aux opérations de grande ampleur menées dans le Sud-Est.
En dépit des déclarations publiques du gouvernement turc sur les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme, la situation ne cesse en réalité d’empirer. Au début des années 90, constatant que les « mesures strictes » se révélaient insuffisantes pour venir à bout de la violence politique, la police et la gendarmerie se sont tournées vers les méthodes criminelles : plus de 100 personnes ont ainsi "disparu" et une vague sans précédent d'exécutions extrajudiciaires a fait plusieurs centaines de victimes.
Face aux actes de torture, aux exécutions extrajudiciaires et aux "disparitions" imputables aux forces de sécurité, le gouvernement réagit généralement de trois façons : il nie les faits, les dissimule ou les justifie. L'expérience montre que les ministres sont prêts à dire n’importe quoi plutôt que de demander aux responsables de la police et de la gendarmerie de répondre des actes de leurs subordonnés. En 1994, face à des informations irréfutables selon lesquelles les soldats incendiaient des villages dans le département de Tunceli, le ministère de l'Intérieur a d'abord laissé entendre que les villageois mettaient eux-mêmes le feu à leurs maisons avant de soutenir que des membres du PKK déguisés en gendarmes détruisaient les villages.
Lorsque des chefs de village venus en délégation rencontrer le Premier ministre Tansu Çiller lui ont affirmé que des soldats soutenus par des hélicoptères avaient détruit leurs villages, celle-ci leur a rétorqué : « Même si j'avais vu de mes propres yeux un village détruit par [des agents de] l'Etat, je ne le croirais pas. »2 Les « questions gênantes » relatives à la sécurité devant toujours être justifiées par référence aux ennemis intérieurs et extérieurs de la Turquie, le Premier ministre a laissé entendre que les hélicoptères appartenaient peut-être au PKK - lequel n’a pas d'aviation -, voire à la Russie, à l'Afghanistan ou à l'Arménie.
Les menaces intérieures et extérieures, réelles ou imaginaires, servent à légitimer les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité. En l'absence de contrôle du Parlement et du gouvernement, les garanties contre ces violations sont inévitablement et constamment violées.
La Turquie moderne souffre d'un certain nombre d'anomalies politiques héritées du régime militaire, qui semblent en totale contradiction avec les orientations générales suivies aujourd'hui par le pays. Alors que la Turquie possède une industrie de la presse et de l'édition parmi les plus sophistiquées au monde et qu'elle a récemment lancé son propre satellite de communications, des producteurs d'émissions de télévision et des musiciens comparaissent devant des tribunaux militaires, des universitaires et des romanciers sont emprisonnés et des journaux sont fermés pour avoir osé s’interroger sur la manière d'agir de l'État.
Le gouvernement turc affirme qu'il engage des poursuites et prend des sanctions à l'encontre des membres des forces de sécurité coupables d’actes de torture ou d'exécutions extrajudiciaires. Selon les sources disponibles, de telles poursuites sont rares et ne débouchent qu'exceptionnellement sur des condamnations. En vertu de ses engagements internationaux, le gouvernement turc est tenu de prendre des mesures pour empêcher les violations des droits de l'homme, d'engager des poursuites à l'encontre des responsables et d'accorder réparation aux victimes. Le fait que les autorités n'aient pas pris les mesures les plus élémentaires en vue de respecter leurs obligations découlant des traités laisse à penser que les plus hautes sphères de l'État approuvent les violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme. Les gouvernements successifs n’ont tenu aucun compte des recommandations et des normes établies depuis des dizaines d'années, démontrant là encore l’absence d'engagement des autorités en faveur des droits de l’homme.
L'état d'urgence
La persistance des violences politiques depuis la fin des années 60 est un paramètre important qui ne peut être passé sous silence. Les deux groupes armés d'opposition les plus actifs depuis le coup d'État de 1980 sont le PKK, qui dispose de nombreux combattants dans les montagnes de l'est du pays et dans les pays voisins, et le Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C, Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple), anciennement Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), qui prend les policiers et les militaires pour cibles dans les villes de l'ouest de la Turquie. Bien que prônant une idéologie de libération, ces deux mouvements tuent des civils non combattants et des prisonniers. Les forces du PKK assassinent fréquemment des fonctionnaires et des villageois kurdes qui ne prennent pas part au conflit. Les enseignants sont particulièrement visés : 90 ont été tués par le PKK depuis 1984.
Le conflit qui oppose les forces de sécurité et le PKK dans le sud-est de la Turquie, où vivent la plupart des quelque 12 millions de Kurdes, a de toute évidence contribué à la détérioration de la situation des droits de l’homme dans tout le pays. Le PKK a commencé à lancer ses attaques en août 1984 dans le but d'établir un État séparé kurde marxiste. Cette organisation milite actuellement pour des objectifs plus modestes, essentiellement un certain niveau d’autonomie pour le Sud-Est.
L'état d'urgence en vigueur dans les 10 départements les plus touchés par le conflit confère de vastes pouvoirs aux forces de sécurité. Le préfet de la région sous état d'urgence contrôle la police et l'afmée et il peut exercer toutes les fonctions dévolues à l'administration civile. Il bénéficie, à l’instar des forces placées sous son autorité, d’une large immunité des poursuites.
Quelques généraux et responsables de la police prétendent que le respect des droits de l’homme entraverait leurs efforts dans la lutte contre les groupes armés d’opposition. Même si cette affirmation était exacte, cela n'excuserait en rien le fait de fermer les yeux sur le recours à la torture ou aux "disparitions". De plus, ces 16 dernières années, marquées par l'échec de la politique de répression pour rétablir la sécurité, ne plaident pas en faveur d'un durcissement des méthodes répressives. D'autres ont reconnu que non seulement cette stratégie avait échoué mais qu'elle avait aggravé le problème. Le général en retraite Nevzat Bolugiray a déclaré dans ses mémoires : « Les persécutions commises au nom de la raison d’Etat ont sans doute entamé la confiance de la population envers les autorités, mais le PKK a également rallié des sympathisants au sein de la base. »3
Algan Hacaloglu, ancien ministre des Droits de l'homme, a fait la même observation : « Le PKK continue à recruter. Pourquoi ? Parce que l'aliénation est générale, parce qu'en dépit de ses discours [le gouvernement] n'est pas parvenu à faire véritablement progresser les droits du citoyen et la démocratie. »4
Tous les citoyens sont menacés lorsque les agents de l’État transgressent la loi. D'ailleurs ces derniers peuvent eux-mêmes devenir des victimes.
Le 15 décembre 1995, le PKK a proclamé unilatéralement un cessez-le-feu. Quatre semaines plus tard, les autorités ont annoncé que des membres de ce parti avaient massacré un groupe de 11 hommes, dont sept protecteurs de village, dans un minibus auquel ils avaient ensuite mis le feu. Le chef d'état-major a fait transporter en avion des journalistes appartenant aux principaux journaux et organes de radiodiffusion à Güçlükonak (département de Siirt), localité isolée où avait eu lieu la tuerie. Le Premier ministre Tansu Çiller a déclaré : « Ces ennemis de l'humanité qui pensent que l'autorité de l'État est affaiblie et qui ont retourné leurs armes contre nos citoyens innocents vont périr au fond du gouffre dans lequel ils sont tombés. De telles attaques contre l'existence de la République turque prouvent à quel point notre lutte contre le terrorisme est légitime. »
Des doutes ont commencé à être exprimés peu après, notamment par les familles des victimes, sur la version officielle de cette affaire. Une délégation regroupant un vaste éventail d'organisations internationales, professionnelles et de défense des droits de l'homme a enquêté sur le massacre. Elle a rassemblé des éléments démontrant que les responsables de la tuerie étaient en réalité des agents du gouvernement.
La nécessité de réformes
Une bonne partie de la société civile turque est convaincue qu'il est temps d'adopter un nouveau programme. Des personnalités de la vie publique, des arts, des médias et de l'industrie ont exprimé leur honte de voir des personnes incarcérées pour avoir exprimé des opinions dissidentes sans recourir à la violence. L'opinion publique avait réagi positivement à la promesse d’ouverture faite en 1991 dans le cadre de sa campagne électorale par Süleyman Demirel, l'actuel président de la République, qui avait notamment déclaré : « Tous les postes de police auront des murs de verre. » Cette promesse n'a pas été tenue mais la population a gardé espoir.
Une série d'atrocités commises en 1995 et au début de 1996 au nom de la sécurité a suscité une véritable levée de boucliers. C'est ainsi qu'en mars 1995, à Istanbul, 23 personnes ont été abattues dans la rue par des policiers en civil qui ont ouvert le feu sur des manifestants. Ces derniers protestaient contre l'inaction de la police à la suite d'une attaque armée contre un café. Les "disparitions" signalées à Istanbul à la suite de ces troubles ont suscité un tollé général. En janvier 1996, Metin Gôktepe, un photographe qui couvrait les obsèques de plusieurs prisonniers politiques, a été arrêté par des policiers ; son corps a été retrouvé ultérieurement : il avait été battu à mort. Au cours du même mois, un membre du Parlement a recueilli des éléments prouvant que plusieurs adolescents, dont l'un n'avait que quatorze ans, avaient été sauvagement torturés au poste de police de Manisa dans l'ouest de la Turquie.
Les Turcs ont vivement réagi à ces affaires car ils ont pris conscience que les victimes de ces violations auraient pu être leurs fils ou filles. Ces drames ne se sont pas déroulés dans les montagnes du Sud-Est, mais dans les rues de la plus grande ville du pays et dans une ville de province située à proximité de la côte méditerranéenne. Les mesures exceptionnelles de "sécurité" mettent tout le monde en danger en l’absence de garanties appropriées et d'obligation pour les agents de l'État de rendre des comptes.
Si certaines catégories importantes de la société turque réclament ouvertement des réformes, la communauté internationale n'apporte pas de réponse cohérente à cette revendication. Les gouvernements qui disposent de la plus forte influence sur le gouvernement turc, à savoir les États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et plus particulièrement ceux appartenant à l'Union Européenne (UE), se gardent d'utiliser des outils qu'ils ont eux-mêmes élaborés pour combattre les violations des droits de l’homme dans le cadre du Conseil de l'Europe, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies (ONU). Lorsqu'on leur reproche de ne rien faire, ils se font l'écho de l'excuse fournie par le gouvernement turc : ils ont les mains liées par la menace terroriste.
Mais la véritable raison de leur réticence à prendre une position tranchée n’est pas un secret : la Turquie est un allié précieux et elle est perçue comme un rempart stratégique face à l'instabilité régnant dans certaines régions du Moyen-Orient et dans les pays de l’ex-Union soviétique. La Turquie est également un partenaire commercial important et elle représente un marché lucratif pour le matériel militaire.
Le respect des droits de l'homme
Le présent rapport bat en brèche l'idée selon laquelle la sécurité nationale ne peut être véritablement garantie qu'au détriment du respect des droits de l’homme. Aux termes du droit international, les États peuvent prendre des mesures exceptionnelles en cas de situation d'urgence menaçant l'intégrité de la nation. Bien qu'il soit possible de restreindre temporairement certains droits en cas de stricte nécessité et en fonction de la menace encourue, certains droits fondamentaux comme le droit de ne pas être torturé et le droit à la vie ne peuvent en aucun cas être suspendus. L'état d'urgence doit être une extension de l'autorité de la loi et non l'abrogation de celle-ci.
En violant les lois turques en toute impunité, les forces de sécurité portent atteinte à la primauté du droit d’une manière qui ne peut que perpétuer le cycle de la violence et favoriser de nouvelles violations. Les citoyens turcs ne pourront vivre en sécurité tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés.
Les réformes nécessaires pour mettre la législation turque en conformité avec, par exemple, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme), que la Turquie a ratifiée en 1954, ne sont ni complexes ni de grande ampleur. Elles ne représentent en réalité qu'une extension de certains principes déjà reconnus par le droit turc et qui demandent à être soutenus par une volonté politique.
1
Les Dissidents Réduits au Silence
Dans la Turquie d'aujourd'hui, la question de la liberté d'expression reflète un sombre paradoxe. Le nombre de prisonniers d'opinion connus d'Amnesty International est passé de plusieurs centaines à la fin des années 80 à une dizaine en janvier 1996. La liberté d'expression n'a pourtant jamais été aussi gravement menacée depuis le coup d'État militaire de 1980.
Les journalistes ou les militants des droits de l'homme risquent peut-être moins souvent d'être incarcérés pour leurs écrits, mais ils risquent beaucoup plus d'être tués.
La société civile turque peut être fière du chemin parcouru vers une plus grande liberté d'expression depuis la fin du régime militaire en 1984. Sous les généraux, tous les partis politiques et la plupart des syndicats étaient interdits ; des centaines de personnes ont en outre été torturées et emprisonnées pour leurs opinions non violentes. La plupart des prisonniers d'opinion étaient poursuivis en vertu des articles 141,142 et 163 du Code pénal turc qui prévoyaient de longues peines d'emprisonnement pour les actes de propagande en faveur du communisme, du « séparatisme » kurde ou d'un gouvernement reposant sur des convictions religieuses. De nombreuses personnes ont été emprisonnées pour appartenance à des organisations dont les activités étaient parfaitement légales avant le coup d'État militaire.
Au cours des quatre années qui ont suivi le coup d'Etat, l'expression de toute opinion, même modérée, était réprimée. Les journaux étaient régulièrement censurés ou saisis et les journalistes faisaient l'objet de poursuites. C'est à cette époque que les militaires ont tenté d'éliminer complètement la langue kurde. La loi 2932, adoptée en 1983, punissait d'une peine d'emprisonnement quiconque exprimait des idées dans « des langues autres que les langues officielles d'autres nations ». Les prisonniers politiques qui s'exprimaient en langue kurde devant les tribunaux étaient condamnés à des peines d'emprisonnement supplémentaires.
Dans les années 80, des partis politiques, des syndicats et d'autres organisations ont fait campagne contre ces lois, ainsi que d'autres, qui limitaient la liberté d'expression et réprimaient toute dissidence en soulignant qu'elles représentaient des contraintes inutiles et inopportunes dans une société moderne.
Une étape vers la liberté d'expression
La junte militaire, qui a pris le pouvoir en 1980 et dirigé le pays pendant les dix dernières années de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, a tenté de se donner une légitimité en se présentant comme un rempart contre le communisme. En 1990, soit six ans après le rétablissement de la démocratie parlementaire en Turquie, une partie des médias et de nombreux membres du Parlement affirmaient haut et fort qu'une société saine avait besoin de débats politiques libres et ouverts. Les groupes de gauche qui ne prônaient pas la violence n'étaient plus perçus comme une véritable menace et leurs membres faisaient moins …
Amnesty International
Turquie quelle sécurité ?
EFAI
Editions Francophones d'Amnesty International
Turquie quelle sécurité ?
Amnesty International
L'édition originale en langue anglaise de ce livre a été publiée par
Amnesty International Publications,
1 Easton Street, London WC1X 8DJ,
Royaume-Uni, sous le titre, Turkey.
No security without human rights.
Seule cette version fait foi.
ISBN : 2-87666-080-6
Index AI : EUR 44/84/96
Copyright© 1996
Amnesty International Publications
Copyright © 1996 Les Editions Francophones d'Amnesty International,
17, rue du Pont-aux-choux, 75003 Paris, pour l'édition en langue française.
Copyright © Photo de couverture : Rex Features
Tous droits de reproduction réservés.
Toute reproduction, même partielle,
est non autorisée sans accord préalable d'Amnesty International.
Ce livre est en vente auprès des sections et groupes d'Amnesty International
(cf. les adresses en page 128).
Il est également en vente en librairie.
Distributeurs : pour la Belgique,
Nouvelle Diffusion, rue de Bosnie, 24, 1060 Bruxelles ;
pour le Canada, Dimédia Inc. ;
pour la Suisse, Amnesty International,
Service des publications, rue de la Grotte, 6, 1003 Lausanne.
Les Éditions Francophones d'Amnesty International
Octobre 1996