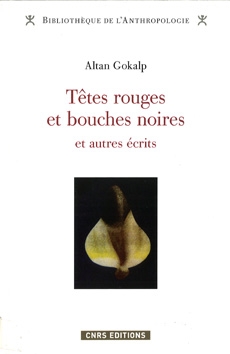|
PREFACE
En découvrant, et souvent redécouvrant, les textes rassemblés dans ce gros volume qui a pour ambition de retracer le parcours scientifique d’Altan Gokalp, s’est d’abord imposé à moi le souvenir de leur auteur, de celui avec lequel j’ai, depuis une trentaine d’années, régulièrement collaboré mais aussi entretenu des rapports d’amitié. L’œuvre se dessine alors à l’image d’une personnalité qui ne peut que retenir l’attention et que l’on peut résumer d’un mot, le charme qui en émanait : certes moins « charmant » - le discours pouvait être franc, cru et direct - que «charmeur», mais ne laissant jamais indifférent.
Charme du conteur, qui avait l’art de mettre en valeur les traits les plus anecdotiques de sa vie professionnelle, de ses relations avec le monde de la science, de la culture ou de la politique que ses nombreuses et fort diverses activités l’avaient amené à fréquenter et sur lequel il portait un regard corrosif, quand il narrait par exemple ses visites à l’Elysée comme traducteur attitré du Président Mitterrand ou ses voyages « officiels », à ce titre, en Turquie. Regard corrosif qu’il portait aussi sur lui-même, découvrant ainsi, jeune chercheur, son double, au réveil d’un petit matin, sur un chemin de montagne du Monténégro, à la frontière de l’Albanie où il situait ses origines «ottomanes», à travers la fenêtre de sa voiture où il avait passé la nuit, dans le visage d’un berger se penchant vers lui pour s’informer. Ne devint-il pas lui-même figure de bande dessiné pour illustrer le personnage de l’ethnologue dans une livraison du célèbre Génie des Alpages qui le voyait enquêter auprès du berger-héros et de ses brebis bien-pensantes.
Charme de l’enseignant captivant ses auditoires. Je l’avais plusieurs années de suite suppléé pour assurer le cours qu’il donnait à la Sorbonne avec pour objectif d’introduire à la connaissance de l’anthropologie des générations de jeunes historiens. Ceux-ci évoquaient parfois avec un sourire admiratif leur expérience de ses cours. Certes il était de temps à autre malaisé d’en suivre le « plan », vite oublié à l’écoute d’un discours brillant, rebondissant de thèmes en thèmes, d’anecdotes de terrain en réflexions théoriques. Mais tout finissait par prendre sens et à laisser vraisemblablement plus de traces que mes cours suppléants, structurés certes, mais offrant peu de surprises. Il en était de même des exposés, présentés à l’occasion de séminaires destinés aux collègues et aux jeunes chercheurs, qui laissaient toujours l’auditoire captivé et ravi.
Charme d’un engagement intellectuel dont on retenait d’abord une curiosité sans cesse renouvelée. La vie et ses recherches l’avaient placé à la frontière de cultures a priori bien différentes : culture française, dont il revendiquait avec vigueur les valeurs républicaines, culture kémaliste, nationaliste, républicaine et laïque, fondatrice de la Turquie moderne, culture impériale ottomane, culture des nomades oghuz et turcs, dont il retrouvait les racines à travers ses travaux. Sans que sa démarche se disperse, il s’attachait aux continuités des valeurs et des sens, au poids des « traditions », mais aussi aux relectures de leurs significations, aux créations culturelles dont l’un de ses horizons était l’art romanesque1 illustré par l’œuvre de son aîné, Yachar Kemal, dont il s’attacha à rendre compte en maintes occasions.
Cette diversité des approches se retrouve dans sa démarche scientifique. Avant de se tourner vers l’anthropologie, Altan Gokalp avait acquis une solide formation en sciences politiques. La littérature, ancienne ou moderne, orale ou écrite, celle émanant du peuple comme celle des écrivains reconnus, fut aussi constamment un de ses centres d’intérêt. Il ne refusait de même aucune des méthodes d’investigation qui s’offraient à lui : ainsi peut-il s’appuyer sur des données statistiques ou des enquêtes quantitatives comme sur de fines analyses linguistiques et sémiologiques, associer Lévi-Strauss et Bourdieu, traiter des racines chamaniques des communautés alevîs ou mener de longues enquêtes sur l’immigration turque en Europe. Une profonde empathie avec les hommes (et les femmes) dont il interrogeait ainsi la vie permettait de ressaisir les fils directeurs et de les suivre en creusant le sillon, en approfondissant sans cesse des hypothèses régulièrement remises sur le chantier.
La palette de ses recherches est restée ouverte, jouant des gammes les plus diverses sans que l’on puisse le classer parmi les écoles et les chapelles. Altan Gokalp ne se réfère exclusivement à aucune théorie ou discipline, mais sa vaste culture scientifique et sa connaissance approfondie du terrain qu’il explorait, lui a permis d’aborder les sujets les plus divers, d’évoquer les auteurs les plus variés, anthropologues ou autres. Je tenterai dans cette préface de restituer quelques facettes de ses activités, celles en particulier que j’ai pu partager à l’occasion de collaborations, ponctuelles certes, mais qui m’ont enrichi et qui alimentent le souvenir.
Cet hommage se proposant d’abord comme la restitution d’un parcours, il était utile de le faire débuter par une nouvelle édition de sa thèse, Têtes rouges et bouches noires. Une confrérie tribale de l’Ouest anatolien2, soutenue et publiée en 1980, qui marque une première étape de son itinéraire. Sans en faire par la suite sa démarche exclusive, Altan Gokalp clôt à cette occasion une longue période de formation, mais aussi d’explorations et de découvertes, en donnant une certaine priorité à l’approche anthropologique. Ce travail qui se présente comme une monographie ethnologique « classique » - inventaire d’une communauté fortement identitaire à partir de l’étude de plusieurs villages -, au bon sens d’un terme parfois dévalué par ceux qui s’affirment postmodemes, ne me semble pas avoir suscité tout l’intérêt qu’il méritait.
Pour une part vraisemblablement du fait d’Altan Gokalp lui-même, très peu « carriériste », qui tournait volontiers la page du travail bien fait et n’en cherchait pas la gloire... ni les promotions dont il oubliait souvent les échéances. L’ouvrage aborde les principaux champs de l’anthropologie : parenté, économie, politique et religion..., et apporte à chacun une contribution significative. S’agissant de la parenté, par exemple, l’étude fine de la forme segmentaire de l’organisation unifiliative et celle du mariage préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale constituent l’une des meilleures illustrations concrètes, s’appuyant sur des données nouvelles, recueillies dans les règles de l’art, de l’application des règles de l’échange généralisé dont Lévi-Strauss avait établi les principes de fonctionnement vingt ans auparavant.
La réédition de ce texte, devenu difficilement accessible, s’imposait. Il est vrai que, semblant contredire l’empathie que je soulignais précédemment, le chercheur reste souvent caché derrière ses données et ses analyses, sauf dans l’introduction où il évoque son séjour sur le terrain. C’était peut être dans l’air du temps, et j’avoue que cela n’est pas pour me déplaire. Pourtant le simple choix du groupe étudié nous informe déjà sur la manière dont Altan Gokalp abordera ultérieurement la recherche anthropologique.
Dans la société ottomane, puis turque, les Çepni auquel il consacre cette étude sont doublement marginaux. Il s’agit, d’une part, d’une société tribale et de pasteurs nomades, difficilement contrôlée, politiquement et administrativement, dans le système ottoman, incitée à une sédentarisation, achevée en 1927, qui va les exclure de la propriété foncière et des droits afférents. Les Çepni appartiennent, d’autre part, à la culture alevîe, hétérodoxie religieuse d’inspiration chiite constituant une forte minorité en Turquie où elle s’oppose à la majorité sunnite qui lui attribue ce surnom de « Têtes rouges », évoquant leur forte endogamie aux risques de l’inceste.
Cette marginalité dans le contexte national est accentuée encore par la persistance de multiples traditions héritées du chamanisme préislamique turco-mongol, et par de nombreux emprunts aux traditions chrétiennes anatoliennes. L’expression par lesquels ils désignent leurs voisins, les «Bouches noires», rend compte de la mauvaise parole, du mensonge et de l’oppression qui caractérisent à leurs yeux leur environnement.
Altan Gokalp relativise cependant la dimension «syncrétique» de cette religion/culture, même s’il utilise cette notion de syncrétisme dans son analyse. Tout en soulignant les apports chamaniques et chrétiens à l’islam chiite, il met en avant la dimension adorciste3 des rites (initiation, possession...) qu’il associe à la situation d’exclusion des tenants de ces cultes et croyances au sein de la société ottomane sunnite. Il touche là à une question beaucoup plus générale et qui se pose en d’autres lieux, à d’autres époques : ces cultures, on pourrait dire la même chose du zar oriental4 ou du bori5 africain, et repérer des phénomènes analogues aux marges du christianisme, correspondent-elles à des cultes qui s’expliquent par l’exclusion des groupes (femmes, esclaves, «noirs», etc.) qui les pratiquent au sein de la société qui les inclut, ou s’agit-il de religions adorcistes à part entière, comme on le considère dans le cas du vaudou afro-américain ?
On constate ainsi que, dès la rédaction de sa première grande enquête ethnologique, Altan Gokalp fait le choix de travailler en priorité sur ce qu’il appellera « les exclus de la société ottomane », en ce cas les communautés alevîs qui ont su préserver une certaine autonomie de leurs « républiques villageoises», renforcée par une forte endogamie, quasi institutionnelle, justifiée religieusement et renforçant une identité culturelle tout particulièrement marquée dans le traitement des rapports de genre. A ma connaissance, cette thèse était une des premières études ethnologiques, c’est-à-dire de terrain, sur les Alevîs et, depuis, cette forte minorité, près du quart de la population turque, n’a pas fait l’objet de beaucoup de recherches nouvelles, contrairement à la minorité kurde par exemple.
Dans ses travaux ultérieurs, Altan Gokalp reviendra à maintes reprises sur les questions soulevées par les travaux sur les Alevîs. Il continuera cependant, en traitant d’autres terrains, à s’intéresser principalement à ces « exclus » d’une société de tradition ottomane, puis kémaliste, fortement étatisée et centralisée, politiquement mais aussi culturellement: ainsi se penchera-t-il par la suite sur le petit peuple d’Istanbul, sur les populations urbaines issues de l’exode rural, sur le sort des migrants internationaux, des femmes, etc.
La notion de société « segmentaire » se situait au centre de l’analyse à laquelle Altan Gokalp procède, dans sa thèse, des communautés de l’Ouest anatolien. Inspirée des distinctions opérées par Durkheim entre solidarités « mécaniques » et « organiques », les premières rendant compte de sociétés constituées de groupes répétés à l’identique, comme les anneaux des vers de terre, cette notion est réinterprétée dans la théorie britannique de la filiation, comme un effet de la règle d’affiliation unilinéaire qui donne leur caractère discret à ces groupes rassemblés sous une structure généalogique définissant entre eux des relations d’opposition et de complémentarité. Les « républiques villageoises », au sein desquelles vivent les Alevîs objet de son étude, sont l’ultime avatar, après leur sédentarisation, de l’organisation en os et en clans des Oghuz et Turcs nomades anciens qui avait déjà connu de profonds changements du fait de la conquête turque puis de l’intégration dans l’empire ottoman. Cette ordre segmentaire, qui définit des positions d’autorité fondées sur le principe d’aînesse, est aussi le cadre de la gestion des alliances de mariage, chaque groupe unilinéaire exogame agissant simultanément comme « donneur » et « preneur » de femmes.
Dans un article publié dans L’Homme et réédité ici, Altan Gokalp parlera d’un «entêtement lignager» pour exprimer la remarquable permanence, contrastant avec la variation des identités nominatives, de cette structure « tribale », à laquelle les anthropologues attribuent généralement des traits d’archaïsme en l’opposant à l’apparition de l’État. Avant de servir de support à la sédentarisation, cette structure tribale a permis d’ordonner les rapports des communautés nomades anatoliennes, yôrük et turkmènes, avec l’État ottoman sous le régime du timar6 qui organise fiscalité et prestations, parallèlement au régime du millet auquel sont soumises les communautés sédentaires. Cette organisation reproduit le régime de pro-noia antérieurement mis en place par les empereurs byzantins. L’ordre tribal a, auparavant, contribué à la conquête par les nomades oghuz et turcs de cet espace impérial en facilitant leur rassemblement sous l’autorité de khan puissants, capables de mobiliser les tribus.
La parenté est un des domaines où j’ai été amené à collaborer avec Altan Gokalp en tant que responsable de l’édition en 1994, mais le projet remontait à 1991, date d’un colloque organisé au Collège de France, d’un ouvrage, Épouser au plus proche1, où était publiée sous sa signature une contribution revenant sur certaines des analyses présentées dans sa thèse. On sait que ce domaine relève des préoccupations les plus répandues des anthropologues. Nous nous proposions de reprendre l’analyse de ce qu’ils appellent le « mariage arabe », unissant les enfants de deux frères, mariage préférentiel dans beaucoup de sociétés, arabes ou autres, et qui se diffuse avec l’islam bien qu’il ne s’agisse pas d’une prescription religieuse.
Ce type d’alliance matrimoniale interroge sur l’universalité de l’échange que Lévi-Strauss inscrivait au départ de sa «théorie de l’alliance». Hors cette question théorique générale, se posait aussi le problème de l’adoption, avec l’islam, de ces choix préférentiels du conjoint, qui ne sont pas fondés sur la loi religieuse, la sharfca, au sein de sociétés dont le système matrimonial repose sur d’autres principes que ce « mariage dans un degré rapproché de consanguinité » qu’est le mariage « arabe » : si la fille du frère du père est alors pour un Ego masculin un choix premier, toutes les cousines germaines sont en effet épousables et significativement épousées. L’islamisation de populations ayant des règles d’organisation de la parenté et de l’alliance différentes, voire contradictoires, avec le système arabe soulève le problème du pourquoi et du comment s’effectuaient alors ces transformations. J’avais pour ma part engagé cette réflexion concernant les sociétés est-africaines à régime de clans exogames.
C’est aussi le cas des sociétés turco-mongoles qui illustrent l’application des règles de l’échange généralisé, prescrivant le mariage avec la cousine croisée matrilatérale et prohibant le mariage avec la cousine parallèle patrilatérale, c’est-à-dire la possibilité même de réalisation du « mariage arabe ». Altan Gokalp, s’appuyant sur les données présentées dans sa thèse, montre comment les principes de réciprocité et de parité des conjoints sur lesquels repose le système « arabe » peuvent se concilier avec les principes d’échange et de hiérarchie du système « turc » à travers le mariage berder, terme dérivé de l’arabe badal, désignant le mariage par « échange de sœurs », très répandu dans tout le monde arabo-musulman sous domination ottomane. Le mariage de deux hommes avec deux sœurs crée entre eux une relation particulière d’égalité (bacanak'), qui ouvre la voie au mariage arabe quand l’union concerne aussi deux frères. Il s’agit là d’une importante contribution à la compréhension des principes généraux du mariage proche, mais aussi à la théorie anthropologique de la parenté à laquelle elle offre de nouvelles perspectives.
Altan Gokalp s’est intéressé aussi à l’instrumentalisation de l’alliance de mariage dans les milieux de l’immigration turque européenne, et nous7 avons de même collaboré tout récemment à la préparation d’un colloque, puis d’un numéro de YAnnuaire Droit et religions8, introduisant à une approche anthropologique des réformes du code du statut personnel dans les sociétés musulmanes contemporaines. Les premières réformes sont intervenues dans l’empire ottoman dès la fin du XIXe siècle. Mais si l’autorité d’Ataturk a permis d’instaurer en Turquie un code civil, d’inspiration suisse, qui ne présente aucune référence aux prescriptions de la sharta musulmane, le poids des traditions reste écrasant en ce domaine. Le texte que consacre Altan Gokalp aux pratiques du « mariage arrangé » dans l’immigration turque, parallèle à celui que j’avais rédigé pour le même ouvrage, sur ces mêmes faits, dans les pays arabo-musulmans, pose le problème des représentations de cette pratique d’un point de vue « émique » et « étique » : dans les sociétés qui accueillent les migrants, ce qui apparaît du point de vue de ceux-ci comme un mariage « proche », parfaitement normatif, qu’il s’agisse pour un homme de la fille du frère de son père (mariage arabe) ou de la fille du frère de la mère (mariage turc), est conçu, avec une forte connotation négative, comme un mariage arrangé ou forcé. Altan Gokalp en arrivait aux mêmes conclusions : le mariage proche, dans la consanguinité, n’est pas obligatoirement un mariage «forcé» au sens où l’entendent nos sociétés. Il analyse ensuite la manière dont les « mariages au pays» organisent les stratégies de la migration, non sans soulever des problèmes réels (consanguinité, contrainte), non sans poser des questions de droit et de relations intcrculturelles.
Un autre volet de ses recherches sur ce thème de la parenté, consacré aux cérémonies matrimoniales dans l’immigration, pour lequel il s’est appuyé sur les documents audio-visuels produits par les intéressés eux-mêmes qui filment les mariages sur des cassettes dont la circulation en Europe et au pays est une source d’échange et de prestige, conduit à des conclusions proches. L’inflation financière des cérémonies accompagnant le mariage dans l’immigration, qui rappellent les rituels du «grand mariage» aux Comores par exemple9, souligne que ces rituels deviennent un « fait social total». La revendication endogamique exclusive a pour contrepartie la condamnation du mariage extérieur ainsi que le transfert dans l’immigration du phénomène des « crimes d’honneur ». Dans le monde ottoman, qu’il soit turc, arabe ou encore balkanique, ceux-ci relèvent d’une tradition historique sur laquelle il s’est interrogé.
Ces deux textes illustrent un aspect des recherches d’Altan Gokalp dont les contraintes de choix n’ont pas permis de rendre pleinement compte dans cet ouvrage. Il s’agit des travaux sur l’émigration turque vers l’Europe dont je peux témoigner qu’ils ont été, ces trente dernières années, une des préoccupations de l’auteur. Il est vrai qu’ils se sont répartis dans des cadres institutionnels et intellectuels en partie extérieurs à la production scientifique proprement dite : activités associatives, rapports pour des organisations internationales ou des ministères, fonctions de missionnaire de l’inspection générale de l’Éducation nationale en charge de l’enseignement du turc, etc. On trouvera néanmoins dans les pages qui suivent quelques références aux recherches sur ce thème ; elles viennent à l’appui de l’importance qu’il leur accordait.
Le « terrain » alevî incitait Altan Gokalp à s’engager dans une problématique du « syncrétisme » qu’il a abordé avec beaucoup de prudence, compte tenu de la diversité des apports qui contribuent à l’identité alevî et de la forte originalité de celle-ci. Ce premier constat va le conduire à s’intéresser plus précisément à différents aspects de la religion populaire turque. De nombreux articles rendent compte de l’avancement de sa réflexion à ce sujet et, - j’ai souvenir qu’il a abordé plusieurs fois ce projet devant moi - il avait pratiquement achevé un ouvrage sur ce thème, dont on trouvera l’essentiel dans la deuxième partie du présent recueil sous le titre, qu’il avait lui-même choisi, de « De l’animisme à l’islam populaire. L’univers symbolique des Turcs ». Nombre des textes dont on prendra connaissance à la suite de la thèse, développent ce grand projet. On peut en tirer quelques leçons.
Dans «islam populaire», l’important est l’adjectif «populaire», qu’il est préférable d’associer à « religion ». L’expression « religion populaire » rend mieux compte, en effet, d’un contexte où près d’un quart de la population turque appartient à une communauté alevî que son hétérodoxie situe aux frontières de l’islam. Le qualificatif est cependant ambigu. En évoquant parfois, de manière similaire semble-t-il à islam populaire, un «islam sauvage», Altan Gokalp n’est pas loin de s’inscrire dans la métaphore lévistraussienne du bricolage, qu’il nuance immédiatement en invoquant la fonction de la praxis telle que la conçoit Pierre Bourdieu. A l’inverse, «populaire» peut renvoyer à la notion politique de «culture populaire», quand il évoque la recomposition kémaliste de la langue turque, les activités des « associations villageoises » ou encore certains courants de la littérature ou des arts modernes.
Les préoccupations de l’auteur ne se situent pas là, cependant, pour autant que ses travaux, fragmentaires mais homogènes dans leur composition, permettent d’en juger.
Altan Gokalp s’attache d’abord inlassablement à identifier les fondations de cette religion populaire telles qu’elles émergent des apports successifs d’une histoire complexe. Les racines nomades sont encore présentes malgré la sédentarisation séculaire des paysans anatoliens et leur insertion dans le cadre ottoman. La tribu, les rapports de parenté, perpétuent les références à un ordre ancien, celui des clans oghuz et turcs, organisant les représentations du genre, de la transmission filiative, de l’alliance de mariage. La figure de l’ours concurrence celle de l’oncle maternel, donneur de femme; elle brouille les positions d’autorité et évoque les risques de l’inceste. On retrouve dans les cultes alevîs ces croyances des nomades, de nature chamanique, mais conçues ici plutôt comme une forme d’animisme dont est retenue l’expression tangrique du nom de la puissance divine supérieure, Tangri, qui l’inspire. Ces croyances organisent cultes et fêtes en suivant un calendrier astral et solaire qui rythme les activités humaines en fonction de repères universels : solstice d’hiver, transgression carnavalesque, renouveau de la végétation pastorale et des cultures, etc. Elles inspirent les rapports avec la nature que perpétuent les pèlerinages en des lieux marqués par le sacré, mais aussi l’œuvre romanesque contemporaine d’un Yachar Kemal qui en explore les signes particularisés.
A bien des égards l’islamisation de ces Turcs nomades a représenté une rupture, mais l’islam « sauvage », « populaire », opère aussi une relecture constante des nouvelles croyances révélées. Contrairement à l’islam « officiel », celui des souverains, des docteurs et des savants, qui en retiennent la norme, l’association à l’autorité et au pouvoir, l’islam populaire s’organise surtout en fonction d’une attente thaumaturge qui privilégie l'offrande sacrificielle et l’efficacité magique. Il emprunte certes à la tradition musulmane ses rituels et autres pratiques ésotériques ; il en retient de nouvelles figures héroïques, d’autres représentations de la sainteté, ou encore de la monstruosité associée souvent au féminin, démones et ogresses. Tout comme dans le monde berbère que je connais mieux, ou encore dans l’aire de culture iranienne, cet islam populaire, et même certaines de ses expressions plus savantes, intègrent ainsi des valeurs et des signes chargés du poids des traditions antérieures. Il s’agit en l’occurrence de la tradition turque, mais aussi de l’héritage d’une tradition arabo-musulmane vieille déjà de près d’un millénaire quand s’établit l’empire ottoman. L’islam populaire turc, y retrouvera des thèmes testamentaires, des références prophétiques, des rituels et des savoirs ésotériques et exotériques qu’a progressivement intégrés, dans ses formes savantes et populaires, la dernière des religions révélées. Il s’inspire en particulier d’apports iraniens, tels les récits concernant la « reine des serpents », développés dans les Contes des Mille et une nuits, thème répandu dans la littérature et plus encore dans l’iconographie populaire turque.
L’empire ottoman s’est coulé dans le moule d’un monde byzantin auquel il a emprunté nombre d’institutions, de savoirs et de croyances. Il a contribué à maintenir l’existence d’un christianisme oriental que menacent de nos jours les nouvelles épurations religieuses. Altan Gokalp avait déjà souligné dans sa thèse les contributions du christianisme anatolien à la formation de l’identité alevîe. Il reviendra sur ces apports byzantins, dans ses travaux sur Istanbul par exemple où le pèlerinage d’Eyüp conjugue symboliquement le martyrologue de la conquête musulmane, le thème biblique dont s’inspire la légende de Job, le culte des saints chrétiens, Corne et Damien, évoquant la légende des Sept Dormants, et bien d’autres traits empruntant aussi à la culture antique, avant l’établissement du christianisme en Orient. Ces références à des grands thèmes de la tradition grecque ancienne se retrouvent dans la fête-pèlerinage au mont Ida de la Bithynie ancienne, proche de l’Olympe, aux portes d’Istanbul, mettant en scène cette mystérieuse figure de la « nymphe blonde », rappelant l’antique nymphe Idaea, que l’on retrouve dans d’autres croyances et rituels de la religion populaire turque.
C’est dans le creuset de l’empire ottoman que s’effectue cette fusion de traits empruntant à des histoires et des traditions aussi diverses. A cet égard, le choix des recherches conduites par Altan Gokalp est relativement exclusif. Il ne s’intéressera guère aux formes de culture impériale, aux rituels du pouvoir, aux représentations dynastiques, aux siècles de littérature ottomane, et il n’évoque pas leurs manifestations éventuelles dans les croyances et pratiques populaires, telles que je les ai observées au Maroc par exemple à l’occasion du mariage où le mari est appelé Sultan et traité comme tel durant la cérémonie. Il est dans son œuvre cependant une exception notable. Ses travaux sur le harem nous situent dans les alcôves, dans l’intimité du pouvoir du Sultan, mais dans sa composante féminine alors. Le choix n’est pas sans significations, nous y reviendrons.
Cette religion populaire, et il procède à une lecture très large de ce terme religion, assimilable pratiquement à celui de culture, a une dimension holiste et ses expressions propres: elle participe d’un ethos particulier. Altan Gokalp s’inscrit là dans une certaine continuité avec les travaux de Pertev Boratav, le fondateur du folklorisme turc anatolien, avec lequel il se reconnaissait une certaine filiation et dont il souhaita souvent rendre accessible au public l’ensemble des travaux.
Les fragments, fussent-ils importants, qu’il nous a laissés de son vaste programme ne permettent pas de rétablir le cadre dans lequel il aurait situé ses recherches et de préjuger des conclusions qu’il aurait tirées de celles-ci. J’ai déjà souligné qu’elles se démarquaient de la problématique du « syncrétisme » telle que l’ont, entre autres, développée les africanistes et américanistes, peut être parce qu’elle implique des conjonctures de domination et de résistance qui n’apparaissent guère à travers les faits qu’il étudie. Ses travaux me semblent par ailleurs fort éloignés de la problématique du « métissage », particulièrement présente dans les travaux post-modernes, et qui se propose de rendre compte plus précisément des paysages culturels de la globalisation. On pourrait être tenté d’opérer un rapprochement entre ces observations des effets de la mondialisation contemporaine, et la conjoncture ottomane, dans ses dimensions « impériales » de diversification communautaire (régime du millei) et de créativité locale. Mais ce serait au risque de gommer aussi les différences évidentes entre ces deux contextes historiques. Si, dans la sphère globalisante du pouvoir, cette notion de métissage, y compris dans sa dimension « ethnique », peut avoir une certaine efficacité, en considération du rôle des femmes du harem par exemple ou encore du corps des janissaires, elle apparaît beaucoup moins pertinente dans la sphère culturelle et religieuse « populaire ».
Les travaux d’Altan Gokalp nous orientent plutôt vers d’autres types d’analyses, mettant en évidence les constantes réassignations de sens qui procèdent de l’inscription de ces apports successifs de traits hétérogènes, en effaçant les origines pour produire de nouvelles identités locales. La culture/religion des communautés alevîs en est un parfait exemple et on comprend mieux que son étude ait servi de point de départ à ses réflexions ultérieures. J’en ai donné quelques autres exemples en introduisant certains des thèmes qu’il a approfondis : la légende de la nymphe blonde, le pèlerinage à la nécropole d’Eyup d’Istanbul. On pourrait citer encore l’importance accordée aux fêtes calendaires, en particulier celles relevant du calendrier astral et solaire, réintroduit, comme dans le monde berbère africain, à côté du calendrier lunaire musulman. On peut encore citer les recherches sur le sacrifice qui opposent la tradition ibrahimienne musulmane, organisée en fonction de l’idée de compensation, et le foisonnement des attentes thaumaturgiques qui entraîneront dans les mégalopoles modernes l’organisation de « maisons du sacrifice » pour répondre aux besoins d’offrandes propitiatoires et piaculaires de la population urbaine moderne.
Altan Gokalp, en définitive, me semble moins s’intéresser à la question du « pourquoi » s’organisent cette religiosité populaire, ces identités particulières dont témoigne le fait alevî par exemple, ou le petit peuple d’Istanbul, ou encore le paysan anatolien, qu’au « comment ». Il fait ainsi très peu appel à l’histoire, qui n’est convoquée que dans les premières pages de la thèse, mais il accorde une grande place aux faits de langue, aux approches sémiologiques. Il s’agit là sans doute d’une volonté de prudence, louable et pour une part imposée par la nature des faits qu’il étudie. Ce parti-pris explique la place qu’occupe le langage sous ses différentes expressions symboliques: parole, langue, littérature..., dans l’ensemble de ses travaux je suis vraisemblablement mieux préparé à commenter les analyses d’Altan Gokalp concernant les faits de parenté, qui relèvent de mes domaines de recherche, ou encore, dans une moindre mesure à rendre compte de son approche de la religion populaire, qu’à apprécier ses travaux concernant les faits de langage. Ils relèvent cependant pleinement de sa démarche d’anthropologue et il me semble indispensable de leur consacrer quelques lignes qui compléteront le tableau esquissé de l’auteur et de son œuvre.
L’usage de la langue turque est un trait qui contribue à une certaine permanence de la vision du monde qu’elle commande. Cette langue a pourtant connu des mutations séculaires et porte aussi la marque d’évolutions successives qui résultent d’une histoire pluriculturelle complexe. L’unification moderne est toute récente.
Aux époques impériales, s’opposaient la «langue du palais» et le turc populaire, ne permettant pas significativement la communication quotidienne ; la première utilisait en outre l’alphabet arabe. La révolution kéma-liste s’est traduite par une réforme lexicale qui a produite le turc moderne, remplaçant plus de la moitié du lexique usuel en quelques décennies. Les recherches menées par Altan Gokalp l’ont conduit à se référer à ces registres diversifiés, auquel s’ajoutent les formes du vieux-turc, quand il s’agit de documents anciens qui utilisent en outre une écriture runique originale ; ces anciens alphabets turcs sont tombés en désuétude, même en leurs usages rituels et magiques où s’impose l’alphabet arabe. Si l’on considère encore qu’il écrit principalement en français et qu’il est constamment confronté à la traduction dans cette langue - y compris en traduisant en français des textes littéraires anciens ou modernes -, on ne peut pas être surpris de l’attention qu’il porte à la langue et de la place que prend la référence à celle-ci dans son œuvre.
Un genre traverse ces diverses expressions et formes de la langue turque, c’est le genre épique, les légendes, gestes, et sagas organisées autour de figures héroïques. Altan Gokalp, en collaboration avec Louis Bazin, a traduit une version ancienne de l’un des récits les plus connus des Turcs anciens. Le Livre de Dede Korkut10 est précédé d’une introduction où il résume les traits principaux de 1’« esprit nomade » qui animait ces populations anciennes, et que perpétue dans une certaine mesure l’ethos populaire. À cette littérature correspondait l’écriture de type runique, fortement ritualisée, destinée à être déclamée solennellement et réservée à des circonstances particulières, écriture en quelque sorte « aurale ». Cette fonction rituelle, performative à sa manière, de la langue se retrouve dans la pratique masculine de l’invective, particulièrement riche chez les Turcs, usant largement de la métonymie, qui a sa place aussi dans l’épopée. Elle devient art populaire avec les spectacles de Karagôz, intégrant le cosmopolitisme stamboulien dans ses jeux plurilinguistiques et ses déformations burlesques de la parole héroïque, détournée à des fins transgressives, volontiers scatologiques.
Altan Gokalp s’est par ailleurs beaucoup intéressé à la littérature populaire et à son émergence moderne, accompagnant la révolution kémaliste. Il en recense les courants, les genres et tente d’apprécier leur originalité créatrice. Le roman « paysan » contribue à la re-création dans l’imaginaire de cette catégorie sociale, largement exclue du monde ottoman. Cette production littéraire n’exclut pas la réintroduction du héros, à travers laquelle se forge véritablement le roman moderne, inspiré de la littérature russe mais héritier aussi de la tradition turque animiste ancienne et de l’éthos populaire, dont les ouvrages de Yachar Kemal représentent un aboutissement appelé à un retentissement international. Évitant les pièges d’un folklorisme auquel n’a pas échappé le renouveau de la musique populaire, ces productions littéraires tentent de répondre au constat, souligné par Altan Gokalp après le célèbre romancier, « d’un pays qui n’a pas d’« image » de sa contemporanéité et de sa modernité ».
Il me semble indispensable d’évoquer un dernier thème qui contribuera à compléter le panorama, dressé ici à grands traits, de l’œuvre d’Altan Gokal. Il s’agit de ce que l’on pourrait appeler l’inspiration « féministe » qui le conduit à consacrer une série de publications au destin des femmes et aux représentations du genre dans le monde turc.
En ce domaine, l’approche la plus novatrice, à mes yeux l’une des plus convaincantes, est celle du monde féminin du harem. L’ouvrage récent, Harem. Mythes et réalités11, déplace pourtant l’analyse vers les institutions les plus centrales de la société ottomane, loin de l’univers populaire quotidien qu’il étudie en priorité. Dans ce « beau livre », superbement illustré, Altan Gokalp restitue avec bonheur les fantasmes et les affects de ce monde féminin quasi-carcéral, sans oublier de rappeler les représentations masculines, tant orientales qu’occidentales, qui les projettent dans le monde extérieur. La distanciation que revendiquait volontiers l’auteur quand il s’agissait d’évoquer cette relation complexe entre masculin et féminin, cède le pas à une profonde empathie avec cette société des femmes. Nous replaçant au cœur de l’institution du pouvoir, au palais de Topkapi, il décrit les stratégies masculines et féminines qui se croisent ici à huis-clos, la froideur et la cruauté des rapports qui se nouent dans cet espace que l’on représente, dans la peinture et le roman orientaliste occidental, comme torride, quand il se conjugue avec l’image du hammam, et consacré au sexe. Il souligne le rôle de l’environnement de servantes, d’esclaves et d’eunuques, et leur situation d’enfermement, « sous l’œil » omniprésent du Sultan, maître des lieux. Il n’oublie pas d’évoquer quelques grandes figures féminines, telle la célèbre Roxanne, qui assumeront pleinement leur rôle de « mères des Sultans » dans un contexte où pères et fils, « mis en cage » dans leur enfance, entretiennent des relations antagonistes et souvent meurtrières. Il rappelle encore le rôle de creuset que joue l’institution, l’origine diversifiée des femmes du harem, très généralement étrangères ou provenant des provinces de l’empire, contribuant à la réussite du modèle pluriethnique et pluriculturel ottoman.
Les femmes ne sont pas absentes des autres recherches. La langue est, dans les traditions populaires, l’instrument de la malice des femmes dont se font l’écho les spectacles de Karagôz qui leur accordent une place importante dans leur caricature grotesque de l’héroïsme. Le monde fantastique des héros et des monstres accorde aussi une place importante aux figures féminines. La divinité Umay veillant sur le féminin est le pendant de Tangri dans la religion turque ancienne et des entités féminines souvent dangereuses continueront à peupler l’imaginaire populaire. Les démones associées au placenta féminin menacent les nouvelles mères et leurs enfants, inspirant le rituel de « tuer le placenta » qui protège de ces attaques. Les relations entre les femmes et le personnage paternel de l’ours préfigurent des risques de l’inceste et disent la nécessité de prendre épouse hors de la lignée paternelle.
Comme en beaucoup d’autres sociétés, la domination masculine reste menacée d’une subversion féminine, source de danger immanent ou de périls latents, dont témoignent les amours impossibles de Sarkz, la nymphe blonde, objet de la jalousie de son entourage, ou les conséquences de l’alliance entre les humains et le surnaturel dans le cas de bahmerân, la « reine des serpents ».
Les nécessités rhétoriques de l’exposé, auxquelles j’ai du me plier, la succession des articles présentés dans l’ouvrage, la diversité enfin des approches et des objets de recherche qu’il a pu aborder, pourraient laisser penser à un certain éclectisme de la démarche d’Altan Gokalp, auquel contribuerait son enthousiasme, qu’ont pu constater tous ceux qui l’ont entouré, pour prendre en charge les idées nouvelles, pour découvrir de nouvelles thématiques, pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Ce constat serait erroné, m’apparaît-il, pour deux raisons.
Qu’il s’agisse du programme d’étude de la religion populaire ou, dans sa thèse, de la perspective monographique, j’ai déjà souligné la dimension holiste du projet, qui le rapproche parfois des approches culturalistes. A la suite de Pertev Boratav, dont il revendique une part de l’héritage, il est plus soucieux de rendre compte de la richesse innovante de la tradition populaire turque, que de procéder à des simplifications universalistes de type frazérien. Il est néanmoins toujours soucieux, par ailleurs, de s’inscrire dans le champ comparatif que fonde la démarche anthropologique dont il utilise avec brio les outils.
Altan avait moins de vingt ans quand il s’est installé en France ; il est un exemple de l’intégration républicaine et en est devenu un défenseur sans réserve à l’heure où certains s’interrogent sur les valeurs qu’elle recouvre. Sa parfaite maîtrise des langues de travail, le français et le turc entre autres, et, plus généralement, la place qu’il a accordée à l’expression linguistique tout au long de ses recherches ne sont pas sans avoir quelques liens avec sa situation initiale d’«émigré». Totalement immergé dans une culture française dont il admirait les valeurs historiques, il se rendait aussi très fréquemment en Turquie. La fine exploration des champs sémantiques « comparés », qui est visible déjà dans sa thèse, n’est pas seulement un choix de méthode intellectuellement valorisé, elle est le fruit d’une expérience vivante attestant de la richesse de cette diversité culturelle, de la réussite des passages entre les cultures.
S’il me fallait conclure je retiendrai cette image d’Altan Gokalp comme un « passeur » qui aura poursuivi tout au long de ses recherches cette « traduction» d’une culture étrangère sous les signes de la culture française, en exploitant tous les avantages que cet exercice apportait à la connaissance de sa propre culture d’origine. Ne s’agit-il pas d’une autre manière de rendre ' compte de l’image du « conteur » que j’introduisais dans les premières lignes de cette préface? Il a aussi assumé ce passage en sens inverse, investissant! une part de ses activités dans l’organisation et la diffusion de l’enseignement du turc dans le système d’éducation français, instrument de l’intégration républicaine certes, mais aussi garantie que d’autres, s’inspirant peut être de lui, prendront en charge ces fonctions de passeur qu’il a assumées sa vie durant.
Pierre Bonte
Directeur de recherche émérite au CNRS
Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Paris
1. Altan Gokalp a souvent fait référence au roman de Yachar Kemal intitulé: Tu écraseras le serpent, Paris, Gallimard, 1982. Il a lui même traduit Regarde donc l’Euphrate charrier le sang, Paris, Gallimard, 2004, et consacré plusieurs études au grand romancier turc. Voir ici même : « Lire Yachar Kemal », p. 523.
2. Éditée pour la première fois en 1980 à la Société d’ethnographie.
3. L’adorcisme désigne un rituel de possession où les esprits sont invoqués, par opposition à exorcisme par lequel on s’efforce de les chasser.
4. Zar : rituel de possession qui s’étend de l’Egypte à l’Iran ; il consiste à se concilier la bienveillance des esprits.
5. Bori : culte de possession pratiqué notamment chez les Haoussas du Nigéria.
6. Dans l’empire ottoman, terre (ou «fief» non héréditaire) dont le revenu était attribué à un militaire ou à un administrateur civil.
7. Éditions de l’EHESS, coll. «Civilisation et Sociétés».
8. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2009.
9. Indispensable pour parvenir au sommet de la hiérarchie sociale, donnant lieu à des dépenses somptuaires, ce mariage coutumier a souvent été accusé d’être responsable du sous-développement de l’archipel.
10. Gallimard, coll. «Aube des Peuples», 1998.
11. Éditions Ouest-France, 2008.
Avant-propos
Le présent ouvrage regroupe l’essentiel des travaux d’Altan Gokalp (1942-2010) en trois parties différentes. D’abord sa thèse, Têtes rouges et bouches noires. Une confrérie tribale de l’Ouest anatolien, qui avait été publiée en 1980 par la Société d’ethnographie. Ensuite, une deuxième partie reprend le manuscrit d’un ensemble de ses articles qu’il préparait sous le titre De l’Animisme à l’islam populaire: l’univers symbolique des Turcs, sa mort, survenue en avril 2010 l’ayant empêché de mener à son terme cette entreprise ; à ce manuscrit retrouvé dans ses papiers, nous nous sommes permis d’apporter quelques retouches qu’Altan Gokalp aurait certainement faites de lui-même avant de le livrer à la publication. Enfin, dans une troisième partie intitulée De la religion, de la langue et de la culture des Turcs d’Anatolie, nous avons regroupé ceux de ses articles déjà publiés qui nous ont paru les plus importants et les plus significatifs.
Dans notre choix des textes qui composent la troisième partie, nous avons privilégié l’Altan Gokalp anthropologue, mais il faut savoir que ses publications sont nombreuses dans des domaines qui dépassent le strict champ de l’anthropologie : l’immigration des populations turques en Europe, à laquelle il a consacré beaucoup de son énergie, l’enseignement et l’évaluation de la langue turque dans l’enseignement secondaire lorsqu’il était chargé de mission auprès de l’Inspection générale de l’Éducation nationale ; nous avons volontairement écarté la plupart de ces textes parce qu’ils nous paraissaient parfois datés, parfois trop techniques1. En revanche nous avons inclus plusieurs de ses articles relevant de divers aspects de la culture littéraire, domaine auquel son approche anthropologique a ouvert de nouvelles perspectives : par exemple, les articles qui explorent les différentes formes de l’épopée et les liens entre passé turco-ottoman et présent turc ; son introduction à la traduction du Livre de Dede Korkut (traduction qui a été le résultat d’un long travail avec Louis Bazin), ainsi que ses analyses de Karagôz et des héros de Yaşar Kemal.
Nous avons été amenés parfois à apporter aux textes originaux des corrections mineures, à revoir des citations et à préciser des références. Les systèmes de translittération utilisés par Altan Gokalp ayant varié d’un texte à l’autre, nous les avons maintenus tels quels, en espérant que le lecteur ne sera pas choqué de trouver sous une même couverture le nom de son grand ami, qu’il a tant contribué à faire connaître et aimer en France, écrit tantôt Yaşar Kemal, tantôt Yachar Kemal.
Il ne s’agit donc pas des œuvres complètes d’Altan Gokalp (son dernier livre Le Harem étant par exemple exclu de cette sélection), mais d’un choix où la matière anthropologique occupe la première place : représentant français d’une discipline très minoritaire en Turquie, où les études folkloriques occupent trop souvent la place de l’ethnologie, voire de l’anthropologie, Altan Gokalp mérite d’être mieux connu, les problématiques qu’il aborde pouvant déborder sur d’autres domaines proches comme l’histoire et permettre de porter un regard différent sur la culture turque.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé dans ce travail, en particulier Sébastien, Mathias et Marianne Gokalp qui nous ont grandement facilité la tâche en nous permettant d’accéder à la bibliothèque et aux papiers personnels de leur père. Notre reconnaissance va également à Maurice Godelier et CNRS Editions, qui ont réservé un accueil chaleureux à ce projet et lui ont permis de se concrétiser rapidement.
François Georgeon et Timour Muhidine
1. Le lecteur intéressé trouvera la référence à la plupart de ces textes dans la bibliographie d’Altan Gokalp à paraître dans Turcica, revue d’études turques, t. 42, Louvain, Editions Peeters, numéro daté de 2010.
…..
|