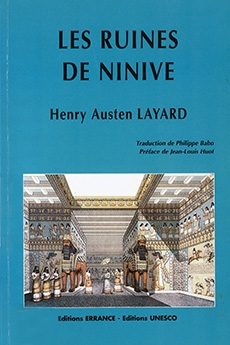|
PREFACE
Henry Layard (1817-1894) est l'un des pères fondateurs de l'archéologie du Proche-Orient ancien. Le British Muséum lui doit la magnifique collection de reliefs néo-assyriens qui sont l'orgueil de ses collections. Cependant, le titre de son ouvrage, publié à l'âge de trente-deux ans, Ninive et ses vestiges, (Nineveh and its Remains, Londres, 1849), dont on trouvera ici une traduction intitulée Les ruines de Ninive, est trompeur. Il est peu question de la véritable Ninive, dans ces pages. L'homme, doué d'une plume élégante et spirituelle, voyageur intrépide, sut également observer les populations si diverses qui occupaient, de son temps, le nord-est de l'Irak actuel, alors confins assez ignorés des empires ottoman et perse. Les chapitres qu'il leur a consacrés sont une source appréciable de nos connaissances sur ces régions à son époque. Mais ce sont là titres de gloire de jeunesse. En 1851, à trente-quatre ans, il interrompait brutalement sa carrière d'aventurier et d'explorateur pour se consacrer à une activité de diplomate qui ne fut pas sans succès.
On ne trouvera pas, dans ce livre, un savant exposé de la civilisation néo-assyrienne dont, à son époque, on ignorait presque tout. On n'y cherchera pas davantage une enquête ethnographique sur des populations méconnues. A l'époque de Layard, l'archéologie et l'ethnologie sont encore dans l'enfance et les récits de voyageurs en terre ottomane - ou perse - ne sont pas une nouveauté, tant s'en faut. Les premiers remontent au XVII' siècle, voire à la Renaissance ou même à la fin du Moyen Age. Mais si les voyages se succédaient, le regard évoluait sans çesse. De Volney à Layard, pour se limiter à la fin du XVIH' siècle et à la première moitié du XIX1', on est passé de celui du voyageur à celui de l'archéologue-ethnologue. Layard est tout cela à la fois. 11 n'est pas insensible à l'exotisme. Il est conscient des risques qu'il encourt parfois. Il veut enrichir les connaissances scientifiques de son époque, tout en n'oubliant pas d'expédier le fruit de ses fouilles à Londres. Pouvait-il, à l'époque, envisager une autre solution ? Par-delà un comportement souvent paternaliste, il laisse percer des sentiments de réelle amitié pour tel ou tel personnage rencontré et fréquenté pendant de longs mois, même si la confrontation entre cet aristocrate anglais et un obscur agha du Kurdistan ne se déroule pas vraiment sur un pied d'égalité.
Le nom de l'antique cité de Ninive était connu des contemporains de Layard, ne serait-ce que par la lecture des textes bibliques et des auteurs grecs. Mais où localiser, sur le terrain, la « grande ville » dont parle la Bible ? On n'était pas encore assuré, à l'époque de la publication de son ouvrage, de la localisation exacte de la cité de Jonas (Jon.1.2) et d'Assurbanipal, même si Layard, à la fin de sa première mission, en eut le pressentiment, puis la certitude. En face de l'actuelle Mossoul, les ruines imposantes de Quyundjik constituaient un bon candidat. Mais les premières explorations, on le verra, avaient été décevantes et l'on cherchait ailleurs. Layard avait visité un autre endroit, non moins grand, où il était persuadé qu'il allait retrouver la capitale des rois assyriens. Ses recherches principales, celles qui occupent la majorité des pages de sa relation, se déroulèrent sur ce dernier site, que les habitants appelaient Nimrud, du nom du grand chasseur légendaire Nemrod. Il se trouve sur la rive orientale du Tigre, à une quarantaine de kilomètres au sud de Mossoul. Layard n'hésita donc pas à intituler Ninive et ses vestiges le récit consacré en très grande partie à ses travaux à Nimrud. Son ami et concurrent, le consul français P. E. Botta, qui venait d'explorer avec succès un autre grand site des environs, celui de Khorsabad, à 16 km de Mossoul, publiait au même moment le compte rendu de ses travaux en une série monumentale intitulée, elle aussi par erreur, Monuments de Ninive (5 vol. Imprimerie Nationale, Paris, 1849-1850). Aucun des deux emplacements n'était le bon. Il fallut attendre quelques mois pour avoir enfin la certitude que si Khorsabad était l'ancienne Dur-Sharrukin de Sargon II (721-705 av. J.-C.) et Nimrud l'ancienne Kalhu, la capitale d'Assumasirpal II (883-859 av. J.-C.), la véritable Ninive, la ville de Sennachérib (704-681 av. J.-C.), d'Assurbanipal (668-627 av. J.-C.) et du prophète Jonas, gisait en face de l'actuelle Mossoul, sur l'autre rive du Tigre, dissimulée sous le nom de Quyundjik (le petit mouton) et de Nabi Yunus (le prophète Jonas), ce que les travaux de notre héros lui-même établirent sans contestation possible dès 1850.
Le livre porte un long sous-titre : Les ruines de Ninive, comprenant le récit d'un voyage chez les chrétiens chaldéens du Kurdistan, et les Yezidis, ou Adorateurs du Diable. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le supposer, d'une astuce d'éditeur pour attirer le chaland. Hier comme aujourd'hui, il vaut mieux publier Mes dangereuses plongées sous-marines à... ou Trésors enfouis de la ville fabuleuse de... que Rapport sur la 17' campagne de fouilles dans le secteur nord-ouest de... Dans le cas du livre de Layard, les chrétiens du Kurdistan et les Adorateurs du Diable ne sont pas évoqués seulement à titre d'appât. Layard les a rencontrés, s'y est intéressé, et a rapporté de son séjour au milieu de ces populations oubliées un tableau très vivant, bien informé et qui se lit aujourd'hui encore avec grand intérêt. Ce qu'on appellerait de nos jours une enquête ethnographique occupe plus de la moitié de son livre. Le récit archéologique (chapitres 1 à 3 et 10 à 14) encadre un tableau du Kurdistan contemporain de l'époque de Layard, aux chapitres 4 à 9. La « question de Mossoul », comme on allait dire durant les années vingt, c'est-à-dire le problème du Kurdistan, comme on l'appelle de nos jours, était déjà en gestation au milieu du XIX' siècle et il est loin d'être réglé encore aujourd'hui. Le tableau que Layard brosse de cette région et de ses occupants, de ce point de vue, présente un vif intérêt.
Qu'allait donc faire dans les montagnes perdues du Kurdistan ce jeune gentleman britannique, au début des années 1840 ? Henry Layard avait quitté les rives de la Tamise, à vingt-deux ans, en 1839. Placé dans un cabinet d'avocat, il espérait faire fortune à l'étranger. En compagnie d'un ami, E.-L. Mitford, il entreprit de cheminer à travers les empires ottoman et perse (à cheval !) pour gagner tranquillement les Indes et même Ceylan, où des relations familiales lui laissaient entrevoir une situation. La voie de terre, à cette époque antérieure au percement du canal de Suez (1869), n'était guère moins rapide, si l'on ose dire, que la route maritime et offrait l'avantage de voir du pays. Mais, après avoir ainsi parcouru, durant trois ans, l'actuelle Turquie, le Levant, la vallée du Tigre et de l'Euphrate et le plateau iranien, Layard s'était séparé de son ami à Hamadan, en Perse, et était finalement rentré à Constantinople, alors capitale déjà très européanisée de l'immense empire ottoman. Au cours de ses pérégrinations, il avait rencontré, à Mossoul, le consul français P. E. Botta. La France, sur les traces de l'Angleterre et de la route des Indes, venait d'ouvrir en 1842 un consulat à Mossoul, alors grande étape terrestre entre Constantinople, Bagdad, Téhéran et Bombay. Fils d'un historien piémontais, P. E. Botta (1802-1870), bon arabisant, ancien consul à Alexandrie, connaissait déjà l'Egypte, le Liban et le Yemen. II avait même fait, de 1826 à 1829, le tour du monde, ce qui, à l'époque, n'était pas rien. Passionné d'archéologie dès l'enfance, semble-t-il, en correspondance avec le secrétaire de la jeune Société Asiatique de Paris (fondée en 1822), Botta n'était pas ignorant de l'antique civilisation assyrienne, au cœur de laquelle se trouvait son nouveau poste. Le British Muséum, à cette époque, avait déjà acquis des antiquités en provenance de Mésopotamie et en particulier de Mossoul. Rêvant sur le balcon de sa résidence, en face des ruines de Quyundjik qui dominent le fleuve sur l'autre rive, il eut l'idée d'v faire creuser des ouvriers à sa solde. Déçu des premiers résultats, peu spectaculaires, il apprit en mars 1843 qu'on avait trouvé, à quelques kilomètres de là, dans le village de Khorsabad, des pierres sculptées et des inscriptions qu'on appelait déjà cunéiformes. Il en avertit la Société Asiatique et envoya sur place des équipes d'ouvriers, rétribuées sur ses fonds personnels. 11 v dégagea, en croyant qu'il s'agissait de l'antique Ninive, le palais de Sargon II et d'énormes reliefs sculptés. Une subvention publique vint alors prendre le relais de sa cassette et un dessinateur lui fut adjoint (E. Flandin). En butte aux tracasseries du gouverneur turc de Mossoul, Botta fit intervenir l'ambassadeur français à Constantinople et ses fouilles purent se poursuivre jusqu'en octobre 1844. Les antiquités retrouvées arrivèrent en Louvre dès 1847. L'établissement ouvrit alors le premier « Musée assyrien » du monde. Botta fut ensuite nommé consul à Jérusalem en avril 1848 et finit sa carrière à Tripoli de Libye. Il mourut, passablement oublié, en 1870.
C'est donc un homme de quinze ans son aîné que le jeune Layard rencontre à Mossoul en 1842, lors de son voyage de retour vers Constantinople. On lira les pages pleines de déférence que Layard consacra, quelques années plus tard, à celui qui demeura, pour lui, l'inventeur de l'archéologie assyrienne. Le britannique demeura trois ans à Constantinople, de 1842 à 1845, où il servit d'agent non officiel attaché à l'ambassade d'Angleterre auprès de la Sublime Porte. Il y fut remarqué par son ambassadeur, Sir Stratford Canning, bientôt intéressé par les récits de ce jeune voyageur qui lui décrivait les confins obscurs de l'empire ottoman et de la Perse. Il lui raconte les champs de ruines inexplorés de la région de Mossoul et les premiers travaux de Botta avec lequel il était resté en relations épistolaires. Il lui fait part de son désir de tenter, lui aussi, sa chance. Les Antiquités ne laissaient pas Sir Stratford indifférent. 11 obtiendra du gouvernement turc, en 1846, les vestiges du Mausolée d'Halicarnasse pour le British Muséum. Il se laissa convaincre par l'enthousiasme du jeune homme, obtint les autorisations nécessaires de la Sublime Porte et lui ouvrit un crédit de 160 livres sterling pour creuser à Nimrud. Dès octobre 1845, Layard était de retour à Mossoul. Botta, rappelé en France, avait été remplacé par un simple agent consulaire, Rouet. En novembre, Layard s'installe à Nimrud. Il y travailla avec acharnement jusqu'en juin 1847.
En août 1846, « pour éviter la chaleur », il interrompt ses travaux (chap. 6) et en- . treprend un long voyage dans le haut Kurdistan à partir de Ain Sifni, où il rencontre les Yezidis et poursuit jusqu'à Amadya, une petite bourgade d'accès point trop difficile, près du seuil de partage des eaux entre les vallées du Grand Zab et du Habour du Tigre. Il atteint le village d'Ashita (en Turquie actuelle) et s'approche même de Julamerik, l'actuel Côlemerik, la capitale des Kurdes du Hakkari, bâtie sur un promontoire qui domine la rive droite du Grand Zab; Durant ce périple, il traverse des villages chrétiens terrorisés et figés dans l'attente de raids des seigneurs kurdes. Le massacre attendu se produira, d'ailleurs, peu après son passage (chap. 7). Il consacre un court chapitre à l'histoire des chrétiens chaldéens (chap. 8), puis à la secte des Yezidis (chap. 9) qu'il va visiter lors d'un voyage à la limite du Djebel Sinjar, à Tel Afar.
Ce n'est pas le moindre charme du livre de Layard que le tableau extrêmement vivant qu'il trace de ces contrées bien éloignées de Constantinople. La région qu'il va parcourir à 29 ans est actuellement partagée par la frontière turco-irakienne. Autour de la grande ville de Mossoul s'étendent les steppes de la Djezireh, berceau de l'antique empire néo-assyrien (IX'-VII1 siècles av. J.-C.). Pays de collines très faiblement ondulées, ces steppes s'étendent, en réalité, au-delà des frontières modernes, artificielles, entre la Syrie et l'Irak, depuis les confins du Zagros, la grande chaîne de montagne qui limite le plateau iranien, jusqu'à la région d'Alep en Syrie du nord. Au nord et à l'est de la région de Mossoul, s'élèvent les montagnes du Kurdistan, qui culminent en Turquie à 3 500 m d'altitude, au sud du lac de Van, et à la frontière irano-irakienne à peu près à la même hauteur, à l'ouest du lac d'Ur-mia. A l'époque de Layard, l'essentiel du Kurdistan d'aujourd'hui était partagé entre les empires ottoman et perse. Il serait bien hasardeux cependant de parler de frontières, s'agissant de régions où - hier comme aujourd'hui - les rapports sociaux s'organisent bien plus selon des allégeances familiales ou tribales que d'après une appartenance nationale ou étatique. Ces notions fort modernes sont à mille année-lumière des structures mentales des cheikhs ou aghiis, petits despotes locaux gérant de manière absolue des centaines, voire des milliers de dépendants. C'est en face d'une mosaïque extraordinairement confuse de peuples et de religions, reflet et conséquence d'une histoire plus que millénaire, que le jeune Layard se trouva placé subitement. Il sut tirer un portrait fort vivant et fort clair de cet imbroglio. Ces pages ne sont pas sans intérêt aujourd'hui. La « question kurde » n'est-elle pas une des clefs des problèmes de l'Irak contemporain ? Le pétrole n'a fait qu'aggraver la complexité du dossier, mais on se rappellera que, si son existence est connue des négociateurs des traités qui furent signés à la suite de la Première Guerre mondiale, il ne fut réellement exploité (à Baba Gurga, ou Gourgour, au voisinage de Kirkouk) qu'à partir de 1927. Le texte de Layard ne mentionne qu'en passant l'existence du bitume, appelé à l'avenir que l'on sait.
A l'époque de Layard, la situation politique est simple. Le sultan turc règne sur ses lointains sujets par l'intermédiaire du pacha de Mossoul et de quelques garnisons de réguliers et de supplétifs. Les populations, soumises à leurs seigneurs locaux, versent au sultan, Commandeur des Croyants, un tribut qui marque à la fois « leur soumission à sa suzeraineté militaire et à l'autorité religieuse du Khalifat » (A. Lévy). Mais si, dans les armées 1840, la Sublime Porte n'est pas encore dans l'état de déliquescence qui sera le sien au début du XXe siècle, c'est peu de dire que la steppe de Mossoul n'occupe guère les esprits des bureaux de Constantinople. Il s'agit plutôt d'une région limitrophe, bien reculée, peu opulente et donc peu rentable. Ce n'est pas une promotion que d'être nommé pacha de Mossoul. Si le pouvoir turc s'exerce encore de manière à peu près contrôlée à Mossoul même, on verra, à la lecture de Layard, que le poids réel des représentants de la Porte, dès qu'on quitte la grande ville, paraît bien léger.
Sous la suzeraineté du sultan, quelle mosaïque extraordinaire ! Pour comprendre le récit de Layard, on n'oubliera pas que les peuples qui habitent ces pays s'entrecroisent sans se mélanger, selon leur appartenance ethnique ou religieuse. Mossoul est la seule ville d'importance (entre 50 et 100 000 habitants). Les autres « villes », Zakho ou Dohuk au nord, Erbil ci l'est, ne sont que de gros bourgs ou des marchés ruraux. Au nord-est, perdu dans les montagnes, presque à la frontière turco-irakienne actuelle, Amadva est un village. Les autres « agglomérations » ne regroupent, très souvent, qu'une douzaine de cabanes en torchis ou en pierrailles. Au-delà de Mossoul et de quelques bourgades, la présence turque est inexistante.
Sur ces vastes espaces, les populations non turques sont bien différentes les unes des autres. Au sud-ouest de Mossoul s'étend une steppe désertique, terrain de parcours des tribus arabes bédouines, éleveurs de brebis, de chevaux et de chameaux, à la recherche perpétuelle de maigres herbages. Musulmanes, ces tribus sont les mêmes que celles qui arpentent les steppes syriennes, plus à l'ouest. La plus connue de ces grands tribus arabes est celle des Shammar.
En revanche, au nord et à l'est de Mossoul, dans le pavs montagneux, on pénètre dans le territoire des Kurdes. Les Kurdes sont peut-être les descendants de peuplades que Strabon, à l'époque d'Auguste, nommait les << Gordéens ». Ils ne sont ni turcs, ni arabes. Leur langue est indo-iranienne. Leur territoire est centré sur les hautes montagnes du Hakkari qui s'élèvent au sud du lac de Van. Mais le terrain de parcours des tribus kurdes est immense et s'étend jusqu'au centre de la chaîne du Zagros, en pavs Lur et Bakhtiari. A l'époque de Layard, de nombreuses tribus kurdes font allégeance au sultan turc. Elles sont présentes dans tout le bassin du Grand et du Petit Zab, deux affluents du Tigre. Dans les vallées, de petits villages d'agriculteurs sont soumis à des seigneurs locaux, les agitas. Sur les hautes pentes transhument des tribus d'éleveurs à peine contrôlées, sinon pas du tout, par les autorités. Dans cette région, les Kurdes musulmans sont majoritaires.
Ces Kurdes font mauvais ménage avec une minorité chrétienne qui partage pourtant le même genre de vie et d'une certaine façon, la même organisation sociale. D'origine araméenne, les chrétiens de la région de Mossoul s'étaient ralliés dès le Ve siècle à l'hérésie nestorienne. Nestorius est un moine syrien devenu patriarche de Constantinople en 425. 11 est à l'origine de l'hérésie qui porte son nom. Les nestoriens affirmaient l'existence dans le Christ de deux personnes séparées, l'homme et le dieu. Le Christ était, en quelque sorte, un homme habité par Dieu. Ces chrétiens furent jadis rassemblés en une puissante église dont l'influence se fit sentir jusqu'à la cour du grand Khan des Mongols. C'est avec des Mongols nestoriens qu'au milieu du XIII1’ siècle, le franciscain Guillaume de Rubrouck, envoyé par la chrétienté, eut des débats théologiques animés à la cour du petit-fils de Gen-gis Khan. Mais cette grande église ne se remit pas du désastre des invasions turco-mongoles de Tamerlan, à la fin du XIVe siècle. Les groupes d'Orient, réfugiés dans les montagnes du Kurdistan, très affaiblis, furent approchés par la Papauté au XVIe siècle. Les chrétiens des villages les plus proches du Tigre acceptèrent la protection du Pape en 1552 et formèrent alors une église chaldéeiine unie à Rome, sous la tutelle d'un Patriarche de Babylone, installé d'abord à Dyarbekir, puis à Mossoul. Il réside, de nos jours, à Bagdad. Les Chaldéens que rencontra Layard étaient en réalité sous la dépendance de seigneurs (les agitas) kurdes ou turcs, qyi possédaient la terre. Quant aux chrétiens de la haute montagne, non ralliés à Rome, ils sont, comme les Kurdes qui les entourent, organisés en tribus d'éleveurs transhumants. Appelés Assyriens, ils dépendent pour leur part d'un patriarche qui porte traditionnellement le nom de Mar Shimoun (le Seigneur Simon, c'est-à-dire Pierre), qui réside également à Mossoul. Si les liturgies sont en syriaque ancien, ces groupes chrétiens parlent une langue d'origine syro-araméenne, bien éloignée de l'arabe et totalement étrangère au kurde. Une enquête de la Société des Nations, analysée récemment par A. Lévy, qui date de 1925, soixante-quinze ans environ après le passage de Layard, devait répertorier trois grandes tribus nestoriennes, les Tiyari, les Tchuma et les Gawar. Layard a visité longuement les villages Tivari et Tchuma. Il est étonnant de constater que, encore de nos jours, ces églises chrétiennes portent le nom des Chaldéens et des Assyriens, vieilles dénominations de Babylone et d'As-sur au premier millénaire av. J.-C. Mais personne, à l'époque de Layard, comme de nos jours d'ailleurs, ne revendiquait des ascendances aussi lointaines. Les Chaldéens et les Assyriens de l'Antiquité avaient totalement sombré dans l'oubli.
Naturellement, les rapports entre Kurdes et chrétiens sont exécrables. Lorsque Layard traverse le Haut Pays, les populations chrétiennes redoutent de nouveaux massacres, après ceux qui venaient de se produire en 1843. Les Kurdes, encouragés par la Porte, s'étaient jetés sur les villages nestoriens, la population avait été convertie de force et les maisons détruites. De nouveaux massacres eurent lieu quelque temps après son passage. Ils ne cessèrent plus tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, parallèlement au délitement de plus en plus prononcé de l'autorité turque sur ces confins de l'empire. C'est au sein de ce terreau bigarré que la Société des Nations tentera d'organiser, après les traités de Sèvres et de Lausanne, des entités politiques fondées sur d'autres principes. Mais les nouveaux Etats issus de la disparition de l'empire ottoman (Turquie, Syrie, Irak) ne s'accommoderont plus d'un contrôle aussi lâche que celui qu'exerçaient les représentant du sultan sur les sujets qui faisaient allégeance. Ils rechercheront l'intégration et de nouveaux problèmes ne manqueront pas de surgir.
Pour compliquer encore le tableau, il faut mentionner un dernier groupe, auquel Layard a consacré son chapitre 9, les fameux Yezidis ou Adorateurs du Diable évoqués dans le sous-titre de l'ouvrage. Les Yezidis sont des Kurdes, mais cette curieuse secte, peu nombreuse, a emprunté à toutes les religions du Livre des éléments divers pour constituer une sorte de mosaïque des principales croyances. Dieu parle kurde, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi le Coran. Les Yezidis adorent le démiurge, Melek Taiis, le Roi-Paon, ou le Phénix, créateur du monde matériel. Mais ils croient aussi à la transmigration des âmes et vénèrent les éléments de la nature, le soleil, la lune, les sources, les arbres ou le feu. Leur sanctuaire, près de al Qosh, au nord-est de Mossoul, est connu sous le nom de Cheikh Adi, le fondateur de la secte. Ils y sacrifient deux fois par an un taureau blanc. Ce groupe non prosélyte (on devient yezidi uniquement par la naissance) et endogame, est organisé en six castes sous la tutelle de l'émir des Yezidis. La majorité des Yezidis résidait, à l'époque de Layard, dans le Djebel Sinjar (à l'ouest de l'Irak actuel) où une violente répression venait de s'abattre sur eux en 1838. Une minorité s'était installée autour du sanctuaire de Cheikh Adi.
Une photographie récente d'un notable de la secte, Baba Jawish, prise dans les années 1970, représente ce personnage couvert d'un bonnet de laine dont la forme rappelle fortement la coiffure de Gudéa (vers 2150 av. J.-C.), un prince de Babylonie méridionale. Mais, pas plus que les Assyriens ou les Chaldéens chrétiens, les Yezidis n'ont conservé de référence quelconque à un passé oriental si lointain.
Yezidis ou Nestoriens sont des reliques historiques réfugiées dans les montagnes du Kurdistan depuis longtemps, profitant du caractère inhospitalier et peu visité de ces régions pour s'y mettre à l'abri. Quand Layard les décrit, au milieu du XIXe siècle, leur situation économique et sociale n'est pas loin d'être catastrophique. Désolé par les raids, les pillages et les massacres, le pays est en ruine et les villages, pour la plupart, abandonnés.
Mais qu'en est-il de l'archéologie, au sein de ces voyages dans des régions en déshérence ? Lorsque Layard revient à Mossoul en octobre 1845, muni des crédits de Sir Stratford Canning, Botta venait de rentrer en France. L'intérim du consulat français avait été confié à Rouet, qui, avec l'approbation du pacha turc, Kiritli Oglu (« le Crétois »), avait repris les fouilles de Quvundjik, en face de Mossoul. Layard, pour sa part, est persuadé que les ruines de l'antique Ninive se trouvent beaucoup plus au sud, à Nimrud. Rouet semblait d'ailleurs plus intéressé par la découverte récente de reliefs rupestres néo-assvriens sur les rives du Gomel, à Bavian, à 50 km de Mossoul et à Maltaï, dans la région de Dohuk, à 60 km de la ville. Fin novembre 1845, Layard s'installe à Nimrud. Malgré des difficultés picaresques avec « le Crétois », dont il rend compte avec verve et humour (chap. 3), il ouvre des tranchées et découvre lui aussi des antiquités en grand nombre. Ses trouvailles sont si spectaculaires qu'il décide, peu avant Noël 1845, de se rendre à Bagdad pour y rencontrer Henry Rawlinson, agent politique de la Compagnie des Indes Orientales (alors âgé de trente-cinq ans). Durant toute la première moitié du XIXe siècle, la résidence de l'agent politique est le point de ralliement des voyageurs anglais qui traversent la Mésopotamie. Elle joue le rôle d'une sorte d'ambassade dans toute la partie arabe de l'empire ottoman. Rawlinson est un vieux routier de l'Inde, passionné d'orientalisme. Il avait copié, dans des conditions acrobatiques, la grande inscription aché-ménide de Behistoun, dans une vallée du Zagros. Ce texte fondamental date du début du règne de Darius (vers 520 av. J.-C.). Ce fut la clef du déchiffrement des caractères cunéiformes. Durant cette rencontre, Layard et Rawlinson prennent toutes dispositions utiles pour le transfert à Londres des monuments découverts par Layard à Nimrud, par le Tigre et le Golfe vers Bombay et la Malle des Indes. Puis il retourne à Nimrud. Durant toute l'année 1846, les trouvailles se succèdent. Layard est aidé par le frère du consul britannique à Mossoul, Hormuzd Rassam, qui demeura ensuite son collaborateur attitré dans tout le pays. A Nimrud même, il éventre plusieurs salles de ce qu'on reconnaîtra plus tard être le palais du roi As-surnasirpal II (883-859 av. J.-C.). Les plans relevés sont très sommaires, de nombreux reliefs sont malheureusement détruits à peine découverts, en raison de leur état de dégradation qui interdisait de songer à un transport, mais aussi de l'inexpérience. Quelques recherches sont également entreprises à Quyundjik, mais c'est Nimrud surtout qui retient l'attention de Layard. Il y exhume des taureaux et des lions ailés, ainsi que de nombreux reliefs. Il y reconnaît le roi et ses soldats, l'armée assyrienne, des représentations de jardins ou de scènes de chasse, exécutées en un style précis et vivant qui le stupéfie. Le palais d'Adad Nirari III (8J0-783 av. J.-C.), sur la bordure occidentale du tell, livre des sculptures et des reliefs, mais on fouille aussi au centre du site le palais de Salmanasar III (858-824 av. J.-C.) où il découvre des lions et des taureaux, ainsi que le fameux « obélisque noir » de Salmanasar III, inscrit, où il reconnaît le roi d'Israël Jéhu faisant sa soumission, dont parle IR 19.16. Une centaine de dalles couvertes de reliefs (« les pages d'un livre géant » du chap. 11) illustrent le règne de Téglath-Phalazar III (744-727 av. J.-C.).
Dès octobre 1846, après son excursion dans les montagnes kurdes, il retourne à ses chantiers et y poursuit ses recherches avec acharnement jusqu'en juin 1847, à Nimrud, mais aussi plus au sud, à Qalaat Shergat, qu'il ignore encore être l'antique capitale assyrienne, la ville éponyme d'Assur. Il en exhume une grande statue qu'il pense être celle du roi Salmanasar III, mais qui est vraisemblablement une statue divine dédiée par le roi après qu'il eut restauré le rempart d'Assur. 11 rouvre aussi des tranchées à Quyundjik. Il sait qu'il n'a, en réalité, qu'à peine égratigné le site et que d'autres poursuivront le travail. Après la Seconde Guerre mondiale, un archéologue britannique, Sir Max Mallowan, aidé de D. Oates, reprendra les recherches (1949-1963). M. Mallowan les publiera, en un hommage évident à son grand prédécesseur, sous le titre de Niuiriid aiid its Reniains. En 1846, Layard risque l'envoi à Londres de ses trouvailles, avec les moyens du bord (chap. 13), ce qui n'était pas une mince affaire. Ses principales trouvailles, chargées sur des radeaux, descendent le Tigre jusqu'à Bagdad (en plusieurs envois, de juillet 1846 à juin 1847) puis gagnent Bassorah, d'où des bateaux les transportent à Bombay et Londres, ce qui permet à Layard de méditer, en quelques lignes fort romantiques, sur l'étrange destinée des antiques sculptures néo-assyriennes.
Layard était très conscient de l'importance de ses trouvailles. Il avait, avec Botta, rendu à la connaissance du monde savant et du grand public, une civilisation oubliée. On ne connaissait, avant eux, de ces villes et de ces rois, que ce que les textes bibliques, partiels et souvent partiaux (et pour cause 1) en disaient. Les écrivains grecs, pour leur part, n'avaient véhiculé que des historiettes romancées sur des personnages légendaires, Sémiramis, Nitocris ou un certain Ninos (c'est-à-dire Ninive). Mais, de 1842 avec Botta, et 1845, avec Layard, jusqu'en 1847, c'est tout un monde effacé, mais bien réel, qui ressurgit. Layard se demanda même s'il n'était pas arrivé juste à temps. N'aurait-on pas, quelques années plus tard, empêché le transfert de toutes ces richesses artistiques sur les bords lointains de la Tamise (chap. 14) ? En réalité, il faudra attendre 1934 pour qu'une loi irakienne sur les antiquités n'interdise définitivement l'exportation du patrimoine national. Les missions françaises et anglaises quittèrent alors le pays et renoncèrent (jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale) à y poursuivre leurs travaux. D'autres, plus sagement, restèrent à l'œuvre.
Le 24 juin 1847, ses crédits épuisés, Layard quitta Mossoul et regagna Londres, à travers les montagnes anatoliennes et Constantinople. Il demeura quelque temps en Angleterre.
Lorsque ses trouvailles arrivèrent à Londres, elles soulevèrent autant d'enthousiasme que celles de Botta à Paris. Layard, sans attendre, prépara et publia à Londres, dès 1849, un récit de ses découvertes et de ses voyages dans le Kurdistan. C'est le livre qu'on lira ci-après.
L'heureux découvreur, devenu célèbre, fut nommé attaché à l'ambassade britannique de Constantinople. Le British Muséum décida d'organiser une nouvelle expédition, dont Layard recevait naturellement la direction, et de lui affecter un crédit de 3 000 Livres Sterling. Le 1er octobre 1849 il revoyait les murs de Mossoul. D'octobre 1849 à avril 1851, il rouvrit ses chantiers, tant à Quyundjik qu'à Nimrud. A Nimrud, il reprit le travail avec ardeur et les trouvailles s'accumulèrent à nouveau. Dans le palais d'Assumasirpal II, ce furent plusieurs centaines d'objets de bronze qui revirent la lumière du jour, des vases de toutes tailles et des armes, ainsi que des ivoires. Il creuse des tunnels dans les profondeurs de la ziggurat, située au nord-ouest du site, éventre deux petits temples qui livrent de grandes dalles où étaient inscrites des annales royales, ainsi qu'une statue colossale d'Assumasirpal lui-même. A Quvundjik, il met au jour une série très remarquable de reliefs représentant la prise et le pillage de la ville palestinienne de Lachish par Sennachérib en 701, illustration du passage biblique consacré à l’événement (2R 18,13 à 19,8). Dans soixante et onze pièces, il récupère plus de deux mille reliefs divers et dix taureaux androcéphales. Mais le plus spectaculaire était encore à venir. Dans le palais sud-ouest, il exhume une partie de la bibliothèque d'Assurbanipal II (668-627 av. J.-C.), le petit-fils de Sennacherib, qui avait réuni, dans un but de protection magique, tous les textes possibles qu'on pouvait copier de son temps.
Emporté par la passion, Layard élargit son champ d'action, se rend à Babvlone et explore les sites de l'ancienne Borsippa, de Nippur et de bien d'autres, retourne à Qalaat Shergat...
En avril 1851, il quitte la Mésopotamie et rentre à Londres. Il annonce bientôt qu'il abandonne l'archéologie. Nouvelle étonnante ! Il était alors âgé de trente-quatre ans. Le British Muséum avait décidé de confier la coordination des recherches britanniques en Mésopotamie à Rawlinson, le déchiffreur de Behistoun. Ne supportant pas l'idée de cette tutelle, Layard préféra rompre. C'est alors qu'il entra dans la carrière qui devait le transformer en ambassadeur à Madrid et Constantinople (1877) et en Ministre des Affaires Etrangères de Sa Gracieuse Majesté à deux reprises, avant de se retirer à Venise, sur les bords du Grand Canal. Il laissait cependant sur place Hormuzd Rassam, qui, pendant longtemps et sur ses instructions, allait écumer pour le compte du British Muséum, avec peu de soin, la plupart des sites mésopotamiens et anatoliens. Mais ceci est une autre histoire.
Layard fut un homme étonnant. Le récit de ses voyages dans un Kurdistan alors à peine connu, montre qu'il fut attentif aux habitants qu'il côtoyait et pas seulement un chasseur de trésors. 11 s'intéresse vivement à ces communautés en danger, les rencontre et les décrit avec amitié, même si, probablement, il se présente lui-même sous un jour favorable, en face de populations et de cultures en voie d'effacement. Il fut aussi, et probablement surtout, avec Botta, le fondateur d'une nouvelle discipline. Les archéologues britanniques voient en lui le père de l'archéologie orientale. Le British Muséum lui doit l'essentiel des richesses de l'ancien Orient qu'il conserve concernant la période néo-assyrienne, et qui en font l'un des musées principaux des civilisations de l'ancien Orient. En ces confins de l'empire ottoman, Layard a pressenti la présence cachée de l'Antiquité. La Bible est sa source première et elle évoque les anciens Assyriens. Depuis les premiers voya geurs de la Renaissance et des siècles modernes, les érudits conservaient le souvenir de l'ancienne Mésopotamie. Dès la fin du XVIIIe siècle, inscriptions et objets parvenaient en Occident. Mais il fallut l'intuition géniale de Botta et Layard, pour concevoir qu'en plus de visiter et de rapporter, il fallait aussi exhumer.
Avec les trouvailles de Layard, en plus des reliefs et des sculptures, ce sont les milliers de tablettes cunéiformes de la bibliothèque d'Assurbanipal qui sont mises à la disposition des savants. Cette documentation inattendue stimula le déchiffrement des cunéiformes.
Toute médaille a son revers. Layard est le premier à remarquer que, en l'absence des dalles de pierre que ses ouvriers dégagent, il lui est bien difficile de distinguer les briques crues, séchées au soleil, qui constituent les murs anciens, de la terre qui les recouvre. Certains ne sauront pas encore le faire au début du XXe siècle. Les vestiges architecturaux furent donc proprement anéantis. Il fallut attendre les travaux allemands de Babylone, à l'extrême fin du XIXe siècle, pour qu'une méthode soit entrevue et des relevés convenables établis. Mais Koldewey, le fouilleur de Babylone, était un architecte professionnel, ce que n'étaient ni Botta ni Layard. On a pu qualifier les entreprises de ces derniers - en pensant surtout, d'ailleurs, à celles de Rassam - de pillage organisé. Cependant, à l'époque du « Crétois », le pacha turc de Mossoul, qui se souciait de la valeur scientifique de tout cela ? Les autorités de l'époque, à Constantinople comme à Téhéran, ne souhaitaient conserver que les objets d'orfèvrerie. Le reste importait peu. Layard se gausse de sa réputation - immédiate - de chasseur de trésor. Mais n'étaient-ce point des trésors qu'il récupérait, en pierre ou en argile ? Tout n'est pas blanc ou noir, en ces époques pionnières.
Ninive et ses vestiges est un classique de l'archéologie orientale. Layard est cependant beaucoup moins connu du grand public qu'un H. Schliemann, pourtant son cadet. La publication en français de ce texte passionnant devrait remettre en lumière auprès du public francophone, la grande figure du découvreur de Nimrud. Il restait encore à découvrir les anciens Sumériens. Après l'Assyrie, la Babylonie du sud allait revivre à son tour à partir de 1877, grâce aux efforts du français E. de Sar-zec, à Tello. En trente ans, des pans entiers de l'ancien Orient revivaient. Ce n'était que le début d'une longue résurrection, toujours en cours. Il reste à laisser au lecteur la joie de se laisser guider par Layard au fond de ses tranchées de Nimrud comme sur les pistes montagnardes du Kurdistan. Il ne sera pas déçu.
Jean-Louis Huot*
* Professeur d'archéologie orientale à l'université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé les fouilles françaises en Irak de 1974 à 1990. Il est l'auteur, notamment, de Travaux à Larsa et Tell el-Oueili, six vol., éd. ERC, Paris 1983-89 ; Les Su-mériens, éd. Errance, Paris, 1989 ; Naissance des Cite's (en collaboration avec J.-P. Thalman et D. Valbelle), éd. Nathan, coll. Origines, Paris, 1990 ; Les premiers villageois en Me'sopotamie, éd. Armand Colin, Paris, 1994.
Nimroud et Khorsabad
Voyage à travers l'Asie Mineure et la Syrie.- Ninive et Babylone.- Kalah Sherghat.- Nimrod et Nimroud- Effroi et désolation - La digue du Grand Chasseur.- M. Botta, consul de France.- Le tertre de Kouyunjik.- Les annales d'un peuple inconnu.- Désintéressement de M. Botta.- Khorsabad n'est pas Ninive- Sir StratfordCanninget le British Muséum.
Pendant l'automne 1839 et l'hiver 1840, j'avais parcouru l'Asie Mineure et la Syrie. Au cours de ce périple, il n'est guère de lieu sanctifié par la tradition que je n'aie arpenté, et guère de ruine consacrée par l'histoire que je n'aie visitée. J'avais un compagnon non moins curieux et enthousiaste que moi-même1. Nous étions tout deux également indifférents au confort et insouciants du danger. Nous voyagions à cheval, seuls ; nos armes étaient notre seule protection ; un portemanteau fixé derrière nos selles contenait tous nos effets, et nous pansions nous-mêmes nos chevaux, quand les habitants hospitaliers d'un village turcomant ou d'une tente arabe ne nous épargnaient pas cette peine. Sans être embarrassés de bagages superflus, et sans nous soucier des opinions et des préjugés d'autrui, nous nous mêlions à la population, nous conformant sans effort à ses mœurs, et jouissions sans mélange des émotions que des paysages si singuliers, et des lieux si riches en souvenirs historiques de toutes sortes ne pouvaient manquer de susciter.
Je me souviens avec délice de ces jours heureux où, libres et passant inaperçus, nous quittions au lever du jour l'humble hutte ou la tente accueillante. Voyageant à notre guise, insoucieux de la distance et de l'heure, nous nous retrouvions, au coucher du soleil, à l'abri de quelque vestige séculaire gardé par l'Arabe nomade, ou dans quelque village en ruines portant encore un nom fameux.
En traversant l'Asie Mineure et la Syrie, j'avais visité les plus anciens foyers de la civilisation, et les lieux que la religion avait rendus sacrés. J'avais bientôt éprouvé le désir irrépressible de m'aventurer dans les régions situées au-delà de l'Euphrate, ces contrées que l'histoire et la tradition identifient au berceau de la sagesse de l'Occident. Un mystère épais plane sur l'Assyrie, la Babylonie et la Chal-dée. A ces noms sont liées de grandes nations et de grandes cités dont on ne peut qu'à grand peine retracer l'histoire. Au terme d'un voyage en Syrie, les pensées se tournent naturellement vers l'est ; et si nous n'avions pas foulé les vestiges de Ninive et de Babylone, notre pèlerinage eût, de fait, été incomplet.
Le 18 mars [1848], je quittai Alep avec mon compagnon. Nous voyagions toujours sans guide et sans serviteur. La route qui franchit le désert est impraticable à tout moment de l'année, sauf pour une caravane nombreuse et bien armée, et n'offre pas la moindre curiosité. Nous lui préférâmes celle qui passe par Bir et Orfa2. A partir de cette dernière ville, nous traversâmes les basses terres situées au pied des collines du Kurdistan, une région peu connue et abondant en vestiges intéressants. La frontière égyptienne, à cette époque, passait à l'est d'Orfa, et la guerre entre le Sultan et Mehmet Ali Pacha n'étant pas encore terminée3, les tribus tiraient profit de la confusion générale et pillaient d'un côté comme de l'autre. Avec notre chance habituelle, nous réussîmes à atteindre Nisibint sans encombre. Nous arrivâmes à Mossoul le 10 avril.
Pendant notre bref séjour dans cette ville, nous visitâmes les imposants vestiges qui se dressent sur la rive orientale du fleuve, généralement identifiés aux ruines de Ninive1. Nous parcourûmes également le désert, et explorâmes le tertre de Ka-lah Sherghat4, qui s'élève au bord du Tigre, à environ quatre-vingts kilomètres de son confluent avec le Zab. Au cours de cette excursion, nous passâmes une nuit dans le petit village d'Hammum Ali, aux abords duquel on peut encore voir les ruines d'une ville antique. Depuis le sommet d'une éminence artificielle, nous embrassâmes du regard, au-delà du fleuve, une vaste étendue. Un alignement de …
|