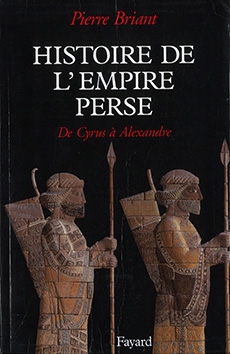| INTRODUCTION
Sur les traces d’un Empire
L’Empire Achéménide a-t-il Existé ?
Créé par les conquêtes de Cyrus (v. 557-530) et de Cambyse (530-522) sur les décombres et le terreau fertile des divers royaumes du Proche-Orient, puis agrandi et plus fermement organisé par Darius Ier (522-486), l’Empire achéménide s’est, pendant plus de deux siècles, étendu de l’Indus à la mer Égée, du Syr-Darya au golfe Persique et à la première cataracte du Nil, jusqu’au moment où Darius III disparaît dans un complot, alors que son adversaire Alexandre faisait déjà figure de vainqueur (330). Le terme « Empire » que nous utilisons couramment n’a, on le sait, aucun correspondant exact dans aucune langue ancienne : les inscriptions des Grands Rois se réfèrent à la fois à la terre (bûmi) et aux peuples (dahyu / daliyàva), et les auteurs grecs parlent des « territoires royaux (khôra basileôs) », de Varkhë [pouvoir] du Grand Roi et de ses satrapes, ou encore des « rois, dynastes, cités et peuples ». Le terme « Empire » implique un pouvoir territorial. Tel est bien le problème de fond que posent la genèse et la constitution de l’Empire achéménide. Marqué par une extraordinaire diversité ethno-culturelle et par une exceptionnelle vitalité des formes d'organisation locale, il donne lieu à deux lectures : l’une, qui en fait une sorte de fédération lâche de pays autonomes, sous l’égide lointaine d’un Grand Roi qui se manifesterait uniquement par le biais des prélèvements tributaires et des levées militaires ; l’autre qui, sans nier l'évidence de la diversité, entend souligner la dynamique organisationnelle des interventions multiformes du centre, et les intenses processus d’acculturation : la formulation laisse deviner dans quelle direction se développent mes préférences -je m’en expliquerai chemin faisant. Tel est, résumé en quelques mots, l’objet du livre que je soumets aujourd’hui à la sagacité des lecteurs.
D’Alexandre à Cyrus et retour : fragments d’ego-histoire
Imprudemment annoncé dans une étude parue en 1979, ce livre a été rédigé entre le printemps 1990 et le printemps 1993. J’ai apporté des retouches limitées au texte, et surtout révisé d’une manière sensible les notes documentaires, au cours des années 1994 et 1995. Mais la conception et la réalisation du livre, même sous forme préliminaire et préparatoire, remontent à près d’une quinzaine d'années, puisque c’est vers 1982-1983 que j’ai commencé à produire pour moi-même les premiers brouillons, esquisses et plans, eux-mêmes réduits maintenant à l’état d’archives résiduelles. En guise de contribution à une formule en vogue (du moins en France), l’ego-histoire, et dans le droit fil de l’introduction quej’ai écrite en 1982 pour mon recueil d’articles (RTP), j’aimerais en expliquer la genèse, de manière très personnelle.
Rien ne me prédisposait à consacrer le plus long de ma vie de chercheur et d’enseignant à l’histoire achéménide. Historien de formation, passionné par l’histoire de l’Antiquité au cours de mes études à Poitiers, j’ai, un peu par hasard (ou plus exactement à la suite d’une réflexion d’H. Bengtson), commencé à m’intéresser à un successeur d’Alexandre, l'ancien satrape de Grande-Phrygie, Antigone le Borgne, sous forme d’une thèse préparée sous la direction de Pierre Lévêque. Un passage bien connu de la lie d'Eumène (5.9-10), relatif aux agissements de l’adversaire d’Antigone dans les environs de Kelainai (capitale de la Grande-Phrygie). m’a amené à me poser des questions sur le statut de la terre et des paysans au tout début de la période hellénistique - recherches quej’ai développées dans un article consacré à ces mêmes paysans (laoi) d'Asie Mineure (1972). Le premier pas était franchi : j’avais établi ma résidence au Proche-Orient (l’Asie, comme je disais alors, à la suite des auteurs grecs), mais dans un Proche-Orient revisité par les années gréco-macédoniennes et par l’historiographie coloniale antique et contemporaine.
La préparation d’une longue étude sur Eumène de Kardia (1972-1973) puis d’un petit livre sur Alexandre (première éd. 1974) m’a très vite convaincu de la nécessité de remonter plus haut dans le temps. Qu’était-ce donc que cet Empire achéménide, dont on invoquait systématiquement la décadence sans le resituer dans son cadre historique ? J'avais toujours été frappé en effet du fait qu’à la suite de Droysen (qui aurait mérité des héritiers moins dogmatiques), certains épigones zélés affirmaient sans ambages que la conquête macédonienne avait modifié de fond en comble les structures politiques, économiques et culturelles de « l’Asie » ; mais, dans le même temps, l’avant-Alexandre n’était jamais autrement défini que comme un antonyme-repoussoir de l’après. Ces interrogations m’ont amené à prendre comme premier objet d’études des populations du Zagros, que les auteurs anciens présentaient comme des brigands qui ne se vouaient aucunement à l’agriculture et qui, comme tels, étaient « naturellement » agressifs (1976). J’en tirai la conviction, de plus en plus pressante, que toute notre vision de 1 'Empire achéménide et de ses populations était viciée du fait de déformations apportées par les historiens anciens d’Alexandre, dans le même temps qu’il m’apparaissait, avec une égale évidence, que l’historien ne pouvait éviter de recourir à ces mêmes sources. J’ai continué pendant des années à creuser ce sillon, et, dans une certaine mesure, ce livre voudrait contribuer à apporter des éléments de réponse à une interrogation ancienne : pourquoi la chute de l’Empire achéménide sous le coup de l’agression macédonienne ?
Mais le sous-titre choisi n’est pas simplement le reflet de cette véritable obsession, ou, si l’on me permet l’expression, de cette longue « quête du Graal ». Il veut exprimer également une conviction longtemps entretenue et nourrie : Alexandre et ses successeurs ont beaucoup repris à l’organisation achéménide, ce quej’ai souvent exprimé sous la formule « Alexandre, le dernier des Achéménides ». Comme toute formule, celle-ci a ses limites et elle génère ses propres contradictions. Mais, au fond des choses, elle me semble toujours à même de rendre compte des extraordinaires continuités qui caractérisent l’histoire du Proche-Orient entre les conquêtes de Cyrus et la mort d’Alexandre. De son côté, Heinz Kreissig, dont j’ai beaucoup appris, avait lui aussi fréquemment mis en valeur ces continuités dans le cadre des « orientalischer hellenistischer Staaten », dont le royaume séleu-cide était, à ses yeux, une évidente manifestation. Le terme continuité ne doit pas induire en erreur : il ne s’agit pas de nier les aménagements et bricolages apportés par la conquête macédonienne. Mais, dans le même temps, les recherches récentes rendent de plus en plus clair que, par exemple, l’Empire séleucide, dans sa genèse et ses éléments constitutifs, est une formation étatique directement greffée sur l’arbre achéménide.
Dans le courant des années 1970, et plus encore à partir du début des années 1980, la conscience s’est imposée à moi, de plus en plus clairement, qu’aussi indispensables soient-elles, les sources classiques ne pouvaient, à elles seules, répondre aux questions que je me posais. 11 me fallait pénétrer plus intimement dans la substance achéménide, tâche à laquelle je n'étais nullement préparé. J’ai heureusement fait alors des rencontres décisives. Tout d’abord Roman Ghirshman qui, vers 1972, m’a très vivement encouragé à tracer mon sillon achéménide : je ne saurais oublier la bienveillante sollicitude qu’il n’a cessé de me manifester jusqu’à sa disparition en 1979. Vers 1977 (si ma mémoire est bonne), je suis entré en contact avec Clarisse Herrenschmidt qui, si je puis dire, m’a « initié » aux inscriptions royales achéménides. Au cours des années 1970, j’ai également noué des contacts, qui ne se sont jamais interrompus depuis lors, avec l'équipe italienne, menée par Mario Liverani et nourrie par ses travaux et ceux de ses élèves : Mario Fales, Lucio Milano et Carlo Zaccagnini, avec lesquels je partageais et je partage nombre d'intérêts thématiques et d’approches conceptuelles. Les conversations, aussi fréquentes que vives, que j’ai continué d’avoir avec eux m’ont aidé à replacer le cas achéménide dans le cadre plus large de l’histoire du Proche-Orient du premier millénaire, et ainsi à prendre mieux en compte les héritages assyro-babyloniens dans les structures de l’Empire achéménide.
C'est vers 1977-1978 que Jean-Claude Gardin, qui menait alors des prospections autour de la ville hellénistique d'Aï-Khanûm en Afghanistan, m’a invité à me joindre à son équipe. Il m’avait convié à participer à leurs réflexions en tant qu’historien, et à confronter les documents textuels et les documents archéologiques. Sans pouvoir prendre part aux travaux sur le terrain (bientôt interrompus pour les raisons que chacun connaît), j'v ai appris alors l'apport formidable que représentait l’archéologie, en même temps que tous les défis interprétatifs qu'elle lance à l'historien, plus familier avec un texte d’Arrien qu'avec les « poubelles » de tessons. Cette collaboration m'a conduit, en 1984, à publier un livre sur les rapports entre l'Asie centrale et les royaumes du Proche-Orient, situé d’abord et avant tout dans le cadre de l’histoire achéménide. À lui seul, le débat, que j’ai pu alors mener, a été extrêmement riche de développements futurs. Le lecteur remarquera, le moment venu, que des désaccords subsistent entre nous. Le problème méthodologique reste posé : comment concilier l’image archéologique et l’image textuelle, qui semblent donner naissance à deux conceptions de l’Empire achéménide ? L’on verra également que le débat n’est pas réduit au cadre régional de la Bactriane.
Dans la seconde partie des années 1970, alors que je terminais mon étude sur les « brigands » du Zagros antique, j’ai également eu de fréquents échanges avec des anthropologues spécialistes des sociétés de pasteurs nomades, en particulier avec Jean-Pierre Digard dont les Bakhtyâris jouxtaient « mes » Ouxiens : cette collaboration suivie sur plusieurs années a débouché sur la rédaction d’un livre d’anthropologie et d’histoire consacré aux peuples pasteurs du Proche-Orient (1982b) et marqué lui aussi d’abord par la problématique des rapports centre/périphérie dans l’Empire achéménide, mais aussi chez ses prédécesseurs assyro-babyloniens et ses successeurs hellénistiques.
Dans mon histoire intellectuelle, l’année 1983 est marquée d’une pierre blanche. C’est à cette date en effet que, pour la première fois, j’ai participé à un Achaemenid Workshop à Groningen, à l’invitation d’Heleen Sancisi-Weerdenburg qui, bientôt rejointe par Amélie Kuhrt, avait lancé une série qui devait s’interrompre en 1990 à Ann Arbor (ici, en col-loboration avec Margaret Root). Pour la première fois, j’ai eu conscience de ne plus travailler isolément et en autodidacte sur ce qui restait mon objectif essentiel. J'ai pu côtoyer alors la « communauté achéménédisante » qui, réduite en nombre, présente l’inestimable avantage d’être internationale et d’être liée par des rapports d’amitié. J’ai pu alors, d’une manière plus systématique, mener des discussions à partir d’une problématique historique clairement posée par les organisatrices, et à partir de corpus documentaires aussi variés que l’étaient les pays de l’Empire. Les nombreuses relations, que j'ai pu nouer alors au cours et en dehors de ces rencontres, ont été pour moi déterminantes. L'initiative d’Heleen Sancisi-Weerdenburg et d’Amélie Kuhrt a donné une impulsion radicalement nouvelle aux recherches achéménides. A l’image des Achaemenid ll'orkshops. Clarisse Herrenschmidt et moi-même avons organisé une table ronde sur le tribut dans l’Empire perse ; Pierre Debord, Raymond Descat et l’équipe du Centre Georges-Radet de Bordeaux ont mis sur pied deux rencontres, l’une sur l’Asie Mineure, l’autre sur les problèmes monétaires ; Jean Kellens a organisé à Liège un colloque consacré à la religion perse ; de leur côté, Josette Elayi et Jean Sapin ont organisé trois rencontres sur la Syrie-Palestine sous la domination des Grands Rois ; et ces pages seront chez l’éditeur, quand paraîtront les Actes d’une table ronde que j’ai organisée à Toulouse autour de VAnabase de Xéno-phon. Bref, l’initiative de Groningen a donné le branle à une activité scientifique intense et à une production considérable d’études de premier plan, dont la publication régulière, dans la série Achaemenid History, mais aussi dans de nombreuses revues, nourrit et relance périodiquement les discussions et les débats - à tel point que la croissance exponentielle de la bibliographie a parfois fait naître chez moi un sentiment d’impuissance et de découragement. Autant dire qu’œuvre très personnelle, ce livre reflète également (ou voudrait refléter) la richesse et la productivité d’un champ de recherches qui, pendant longtemps, était resté en friche partielle. En employant cette expression, je n’entends pas minimiser l’importance ni la portée des travaux que l’histoire de l’Iran ancien avait suscités de longue date et dont j’ai tenu le plus grand compte. Ce que je veux simplement dire, c’est que, prise dans sa globalité et non pas réduite à l’étude de quelques sites prestigieux (Suse, Persépolis, Pasargades), et malgré la tentative synthétique d’Olmsteadt en 1948 qui mérite toujours d’être saluée avec respect, l’histoire de l’Empire achéménide était largement restée une terra incognito, désertée aussi bien par les assyriologues (pour lesquels la chute de Babylone devant Cyrus en 539 a longtemps marqué la fin de l’histoire) que par les classicistes (qui ont «kidnappé» l’histoire du Proche-Orient au moment du débarquement d’Alexandre en 334). En quelque sorte, écrasée entre « la Grèce éternelle » et « l’Orient millénaire », ballottée entre l’hellénocentrisme (d’Eschyle à Alexandre) et le judéocentrisme (Cyrus vu à travers le prisme du retour d’exil), l’histoire achéménide n’existait pas en tant que champ de recherches autonome. L’initiative d’Heleen Sancisi-Weerdenburg et d’Amélie Kuhrt a donc réintroduit plus fermement les études achéménides à l’intérieur du champ historique, balisé par une problématique dans laquelle je me suis reconnu d’autant plus aisément que j’avais commencé moi-même de consacrer des efforts isolés à en définir les termes et les enjeux.
Reste un aspect de mon « ego-histoire » que je voudrais aborder très franchement, comme je l’ai fait à plusieurs reprises ici et là dans les années antérieures, dans des publications ou dans des conversations privées, avec des collègues et avec des étudiants. Les sources écrites de l’histoire achéménide sont d’une extraordinaire variété linguistique : vieux-perse, élamite, babylonien, égyptien, araméen, hébreux, phénicien, grec, latin, pour ne pas parler du lydien, du lycien, du phrygien, du carien ou de quelque autre langue encore mal déchiffrée. Or, je dois préciser d’entrée que je ne suis aucunement spécialiste de chacune de ces langues. Je ne peux guère arguer que de ma connaissance du grec et du latin. On peut estimer que c’est là un handicap insurmontable. Mais, si le terme « handicap » rend compte d'une indiscutable réalité, je ne pense pas que l’adjectif, dont je viens de l’affubler, puisse être pris littéralement. Pour justifier cette position, je voudrais expliquer ma méthode de travail. Il existe d’abord des traductions accessibles de textes fondamentaux, qu'il s’agisse des inscriptions royales, des tablettes élamites (en sélection), des textes araméens d’Égypte ou d'ailleurs, d’un certain nombre de tablettes babyloniennes, ou encore des inscriptions hiéroglyphiques - pour ne donner qu’un échantillon des ressources disponibles. Mais utiliser les textes en traduction ne suffit pas. Il convient de se reporter aux textes originaux, du moins pour les plus importants d’entre eux. A cette fin, il existe de nombreux documents publiés en translitération. Dès lors, même un historien autodidacte est à même d'y rechercher ce que j'appellerais les mots-repères ou les mots clefs, qui donnent sens au texte. À ce moment il faut se reporter, sans exclusive, aux études philologiques, aussi ardues soient-elles. C'est ce quej’ai tenté de faire, de la manière la plus systématique possible. Ce pourquoi, ici et là, je me suis permis d’entrer dans des discussions et des débats qu'en principe mon incompétence linguistique et philologique m’interdit d'aborder : de temps à autre, je me suis rendu compte que les suggestions de l'historien pouvaient, indépendamment, rejoindre l’interprétation du philologue. Et puis, lorsqu'un problème se posait, pour moi insoluble, j’ai eu souvent recours aux conseils et avis d'amis et de collègues, qui n’ont pas été avares de leur science : combien de messages électroniques n'ai-je pas. par exemple, échangé avec Matt Stolper à propos des tablettes babyloniennes d'époque achéménide? Que l’on m’entende bien : je ne veux évidemment pas ce faisant, faire l’éloge de l'ignorance. Je ne méconnais pas les limites de l’autodidacte : il serait merveilleux d’avoir à la fois une formation d’historien et un accès immédiat à toutes les langues de l’Empire. Malheureusement, autant que je sache, l’oiseau rare n’existe pas : en tout cas ni mon ramage ni mon plumage ne m'autorisent à postuler cette distinction !
En dépit de toutes les précautions dont je me suis entouré, je ne méconnais pas les risques que j’ai pris en présentant un livre qui - raisonnablement ou non - a vocation à l’exhaustivité. En raison de mes propres lacunes, de l’inégale accessibilité des corpus documentaires, de l’ampleur persistante (voire croissante) des débats, ou encore de l’inégal progrès des recherches dans l’ordre thématique ou régional, le terme « exhaustivité » peut entretenir la confusion et/ ou prêter à sourire. Le problème, c’est qu’à partir du moment où je me suis lancé dans cette entreprise, j’ai été contraint de me mesurer à une sorte d’encyclopédisme, avec tous les risques et les illusions qu’induit une telle démarche. Je n’avais plus le droit d’éviter telle ou telle discussion, au motif de mon intérêt prioritaire pour telle ou telle problématique, ou de ma compétence limitée dans tel ou tel corpus. Unouvrage de synthèse de ce type implique nécessairement que l’auteur aborde tous les aspects et composantes, dans l’ordre politique, idéologique, socio-économique, religieux, culturel, etc., et tente de les intégrer, autant que faire se peut, dans une interprétation globale. Je me suis donc efforcé d’ouvrir tous les dossiers, mais j’ai tenu également à les laisser entrouverts. Dans certains cas, l’ampleur et la complexité (voire les contradictions) des discussions menées entre spécialistes de tel ou tel corpus ne donneront pas lieu à une prise de position tranchée de ma part (je pense, inter alia, aux débats exégétiques et historiques sur Ezra et Néhémie). En revanche, le lecteur trouvera, au moins dans les notes documentaires, un état de la question - c’est-à-dire non seulement une bibliographie¹, mais aussi et surtout les raisons qui fondent les divergences interprétatives. Dans d’autres cas, j’ai pris plus fermement position, et proposé des interprétations personnelles. J’espère qu’ainsi ce livre pourra susciter de nouvelles études spécifiques qui, sans nul doute, remettront en cause bien des interprétations qu’au demeurant j’ai fréquemment présenté sous la forme ouverte de suggestions alternatives.
L’historien et ses documents
L’une des spécificités les plus remarquables de l’histoire achéménide, c’est qu’à la différence de la plupart des peuples conquérants, les Perses n’ont pas laissé de témoignages écrits de leur propre histoire, au sens narratif du terme. Il est tout à fait notable qu’à la différence, par exemple, des rois assyriens, les Grands Rois n’ont pas fait rédiger d’Annales, où aurait été consigné le souvenir héroïsé de leurs hauts faits, sur le champ de bataille ou à la chasse. Nous ne disposons d’aucune chronique, qu’aurait rédigée un lettré de la cour, à l’instigation des Grands Rois. Certes, selon Diodore (II, 32.4), Ctésias -médecin grec de la cour d’Artaxerxès II, auteur de Persika - se flattait d’avoir eu accès aux « parchemins royaux (basilikai diphtherai), dans lesquels, selon certaine coutume (nomos), les Perses consignaient les faits du passé ». Mais, de telles archives historiques perses, nous n’avons nul autre témoignage - mis à part une tradition tardive et suspecte, qui attribuait leur destruction à Alexandre. Les archives - auxquelles se réfère par exemple le rédacteur d’Esdras (Ezra, 6,1 -2) - étaient plutôt de type administratif : dans ces archives satrapiques et/ou royales (basilikaigraphai ; karammaru sa sarri). on conservait la trace écrite des décisions les plus importantes (mouvement et dons de terre par exemple, ou encore documents fiscaux) : c’est peut-être à de telles archives (attestées dans plusieurs capitales satrapiques et/ ou impériales) qu’Hérodote a eu accès pour composer son fameux développement tributaire, mais il n’est pas exclu que l’historien d’Halicarnasse lui-même a collecté ses informations de type administratif par l’intermédiaire de témoignages oraux, selon une méthode attestée à de multiples occasions dans son œuvre. Il est donc infiniment plus probable qu’au moins dans les Persika, Ctésias s’est lui aussi d’abord fondé sur des témoignages oraux, comme l’explique d’ailleurs son abréviateur Photius (Persika, § 1). C’est à coup sûr de cette manière également qu’Hérodote, Ctésias et quelques autres auteurs grecs ont entendu conter et qu’ils ont retransmis les diverses versions de la légende du fondateur, Cyrus. C’est par le biais des « gens instruits » (cf. Diodore. II, 4.2) que se diffusaient dans tout l’Empire les témoignages édifiants des vertus royales : d’où l’intérêt que revêtent, par exemple, les historiettes achéménides rapportées par un auteur tardif, Elien, qui manifestement tient ses informations d’Hérodote lui-même ou de gens de cour, tel Ctésias. De ce point de vue. l’exemple le plus saisissant est un passage où Polybe (X, 28) transmet, par écrit, une information administrative achéménide du plus grand intérêt, que les paysans hyrcaniens a\ aient conservée dans leur mémoire collective pendant des générations ; par une série de hasards assez extraordinaire, un archiviste-mémorialiste royal était sur place quand, sur la demande d’Antiochos III, les chefs des communautés hyrcaniennes lui ont rappelé les privilèges dont ils jouissaient depuis le temps « où les Perses étaient les maîtres de l’Asie ». Encore faut-il préciser que l’information serait tombée définitivement dans l’oubli, si la mesure qu’elle rapporte n’avait eu une incidence ponctuelle sur le cours de l'expédition militaire menée par le roi séleucide en Asie centrale. C’est dans un ouvrage maintenant perdu que Polybe en a retrouvé la trace.
On ne saurait donc sous-évaluer l'importance de la tradition orale dans les pays du Moyen-Orient. C'est par voie orale, sous forme de chants et de déclamations, par l’intermédiaire des « maîtres de vérité » qu'étaient les mages, que les Perses eux-mêmes se transmettaient, de génération en génération, le geste de leurs rois et le souvenir des héros mythiques, dont les jeunes gens devenaient les dépositaires. Dans l'imaginaire collectif du peuple perse, l’histoire se confondait avec son expression mythique et, dans les déclarations royales, avec la généalogie de la dynastie. A l'exception (partielle) de l’inscription monumentale trilingue qu’a fait graver Darius sur le rocher de Behistoun, les inscriptions royales ne sont pas des documents narratifs : on n'y trouvera aucune allusion directe aux conquêtes et expéditions militaires. Elles célèbrent plutôt la toute-puissance du grand dieu Ahura-Mazda la permanence transhistorique du principe dynastique et l’éclat incomparable des vertus royales. Le Livre des Bienfaiteurs, auquel font allusion Hérodote (III, 140 ; VIII, 85-86) et le rédacteur du Livre d'Esther (6.1), ne fait pas exception : y était dressée et mise à jour la liste des personnages qui ax aient rendu un signalé service au Grand Roi et qui, comme tels, pouvaient espérer un don royal ; il participe donc lui aussi de l’exaltation de la puissance souveraine. L'art aulique achéménide lui-même n’a pas vocation narrative : c'est le Pouvoir et le Roi qui sont représentés dans des attitudes atemporelles, non un roi particulier en situation historicisée ; il en est de même des images royales portées sur la pierre, sur les monnaies et sur les sceaux. Inscrite dans le temps immobile et infini du Roi, l'histoire des Perses n'a jamais été située par eux dans le temps de l'Histoire.
Les Grands Rois et les Perses ont ainsi laissé à d'autres le contrôle de leur mémoire historique. D'où une situation proprement inouïe : c'est par les écrits de leurs sujets et de leurs ennemis que l’on peut reconstituer la trame narrative de l'histoire achéménide. D’où le pouvoir et l’autorité qui ont été longtemps l’apanage des auteurs grecs. 11 est assez compréhensible que la plupart d’entre eux aient écrit des livres consacrés à la mémoire des Grecs, qui elle-même, pour une large part, dans l’Athènes des cinquième et quatrième siècle, s’est constituée sur le socle des souvenirs, soigneusement bricolés, des affrontements avec les Perses et des victoires remportées sur les « barbares d’Asie ». Parmi ces auteurs, l’un tient une place particulière et éminente : Hérodote. Par opposition à bien de ses contemporains, il est peu suspect d’hostilité systématique contre les Perses - d’où l’accusation dirigée contre lui par Plutarque d’être un « ami des barbares » (philo-barbaros). L’objectif de ses Histoires, c’est de comprendre et d’expliquer les origines, même lointaines, des Guerres Médiques. Ce qui nous vaut de longs développements, sous forme de flash-back, sur l’histoire et les institutions de nombre de peuples et de royaumes du Proche-Orient (l’Égypte en particulier). Ce qui nous vaut également des chapitres intéressants sur des moments de l’histoire perse : les conquêtes de Cyrus, la mainmise sur l’Égypte par Cambyse, l’avènement de Darius, les réformes qu’il introduisit dans l’organisation tributaire, ou encore un développement sur l’organisation interne du peuple perse et ses principales coutumes sociales, et, bien entendu, de très longs comptes rendus de la révolte de l’Ionie (v. 500-493) et des Guerres Médiques (490-479). En dépit de ses lacunes et de ses insuffisances, la fin brutale des Histoires (en 479) laisse en quelque sorte orphelin l’historien de l’Empire achéménide. Parmi ses successeurs, Thucydide ne s’intéresse que très périphériquement à l’Empire achéménide ; quant à Xénophon et à Diodore de Sicile, leur utilisation unilatérale tend à donner un poids disproportionné au front méditerranéen. Si l’on met à part VAnabase de Xénophon, il faut attendre l’expédition d’Alexandre pour que les historiens anciens pénètrent, dans les pas du conquérant, dans la profondeur des territoires impériaux.
Enfin, de nombreux auteurs anciens avaient écrit des ouvrages consacrés spécifiquement à la Perse, ce qu’on appelle les Persika. Mais la plupart sont perdus et connus uniquement par des fragments (citations par des auteurs postérieurs). Le plus long fragment conservé est le résumé que le patriarche Photius avait rédigé sur les Persika de Ctésias. L’on est vite déçu par la lecture. L’auteur, qui a vécu pendant une quinzaine d’années à la cour d’Artaxerxès II, n’en a transmis qu’une vision biaisée, dominée par les tortueuses machinations des princesses perverses et les troubles complots des eunuques fourbes. Il est à coup sûr l’un des responsables majeurs du succès d’une approche très partiale et très idéologisée du monde achéménide. Ses Persika ne sont pas sans annoncer l’« orientalisme » de l’époque moderne qui analyse les cours du Proche-Orient à travers une grille de lecture très contestable, qui laisse surtout passer les notations relatives aux bruissements des harems et à la décadence des sultans. Xénophon, quant à lui, a écrit un long roman historique, la Cyropédie, consacré, comme le titre l’indique, à l’éducation du jeune Cyrus. Le « Cyrus » qu’il met en scène n’est certainement pas le Cyrus historique ; c’est une sorte de représentant paradigmatique des vertus royales. Il convient donc, à chaque pas, d’y distinguer, ce qui n’est pas toujours aisé, le noyau infonnatif achéménide et l’interprétation grecque. D’une manière générale, les auteurs grecs - qui peut s’en étonner ? - ont transmis une vision très hellénocentrique de l’histoire et des mœurs perses, tout comme d’ailleurs certains livres bibliques, Néhémie, Ezra, Esther ou Judith en donnent une approche résolument judéocentrique. Mais l’historien n’a pas le choix de ses documents : dans la situation documentaire qui prévaut, force nous est de recourir massivement à l’historiographie grecque pour reconstruire une trame narrative. L’on a beau se plaindre (voire s’exaspérer) de la nature de leurs œuvres, la situation devient encore plus délicate lorsque l’on n’en dispose plus ! Au surplus, il convient de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : certains auteurs tardifs (Athénée, Élien) ont transmis de nombreux renseignements sur la personne du Grand Roi et sur la vie de cour qui, une fois dûment décryptés, permettent à l’historien de déchiffrer ce qui fut, aussi, un Empire des signes (cf. chapitres v-vn). Du point de vue de la méthode, le livre et ses interprétations sont ainsi largement le résultat d’un travail de déconstruction des textes classiques, à partir duquel j’ai tenté de montrer qu’aussi partial et idéologisé soit-il un texte grec, replacé dans les réseaux associatifs de son contexte, peut donner lieu à une stimulante lecture achéménide. Au reste, le statut historique et historiographique des déclarations et représentations royales impose une démarche identique.
Fort heureusement, l’on dispose également de documents du centre : les inscriptions royales sont de véritables miroirs de la vision que les Grands Rois se faisaient de leur pouvoir, de leurs vertus et de l’espace impérial ; elles fournissent également des renseignements de première importance sur leurs activités de constructeurs. Mais la découverte majeure fut, à coup sûr, celle d’importants lots d’archives sur argile, ce que l’on appelle les tablettes de Persépolis, inscrites en écriture cunéiforme et rédigées dans un élamite truffé de mots perses. Elles donnent de l’administration impériale une image bureaucratique et « paperassière » que ne laissaient guère deviner les sources grecques, mais qui ne saurait réellement surprendre chez les héritiers des traditions assyro-babyloniennes. C’est la même image que transmettent les nombreux documents araméens trouvés en Egypte. Certaines décisions royales et satrapiques sont également connues par des transcriptions/ traductions dans différentes langues de l’Empire: qu’il s’agisse, entre autres exemples, d’une lettre, copiée en grec, de Darius à l’un de ses administrateurs en Asie Mineure (Gadatas), ou de la correspondance échangée entre Pherendatès, satrape d’Egypte, et les administrateurs du sanctuaire du dieu Khnûm à Eléphantine. L’ensemble de cette documentation rend compte à la fois de l’intervention multiforme du pouvoir central et du plurilinguisme durable de l’Empire, tempéré par la diffusion de l’araméen. À ces documents écrits, il convient d’ajouter les multiples témoignages archéologiques, iconographiques et numismatiques que l’on a découverts et mis au jour de l’Égée à l’Indus.
L’historien a donc accès à une documentation à la fois imposante et variée, puisqu’aux sources écrites (inscriptions royales, tablettes élamites et babyloniennes, inscriptions phéniciennes, araméennes ou égyptiennes, lydiennes et lyciennes, inscriptions multilingues, papyri araméens, auteurs classiques, etc.), s’ajoutent les documents iconographiques, sous forme monumentale ou sur petits objets, dans les résidences royales et dans les provinces. Mais, même réunis, ces différents corpus souffrent d’un double handicap : ils sont très inégalement répartis dans l’espace et dans le temps. Certains pays de l’Empire sont pratiquement vierges de toute documentation écrite : c’est le cas particulièrement des satrapies du Plateau iranien, de l'Asie centrale et de la vallée de l’Indus. Il faut attendre la conquête d’Alexandre pour disposer de quelques (maigres) informations littéraires : d'où le poids hégémonique des témoignages archéologiques qui posent ainsi nombre de problèmes interprétatifs. D’autres régions sont au contraire extraordinairement bien documentées : outre la Perse elle-même (grâce aux tablettes élamites), l’on citera particulièrement la Susiane (documents textuels et archéologiques des constructions royales), l’Égypte (documents araméens d’Éléphantine et de Saqqâra, papyri démotiques, inscriptions hiéroglyphiques), la Babylonie (grâce à des milliers de tablettes) et, évidemment, l’Asie Mineure (grâce non seulement aux historiens grecs, mais également aux témoignages tardifs - grecs et araméens, ou gréco-araméens - de la diaspora impériale perse en Anatolie). En outre, certains sites provinciaux revêtent une valeur informative exceptionnelle : c’est le cas de Xanthos de Lycie, où les dynastes n’ont cessé d’élever des monuments de différente nature, sur lesquels étaient régulièrement portées des inscriptions, en lycien et en grec, et des scènes de cour, dont le répertoire iconographique porte témoignage de l’influence achéménide. C’est là également qu’en 1973 a été découvert un témoignage écrit de la plus haute importance : la désormais fameuse stèle trilingue (ara-méen, lycien, grec), datée maintenant avec certitude de la première année d’un Grand Roi, Artaxerxès IV (338-336), qui, jusqu’alors, n’était guère connu que par le nom (Arsès) que lui donnent régulièrement les sources classiques (Arsu en babylonien). Pour toutes ces raisons, je ferai fréquemment halte à Xanthos, qui s’impose à l’historien comme une sorte de révélateur miniature du pouvoir perse dans un petit sous-ensemble régional de l’Empire, tout au long de la période qui va de Cyrus à Alexandre. Dans le même temps, l’exemple témoigne des difficultés interprétatives qui naissent de l’hégémonie des sources archéologiques et iconographiques.
Distribuée inégalement dans l’espace, la documentation l’est aussi dans le temps : la majeure partie des documents du centre est concentrée, dans des proportions impressionnantes, à l’intérieur de la période qui va de la conquête de Babylone par Cyrus jusque vers le milieu du ve siècle (date des derniers documents de Persépolis) : ce n’est guère que dans le cours de cette période que l’on peut prétendre faire une histoire totale. Les règnes d’Artaxerxès Ier (465-425/424) et de Darius II (425/424-405/404) restent assez bien documentés, en raison des plus tardifs documents persépolitains, des archives des MuraJü en Babylonie et des documents araméens en Egypte. En revanche, à partir d’Artaxerxès II (405/404-359/358), l’historien en est réduit, pour l’essentiel du moins, à utiliser les témoignages des auteurs grecs : mais, on l’a dit, ceux-ci focalisent alors l’attention sur les rives de l’Égée, sur les affaires diplomatico-militaires et sur les complots de cour. Il faut attendre le règne de Darius III (335-330) pour disposer d’une documentation plus abondante, à savoir les historiens d’Alexandre qui, une fois décryptés, constituent, comme je le montrerai (chapitres xvi-xviii), une source « achéménide » d’un intérêt exceptionnel.
L’espace et le temps
Ces simples observations font saisir immédiatement la difficulté majeure que doit affronter quiconque entend écrire un livre d’analyses et de synthèse sur l’Empire achéménide. Il doit, en effet, et dans le même moment, rendre compte d’une approche diachronique, d’une vision synchronique et des différenciations régionales. Un, l’Empire est en effet multiple, de par sa propre durée, et de par l’infinie variété des pays et des cultures qui le composent. Et là revient la dictature du document. Comment mener une histoire globale sur la longue durée, alors que la documentation la plus signifiante est répartie sur quelques décennies et/ou dans quelques régions ? Pour les mêmes raisons, où, comment et pourquoi établir des coupures chronologiques qui soient réellement l’expression d’une évolution endogène, constatée et démontrable ? Il n’y a pas de raison d’ignorer les ruptures marquées par la mort d’un roi et l’avènement de son successeur, mais on ne peut pas non plus leur attribuer une valeur explicative déterminante car, quelle que soit la place centrale reconnue du Grand Roi, le rythme et la respiration de l’histoire de l’Empire, sur la longue durée, ne sont pas réductibles aux accidents de l’histoire dynastique : d’où la nécessité d’intercaler des chapitres thématiques dans la trame chronologique.
Malgré la désastreuse répartition de la documentation, j’ai tenté le pari d’une histoire totale, dans toutes les phases quej’ai isolées. Pari est un mot flatteur puisque j’ai, pour une large part, défini les différentes parties du livre en fonction même de la distribution chronologique et spatiale des documents de toute sorte. Ce que je veux dire, c’est quej’ai essayé de redonner toute son importance au IVe siècle, dont le développement est trop souvent méconnu et traité superficiellement au risque d’abandonner le pouvoir de la mémoire aux polémistes grecs et ainsi de rendre inintelligible la fin de l’histoire. Je ne cache pas que, dans ces chapitres (en particulier le chapitre xv), l’histoire ainsi reconstituée est surtout de nature politique, militaire et diplomatique. On en jugera peut-être la lecture ardue, voire rebutante. Mais, d'une part, pour reprendre une formule que je répéterai mainte fois, l’historien n’a pas le choix de ses documents. D’autre part, avec d’autres, j’estime qu’il n'y a pas de genre historique mineur : dans un Etat construit et détruit par la conquête, il serait même déraisonnable de ne pas accorder une attention soutenue aux armées et aux expéditions militaires. Enfin, l’étude de la guerre ne se réduit pas à la caricature que l’on en donne parfois sous la terminologie péjorative d’histoire-bataille : elle est un exceptionnel révélateur du fonctionnement d’un Etat, ne serait-ce, par exemple, que par l'ampleur de la mobilisation des forces productives humaines, matérielles et techniques qu’elle suppose et qu'elle impose.
De manière à marquer plus clairement encore la diachronie, j’ai brossé périodiquement des tableaux de l’Empire, pris dans ses composantes régionales, voire micro-régionales (chapitres xm, 6-7 ; xiv, 8 ; xv. 7). J’ai également dressé des bilans plus globaux, à trois moments clefs. Tout d’abord à la mort de Cambyse (522), de manière à mieux distinguer ce qui revient aux deux premiers rois, et ce qui doit être attribué à Darius (chapitre il). J’ai également établi un bilan, qui se veut exhaustif, à l’issue du règne de Darius. Ces longs chapitres (vi-xii) susciteront peut-être quelques critiques, en raison de l’utilisation, au début du vc siècle, de sources plus tardives : j'essaie d’expliquer à plusieurs reprises les raisons de mon choix. Le troisième bilan général est fixé vers le début du règne de Darius III, et il prend en compte la durée du ivc siècle dans son entier : il a pour fonction de faire un état des lieux avant le débarquement d’Alexandre, et de mieux mesurer ce qu’on a pris la désastreuse habitude d'appeler la « décadence [déclin] achéménide ». On y trouvera un relevé général des peuples et pays de l’Empire qui, sans prétendre à l’exhaustivité documentaire, est aussi complet que possible : cet inventaire n’est pas réduit à l'analyse de l’organisation administrative ; les plus longs développements sont consacrés à l’analyse des rapports interculturels (chapitre xvi) ; le bilan est complété par une analyse dynamique des appareils d'État centraux (chapitre xvn). Pour des raisons que j'expose en leur temps (introduction de la quatrième partie), un tel bilan permet d’aborder sur des bases assainies l’analyse de la phase ultime de l’histoire achéménide: à proprement parler, le dernier chapitre (xvni) n’est pas consacré à la conquête d’Alexandre, mais aux guerres menées par Darius et l’Empire face à l’agression macédonienne, et aux réponses apportées par les élites impériales au défi global de la conquête macédonienne ; conquête, résistances et ralliements sont, à leur tour, des révélateurs exceptionnellement éloquents de l’état de l’Empire, lorsque Darius III disparaît dans un complot, dans l’été 330.
1. Depuis l’achèvement du manuscrit en février 1993, j’ai eu l’occasion de « ravauder » le texte et plus encore les Notes documentaires au cours de l’année 1994 et au cours d’une partie de l’année 1995, et donc d’inclure la bibliographie récente, y compris quelques études datées de 1995 qui me sont parvenues in extremis (les ajouts ainsi greffés sont souvent cités entre crochets).
Prologue
Les Perses avant l’Empire
I. Pourquoi Cyrus ?
- Documentation ponctuelle et longue durée. - On a parfois qualifié de « scandale historique » l’écroulement brutal du formidable empire assyrien vers 610 (612 : chute de Ninive) devant les Mèdes et les Babyloniens coalisés. On peut tout aussi bien considérer que la soudaine apparition des Perses dans l’histoire du Moyen-Orient et les fulgurantes campagnes de Cyrus le Grand - Cyrus II - posent à l’historien des questions d’une ampleur et d’une complexité aussi pressantes. En effet, en deux décennies (550-530), les armées perses conduites par Cyrus II conquirent successivement les royaumes mède, lydien et néobabylonien, et plantèrent les premiers jalons de la domination perse sur le Plateau iranien et en Asie centrale. Comment expliquer ce brutal surgissement dans l’histoire d’un peuple et d’un Etat pratiquement inconnus ? Comment expliquer non seulement que ce peuple ait su forger des forces militaires suffisantes pour mener à bien des conquêtes aussi impressionnantes que rapides, mais également que, dès le règne de Cyrus, il ait disposé de l'outillage technique et intellectuel qui a permis la conception et la réalisation de Pasargades ?
L’historien qui travaille sur la longue durée sait bien qu’un règne illustre et un événement décisif s’inscrivent dans une histoire qui plonge ses racines dans un passé fécond. L’historien hellénistique Polybe en était parfaitement conscient lorsque, dans l’introduction de son Histoire, il exposait à ses lecteurs la nécessité de remonter haut dans le temps, pour comprendre comment « l’État romain a pu, chose sans précédent, étendre sa domination à presque toute la terre habitée, et cela en moins de cinquante-trois ans », et il poursuivait : « De cette façon, lorsqu’on entrera dans le vif de mon sujet, on ne sera pas en peine pour comprendre comment les Romains ont arrêté leurs plans, quels étaient les moyens militaires et les ressources matérielles dont ils disposaient quand ils se sont engagés dans cette entreprise qui leur a permis d’imposer leur loi sur mer comme sur terre et dans toutes nos régions. »
De même pour les débuts de l’histoire perse : chacun se rend compte que les victoires de Cyrus ne se conçoivent pas en dehors de l’existence d’un État déjà structuré, d’une … |